[267]
Situation de la recherche sur le Canada français
III. Perspectives sur l’étude
de la structure sociale
Marcel Rioux
Département de sociologie,
Université de Montréal
“L'étude de la culture
canadienne-française :
aspects micro-sociologiques.”
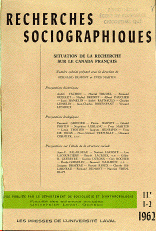
Une édition électronique réalisée à partir de l'article de M. Marcel Rioux, “L’étude de la culture canadienne-française: aspects micro-sociologiques”. Un article publié dans la revue Recherches sociographiques, vol. 3, no 1-2, janvier-août 1962, pp. 267-275. Québec: Les Presses de l'Université Laval.
Le titre de la communication que je dois présenter se lit ainsi : « L'étude de la culture canadienne-française : aspects micro-sociologiques ». Fernand Dumont et moi avons arrêté ce titre au cours d'une hâtive conversation téléphonique interurbaine ; ce titre me semble refléter une certaine ambiguïté d'intention et de formulation : on semble se reporter, d'une part, à la culture globale et, d'autre part, aux aspects micro-sociologiques de la réalité sociale. Si j'essaie de déceler notre intention commune, j'y vois le désir que nous avions tous les deux de voir traiter l'étude de la culture au niveau des petites unités culturelles, c'est-à-dire des communautés qu'ont étudiées les anthropologues et les sociologues. Sans écarter tout à fait ce point de vue, je m'arrêterai surtout sur la triple complémentarité que recèle l'ambiguïté de ce titre : 1. sur les concepts de société et culture ; 2. sur les points de vue micro- et macro-socio-culturels ; et, enfin, 3. sur le fait que l'étude de la culture canadienne-française est surtout conduite par des spécialistes qui font eux-mêmes partie de cette culture ; ce qui pose le problème subjectivité-objectivité.
Ce n'est pas mon intention de traiter ces complémentarités séparément, mais plutôt d'essayer de faire voir comment elles sont au cœur même de la réalité et de la démarche du sociologue et de l'anthropologue. Pour ce qui est des deux concepts majeurs de nos disciplines anthropologiques, ceux de société et de culture, bien que je reconnaisse qu'il faille les distinguer au niveau analytique et que cette distinction puisse être extrêmement fructueuse, je n'essaierai pas de raffiner sur la distinction dont ont convenu Krœber et Parsons, au cours d'une fameuse rencontre au sommet, distinction qui pourrait se formuler ainsi : par culture, on entend désigner le contenu et l'agencement des valeurs, des idées et tout système symbolique significatif qui influent sur le comportement humain et les œuvres de civilisation ; par société, on désigne plus spécifiquement le système relationnel d'interaction des individus entre eux, des individus par rapport aux groupes ainsi que des groupes entre eux.
Mais plutôt que d'insister sur une théorie de la société et de la culture, il me semble plus fructueux pour l'étude d'une société en voie de transformation, [268] comme l'est le Canada français, d'insister sur l'aspect dynamique des relations entre ces deux séries de phénomènes et même sur le conflit que posent l'intégration sociale et l'intégration culturelle ; ce conflit tient, bien sûr, pour une large part à la conjoncture où nous nous trouvons, mais aussi à la nature même de ces deux intégrations. En plus de nous faire mieux comprendre la réalité proposée à notre observation, ce point de vue — conflit entre l'intégration sociale et l'intégration culturelle — recèle, selon moi, la possibilité de faire avancer la théorie du changement socio-culturel. De plus, en examinant les déterminants existentiels de la théorie structurale-fonctionnelle, s'il est assez facile de repérer les raisons historiques générales — vestiges de la notion d'équilibre dans la théorie économique du libéralisme, par exemple,— et, plus près de nous, la position et l'idéologie des sociologues américains au sein de la société capitaliste, il serait intéressant d'analyser ce qui au sein de notre société nous pousse à choisir le concept d'équilibre, plutôt que celui de conflit ; il serait bien surprenant que notre position de Canadiens français à l'intérieur du Canada et que le système de sécurité que nous nous sommes bâti ne puissent se retrouver au fond de notre choix.
Dans la sorte d'inventaire que nous sommes en train de conduire ici, il ne me semble pas fructueux d'insister exclusivement sur ce que telle ou telle discipline a apporté et peut apporter à l'étude de la société canadienne-française, surtout quand il s'agit d'une réalité aussi vaste que la culture canadienne-française. On reconnaît dans les manuels que l'étude de la culture est l'objet propre de l'anthropologie ; si nous ne faisions que passer en revue les études anthropologiques sur le Canada français, notre bilan, faut-il l'avouer, serait fort mince. C'est pourquoi, au lieu d'insister sur les travaux proprement anthropologiques, j'essaierai de montrer pourquoi il y aurait lieu — à cause de la nature généralisante de l'anthropologie et de la totalité que représente la culture — de voir comment l'anthropologie et la culture débordent les frontières qu'elles s'assignent réciproquement. Ce qui me permettra d'esquisser une auto-critique de l'anthropologue et de sa culture.
Il semble que, du point de vue des relations entre l'histoire et les sciences anthropologiques, le balancier oscille de nouveau. L'exclusive qu'un grand nombre d'entre nous avaient prononcée contre l'aspect diachronique de nos études est, aujourd'hui, petit à petit rappelée. Pour toutes sortes de raisons qu'il serait trop long de détailler ici, les anthropologues ont eu tendance à minimiser les données historiques dont ils auraient pu disposer. Entre la société tribale, objet classique de l'anthropologie, et la société industrielle dont l'étude était réservée aux sociologues, il a longtemps existé un certain vide, du point de vue des praticiens de ces disciplines ; ni les uns ni les autres ne s'étaient intéressés systématiquement aux sociétés agricoles pré-industrielles qui étaient demeurées l'apanage quasi-exclusif des historiens. Or, à cause des difficultés de communications d'une discipline à [269] l'autre, les travaux des historiens avaient tendance à rester lettre morte pour les spécialistes des sociétés tribales et des sociétés industrielles. Depuis quelque temps, des sociologues et des anthropologues ré-interprètent de leurs propres points de vue les travaux des historiens sur ces sociétés-là. Je pense surtout à l'ouvrage de Sjoberg sur la ville pré-industrielle et la société agricole. Or, du point de vue de l'étude de la société et de la culture canadiennes-françaises, il apparaît que le modèle de la société pré-industrielle est plus fructueux que celui de la société industrielle développée et même celui de la folk-société — mélange de société tribale et de société paysanne. Le modèle de Sjoberg est particulièrement bien adapté pour rendre compte du passage de la société agricole à la société industrielle. D'autre part, sans modèle sociologique ou sans modèle, on risque de considérer les faits canadiens-français comme des faits uniques alors que leur spécificité est restreinte au conditionnement historique qui leur est propre.
En ce qui regarde l'histoire, notre qualité d'anthropologues et de sociologues canadiens-français nous impose d'autres limitations. Encore assez récemment, l'histoire qui s'écrivait chez nous avait moins pour fonction de nous faire connaître intégralement le passé que de nous donner des raisons de survivre comme peuple. Si, donc, à certains moments nous avons eu tendance à rejeter cette histoire, nous sommes peut-être allés trop loin et nous avons, comme disent les Anglais, jeté l'enfant avec l'eau sale de la cuvette.
Il en va de même pour les notions de société et culture globales. Parce qu'à un certain moment, une certaine idéologie voulait nous enfermer dans une culture et une société étriquée qu'elle avait pris soin de définir elle-même, plusieurs ont eu tendance à nier cette société et cette culture et à rechercher d'autres unités globales pour y intégrer notre réalité socio-culturelle. Il faut ici nous rappeler que les deux décennies d'existence de la recherche systématique en sociologie et en anthropologie coïncident avec la période où la plupart d'entre nous étaient en révolte contre cette idéologie-là.
D'une façon plus générale, on peut dire que l'oubli presque total dans lequel les notions de société et de culture globales sont tombées chez nos collègues canadiens-anglais et américains ne nous a pas aidés nous-mêmes à rattacher nos études micro-sociologiques et micro-culturelles à une totalité. Cela est particulièrement vrai de nos études de communautés qui sont, soit envisagées comme des unités fermées, ou encore comme des points de comparaison avec d'autres unités sans que, dans l'un et l'autre cas, elles soient insérées dans les sociétés globales dont elles font partie.
Un autre postulat que nous tenons de notre milieu, c'est celui de l'homogénéité du donné socio-culturel que nous étudions. Non seulement sommes-nous portés à penser que cette homogénéité existe aujourd'hui, mais qu'elle a toujours prévalu. Ce n'est que très récemment qu'historiens et sociologues ont mis en doute ce qu'on prenait auparavant largement pour acquis et ont commencé de démontrer qu'au contraire, cette homogénéité [270] ne datait que de la deuxième moitié du XIXe siècle. Allons plus loin et disons que cette homogénéité de la fin du XIXe siècle et d'une bonne partie du début du XXe siècle était surtout idéologique et correspondait beaucoup moins à une homogénéité de comportement ou de vision du monde ; ou pour mieux dire, disons que l'homogénéité culturelle postulée se rapportait surtout à l'aspect directif de la vision du monde des Canadiens, mais que ses aspects cognitifs et affectifs se différenciaient de plus en plus. En d'autres termes, nous étions tous sujets aux mêmes impératifs idéologiques et religieux, mais la vie quotidienne nous forçait à connaître une autre réalité et à lui affecter un coefficient d'affectivité différent de celui que lui donnaient les définisseurs de situation.
Ce postulat d'homogénéité n'est pas seulement culturel, mais aussi structurel. Et à ce sujet, la situation me semble encore plus complexe parce que, pour nous masquer la réalité, plusieurs facteurs sont en cause ; en plus de l'homogénéité directive de notre vision du monde, de l'homogénéité ethnique qui a longtemps été la nôtre, la réalité de la différenciation en classes sociales nous a longtemps été masquée. Il faut aussi dire qu'à cause du caractère monolithique de notre idéologie, les mots de classes sociales et de lutte des classes nous sont apparus comme renvoyant à des réalités quasi-démoniaques ; à force de réfuter le marxisme dans nos manuels et de combattre verbalement le communisme, nous en sommes venus à nier la réalité à partir de laquelle Marx a construit sa théorie. Récemment, mon collègue Jacques Dofny et moi-même avons soutenu, lors d'un colloque à l'Université Carleton sur les classes sociales au Canada, [1] que la spécificité du problème des classes sociales au Canada français tient à ceci : le Canada français se considère, est considéré et est en réalité une classe sociale à base ethnique à l'intérieur du Canada ; cette classe sociale ethnique est nettement infériorisée par rapport au groupe anglais, et même du point de vue des immigrants. Selon Porter, de 1931 à 1951, la situation s'est encore aggravée. La prise de conscience sporadique du Canada français en tant que classe sociale ethnique et l'homogénéité culturelle relative qu'on lui prête, qu'elle se donne, et qu'elle a en réalité, masquent l'hétérogénéité du Canada français qui, lui-même, se structure en classes sociales. En d'autres termes, parce que le Canada français se heurte souvent comme un tout aux autres classes ethniques, on oublie quelquefois qu'il se stratifié selon ses propres critères. Il est bien sûr que parce que les Canadiens français participent au système canadien et à cause de la présence d'Anglo-Canadiens dans le Québec, il peut exister une double échelle de stratification. Si les phénomènes de stratification présentent un terrain favori d'étude pour les sociologues, les classes sociales envisagées comme des sous-cultures intéressent vivement les anthropologues ; ce pourrait être là une aire de collaboration [271] entre ces spécialistes. Encore ici, notre appartenance à la société nord-américaine et l'influence qu'ont exercée sur nous ses sociologues ont eu tendance à masquer la réalité des classes sociales et à faire des praticiens des sciences de l'homme des fonctionnaires au service du gouvernement et des grandes entreprises. Les sociologues américains se proposent comme des spécialistes qui peuvent aider le système social à bien fonctionner. Ne leur ressemblons-nous pas quelque peu ? Dans un article récent des Archives européennes de sociologie, Raymond Aron a mentionné « la bienveillance intéressée » dont bénéficient les sociologues de l'U.R.S.S. et des U.S.A., les deux fonctionnant pour le plus grand bien de chaque système.
Avant de terminer ces remarques sur les conditionnements et les limitations que nous impose l'appartenance à la culture même que nous étudions, je voudrais mentionner une autre forme subtile d'aliénation qui n'est pas propre aux praticiens des sciences de l'homme, mais qui peut, toutefois, influencer certaines de leurs options. Il est bien sûr que si le Canada français est objectivement une classe sociale ethnique infériorisée à l'intérieur du Canada, la tentation sera grande pour plusieurs de valoriser la culture canadienne-française pour faire oublier la position structurelle inférieure du Canada français. Cette option, consciente ou inconsciente, fait bien l'affaire des deux principaux partis en cause ; la classe infériorisée économiquement et socialement se revalorise à ses propres yeux. Tandis que la classe ethnique supérieure peut se dire, dans le même temps, que l'ordre et la nature des choses restent ce qu'ils sont, ce qui m'amène à me demander jusqu'à quel point les objectifs de la recherche doivent-ils être influencés par la conjoncture ? Question qui n'est pas aussi électorale qu'elle peut paraître. C'est Gurvitch qui montre comment, au cours de l'histoire, la situation sociale que vivent les sociologues influe sur les problèmes qu'ils se posent. S'il existe une sociologie de la dépendance comme celle que notre collègue Georges Balandier a étudiée, il doit bien exister aussi une sociologie de l'indépendance ; quelle que soit celle que chacun choisira selon son tempérament et ses aptitudes, les études qui en découleront pourront non seulement nous renseigner sur notre société, mais influer peut-être sur la conjoncture même.
Au chapitre du conditionnement culturel de ceux qui étudient la culture canadienne-française, il faudrait mentionner les survivances scolastiques et les postulats de visions du monde qui continuent d'influencer même ceux qui étudient les variations de cette vision du monde. Si les premières sont assez facilement détectables à l'œil nu, les autres ne seront décelées qu'après des études systématiques.
Ces remarques répondent plutôt en zigzags à la question posée : ce qui a été fait, ce qui reste à faire. On admettra que les départements d'anthropologie et les spécialisations en anthropologie n'existant à Laval et à Montréal que depuis cette année ou l'an dernier, personne ne doit s'attendre à un bilan très riche. Ayant moi-même appartenu à une institution qui subventionne [272] des études dans les domaines de l'anthropologie, je puis dire qu'un grand nombre de documents, tant oraux que matériels, ont été recueillis sur la culture traditionnelle (folklore et culture matérielle) des Canadiens français. Un certain nombre de communautés rurales ont aussi été étudiées. Il faudrait aussi mentionner les quelques monographies ethnographiques qui ont été conduites par des universitaires d'ici ou d'ailleurs. Mais l'étude de la culture d'un groupe comme celui que forment les Canadiens français n'est pas exclusivement l'affaire des ethnographes et des anthropologues professionnels. À eux, peut-être, revient la tâche de systématiser les recherches et les documents accumulés par d'autres disciplines : histoire, linguistique, littérature, géographie humaine, sociologie, psychologie, droit, et j'en passe. Ce devrait être une des premières tâches des départements d'anthropologie ou, à tout le moins, de ceux des spécialistes qui s'intéressent à l'étude du Canada français de créer une schème de catégorisation et d'interprétation des œuvres culturelles des Canadiens français ; ce schème devrait être élaboré en fonction de la culture globale et, pour éviter l'aliénation culturaliste, ces efforts de systématisation devraient se conjuguer avec ceux des sociologues qui étudient la société globale ; aussi importante et peut-être, en l'occurrence, plus importante devrait être l'étude des variations culturelles en fonction non seulement des époques, mais des classes sociales et des groupes sociaux. Peut-être que pour un certain temps et pour certains anthropologues, la tâche principale devrait être la création de techniques d'analyse et l'analyse des données qui, bien que non recueillies par des spécialistes en anthropologie, sont essentielles à l'étude de la culture. Il y a deux ou trois ans, un collègue de Laval et moi-même avions essayé d'établir une espèce de programme pour l'étude des variations des visions du monde chez les Canadiens français : or, dans ce programme, les travaux sur le terrain, exécutés par des spécialistes, ne constituaient qu'une partie des études projetées ; il aurait justement fallu, selon nous, analyser au moyen de techniques appropriées ce que les travaux d'autres disciplines recèlent de matériaux qu'il serait hautement important d'intégrer aux études anthropologiques proprement dites.
Quant aux études sur le terrain, il serait souhaitable que des équipes interdisciplinaires se forment pour étudier des communautés choisies en fonction des problèmes de la société globale et de la problématique contemporaine de nos disciplines. Ce que je recommande, en somme, c'est que nos disciplines ne se désintéressent pas des projets d'exister de notre communauté nationale, et qu'elles soient présentes dans les débats théoriques de l'heure. Je ne crois pas que ces deux souhaits soient antinomiques : ils se complètent plutôt.
Marcel Rioux
Département de sociologie,
Université de Montréal.
[273]
Institut d’histoire, Université Laval.
[pp. 273-275.]
Vous aurez entendu plusieurs exposés sur la culture dans ces « perspectives sur l'étude de la structure sociale », dont ceux de MM. Lacourcière, Falardeau, Lefebvre, Rocher, Mailhiot et Rioux. Comment un historien peut-il aborder ce problème de la culture au Canada français après des ethnographes, des linguistes, des sociologues et des anthropologues ? Il y a sans doute bien des façons de le faire ; aussi je me contenterai de soumettre à votre réflexion quelques aspects d'une nouvelle orientation de l'historiographie contemporaine. Cette nouvelle section, qui tend à regrouper des voies éparses, situées aux confins de la psychologie, de la sociologie, de l'anthropologie et de l'histoire connaît actuellement trois appellations : histoire de la psychologie collective, histoire des mentalités, histoire du mental collectif. [2] Cette histoire se donne pour objet d'étude la psyché collective, l'âme collective, le mental collectif ; elle cherche à comprendre les attitudes mentales des groupes, à relier les représentations collectives et les conduites personnelles dans l'évolution totale d'un peuple ; histoire qui étudie encore la dialectique du groupe et de l'individu, histoire attentive aux « modèles » culturels comme aux réactions personnelles, histoire sociale et biographique, qui se développe selon les différentes cadences de la durée. [3] Histoire qui se fonde évidemment sur l'existence de la psychologie collective elle-même, comme l'ont démontré Durkheim, Blondel et Halbwachs.
Quand je dis nouvelle section de l'histoire, cela ne signifie pas que cette discipline n'ait jamais été pratiquée. Histoire nouvelle en ce sens qu'elle précise ses méthodes, regroupe ses efforts et compte maintenant ses maîtres, ses chefs d'équipe en Europe occidentale, un peu selon les vœux d'Henri Berr et de Lucien Febvre. C'est M. Alphonse Dupront, professeur à la Sorbonne, qui en est l'un des animateurs les plus fervents.
Comme M. Dupront l'a formulé au XIe Congrès des sciences historiques en août 1960, le travail en histoire du mental collectif consiste à chercher dans trois grandes directions :
- « Établir l'inventaire des formes, créations, images, valeurs, des expressions tant saines que morbides, par quoi se manifeste le mental collectif ; analyser les raisons de vivre, les forces de création, le « comment » de l'action ou de la passion des hommes d'une époque ou d'un pays, à un moment donné ; rendre manifeste l'existence de phénomènes périodiques, de rythmes, de retours, par rapport à certains besoins, idées, images mentales, mythes, archétypes, ou complexes de valeurs. » [4]
[274]
Cette histoire « n'existe que dans la mesure où elle se donne à elle-même sa matière » et « tout le donné historique est évidemment matière de l'histoire du mental collectif, qui doit justement rechercher dans le donné historique ce qui est collectif dans les besoins, les attitudes, les comportements ou les idéals. » [5]
La méthode fondamentale de cette histoire, c'est celle de la description. La volonté de description doit être constante et ne doit pas se laisser attirer par la tentation d'établir des lois ou d'aboutir à une « systématique de la sociologie historique ».
Une fois les grandes voies de la recherche indiquées et la méthode signalée d'un mot, essayons d'indiquer quelques domaines plus précis où doit porter l'effort de l'historien. En ce qui concerne les idées-forces, étudier la naissance, la diffusion, le rôle des opinions, des « images » (par exemple la représentation qu'un peuple se fait d'un autre). En ce qui concerne les croyances, étudier les formes de la pratique religieuse aussi bien que les formes aberrantes de piété, les superstitions, la sorcellerie, les traditions ésotériques. Pour connaître l'outillage mental, étudier en tout premier lieu le langage, les moyens d'expression que l'individu reçoit du groupe et qui servent de cadre à toute sa vie mentale, dans le vocabulaire et la syntaxe ; étudier ensuite les autres procédés d'expression, ceux qui traduisent les quantités, les nombres, les mesures, les représentations du temps et de l'espace, supports sensibles de la pensée.
Histoire de l'éducation, au sens le plus large, qui comprend toutes les communications entre l'individu et son milieu, des moyens par lesquels il reçoit les modèles culturels, depuis l'enfance par la famille et les groupes d'écoliers, jusqu'à l'âge adulte par les propagandes ; histoire des institutions scolaires, de leurs structures, de leur contenu, des notions qu'elles veulent transmettre, de leur équipement, de leur implantation dans la société ; histoire de tous les moyens d'information, des véhicules de la culture tels que les livres, les bibliothèques, les journaux et périodiques.
Histoire des représentations que la collectivité canadienne-française s'est faites du monde, de la vie, de la mort, de la religion, de la politique ; histoire des thèmes de la création artistique dans les arts plastiques, la littérature écrite et orale.
Il faut s'arrêter là dans l'énumération des voies ouvertes à la recherche et se demander si cette histoire est possible, autrement dit, si elle compte déjà des ouvrages de valeur. Je n'en citerai que quelques-uns : le Rabelais [6] et le Martin Luther [7] de Febvre, la Grande Peur de George Lefebvre, [8] Le temps de L'histoire de Philippe Ariès, [9] le Déclin du moyen âge de Huizinga, [10] les Rois thaumaturges et la Société féodale de Marc Bloch [11] et la Chrétienté et l'idée de croisade d'Alphandery et Dupront, [12] le livre de Ferguson sur la Renaissance [13] et celui, plus récent, de Robert Mandrou sur l’Introduction [275] à la France moderne. [14] Tous ouvrages qui suffisent à prouver la validité de l'histoire du mental collectif.
De la recherche à Québec en ce domaine, quelques directions sont d'ores et déjà entreprises. En ce qui concerne l'histoire de l'enseignement, au point de vue de la transmission des connaissances, on peut lire dans le dernier numéro de la Revue d'Histoire de l'Amérique française la première tranche d'une étude sur les « Débuts de l'enseignement de l'histoire et de la géographie au Petit Séminaire de Québec (1765-1870) ». [15] Un candidat au diplôme d'études supérieures est en train de rédiger sa thèse sur un sujet analogue dans un autre vieux collège du Québec.
Au plan de l'histoire des idées, un jeune collègue a commencé des recherches sur le mouvement de pensée ultramontaine au Canada français dans la dernière partie du XIXe siècle, courant de pensée rattaché à ses homologues américain, français et romain.
Dans un autre secteur, je travaille pour ma part, depuis bientôt dix ans, sur les réactions de l'opinion canadienne-française devant la France et les Français depuis la Conquête jusqu'à la Capricieuse (1760-1855). [16] Une telle recherche m'amène à étudier d'abord les relations entre les Français et les Canadiens sous tous leurs aspects, à analyser ensuite les représentations que se font les individus et les groupes canadiens-français de la France, des événements qui se passent en France. Je crois avoir réussi à cerner, entre autres résultats, à certains moments, le sentiment des classes populaires, alors que généralement, dans ce genre d'études, on ne réussit qu'à saisir l'opinion des élites, la seule qui se soit généralement exprimée et qui ait laissé des traces écrites. Je dois ces résultats aux ethnographes qui, dans leur cueillette des traditions orales, nous offrent une documentation d'une richesse unique en son genre.
Je terminerai ce commentaire en faisant remarquer qu'il ne faut pas trop se hâter en cette sorte d'histoire, qu'il convient d'aller lentement, avec de bons outils et des méthodes sûres, qu'on acquiert après une bonne quinzaine d'années d'études et de travaux personnels. Et, comme le dit monsieur Rioux, les historiens doivent se tenir en liaison étroite avec les autres spécialistes, ce qui est le cas déjà pour plusieurs d'entre nous et ce que peut favoriser davantage ce colloque. Nous avons maintenant, au Canada français, non seulement des individus, mais, pour la première fois, une équipe de chercheurs et de savants qui doivent travailler ensemble, autant que possible. Voilà comment un historien peut envisager l'étude de la culture en demeurant dans la dimension propre à sa discipline, qui est celle du passé.
Claude Galarneau
Institut d'histoire,
Université Laval.
[1] Jacques Dofny et Marcel Rioux, « Les classes sociales au Canada français », Revue française de sociologie, III, 1962, 290-300. [Texte disponible dans Les Classiques des sciences sociales. JMT.]
[2] Alphonse Dupront, « Problèmes et méthodes d'une histoire de la psychologie collective », Comité International des sciences historiques, Stockholm, 21-28 août 1960. Résumé des communications. Göteborg-Stockholm-Upsala, Almquist et Wiksell, 1960, 26-28. M. Dupront a repris sa communication, sous le même titre, dans Annales. Économies. Sociétés. Civilisations, janvier-février 1961, 3-11, mais en proposant « histoire du mental collectif » au lieu « d'histoire de la psychologie collective ». M. L. Trénard avait employé « mental collectif » lors de la discussion, comme les Actes du Congrès le rapportent, à la page 50. Enfin, M. G. Duby, dans L'histoire et ses méthodes publiée sous la direction de Charles Samaran, Paris, Gallimard (Encyclopédie de la Pléiade, 1961, 965), propose, après Lucien Febvre, de garder « histoire des mentalités ». Voir : Lucien Febvre, Combats pour l'histoire, Paris, Colin, 1953.
[3] Fernand Braudei., « Histoire et sciences sociales ; la longue durée », Annales E.S.C., 1958, 725-753.
[4] Alphonse Dupront, op. cit., 26-27.
[10] Trad. fr., Paris, 1948.
[11] Paris, 2e éd. 1962 et Paris, 1939-40.
[13] Trad. fr., Paris, 1950.
[15] Pierre Savard, « Débuts de l'enseignement de l'histoire et de la géographie au Petit Séminaire de Québec (1765-1870) », Revue d'Histoire de l'Amérique française, XV, 4, mars 1962, 509-525.
[16] On pourra avoir une idée sommaire d'une partie de ce travail dans : « Les échanges culturels franco-canadiens depuis 1763 », dans : Le Canada français, aujourd'hui et demain, Paris, Fayard, 1961, 67-78 (Recherches et débats, cahier n° 34).
|

