|
Bernadette Rigal-Cellard
“Missions impossibles ?
Non, seulement extrêmes !”.
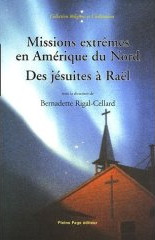 Un article publié dans l’ouvrage sous la direction de Bernadette Rigal-Cellard, Missions extrêmes en Amérique du Nord: des Jésuites à Raël. Bordeaux: Éditions Pleine Page, 2005, pp. 11-28, 394 pp. Un article publié dans l’ouvrage sous la direction de Bernadette Rigal-Cellard, Missions extrêmes en Amérique du Nord: des Jésuites à Raël. Bordeaux: Éditions Pleine Page, 2005, pp. 11-28, 394 pp.
- Table des matières
-
- Introduction
-
- Terres extrêmes
- Missions chrétiennes en terres indiennes
- Mystiques et visionnaires
- Meneurs d’hommes et prêche apocalyptique
- Missions politiques de l’intérieur
- Missions politiques internationales
Introduction

Les missions dont nous parlerons dans cet ouvrage sont religieuses, politiques, sociales, souvent les trois à la fois, et se caractérisent par une intensité inouïe, extrême, tant lors de leur conception que dans leur réalisation, au Canada essentiellement (15 études) mais aussi aux États-Unis (3 études).
Terres extrêmes

Le terme « extrême », richissime, à la fois substantif et adjectif, est à la mode depuis plusieurs années pour évoquer des exploits physiques inégalés auparavant, des aventures jamais imaginées par le passé, des plaisirs indescriptibles, commercialisables, bien entendu, tels les cornets de glace superposant couches exquises sur volutes crémeuses aériennes et infinies qui nous font saliver sur les panneaux d’affichage de nos rues.
Ainsi, ce mot, qui était dans l’air du temps, suscita, lorsqu’il fut prononcé dans une de nos réunions, l’enthousiasme de tous les présents. Le choix d’un thème d’analyse par un centre de recherche requiert parfois de longues négociations : on sait qu’on y consacrera plusieurs années, et lorsque l’équipe est multidisciplinaire le thème doit intéresser aussi bien des historiens que des géographes, des sociologues, des politologues, des littéraires, des civilisationnistes, des psychanalystes… Analyser les manifestations de l’extrême au Canada, voire en Amérique du Nord dans son ensemble, parut fort prometteur, et la variété et le dynamisme des études qui suivent témoignent de l’intérêt ainsi suscité.
En premier, le terme évoquait instantanément la taille du Canada, son climat, ses conditions de vie, toutes choses qui dans notre imaginaire collectif européen font de ce pays une terre hors du commun, qui figure d’ailleurs dans le dictionnaire comme manifestation exemplaire de l’extrême. « Extrême » (un superlatif, celui de « exterus » pour « dehors ») signifie : « Qui est tout à fait au bout. Porté au dernier point, au plus haut degré. Qui outre, qui n’a point de mesure, en parlant des personnes. Dernière limite des choses. Qui est éloigné de l’état modéré… ainsi les climats extrêmes, très chauds ou très froids, ou se dit aussi des climats où les différences sont très grandes entre l’été et l’hiver, par exemple, la Russie, le Canada. » (Littré)
Puis, ce qui nous séduisit, ce fut le contraste entre, d’un côté, ces conditions géographiques ou climatiques extrêmes, et, de l’autre, l’organisation sociale et politique du pays. Le Canada se présente, en effet, comme un modèle de modération, d’équilibre, de générosité sociale, un négociateur mesuré inégalé en temps de crise internationale, une nation qui se targue d’avoir conquis son territoire presque pacifiquement, bref, l’exact anti-modèle de son voisin du Sud, perçu comme celui de tous les excès, de tous les extrêmes sociaux : les États-Unis ne sont-ils pas synonymes de violence, d’inégalités sociales, de quête effrénée du bonheur matériel et de la richesse, d’arrogance, d’impérialisme sur le continent et dans l’univers… ? Il n’était donc pas fortuit qu’au lendemain de l’élection présidentielle 2004 ce soit au Canada que songeaient émigrer des milliers d’Américains écœurés par la victoire des conservateurs que l’on a pu qualifier d’extrémistes justement. L’extrémiste est celui qui pousse ses convictions jusqu’à leurs limites les plus excessives, afin que les conséquences dans le monde matériel ou spirituel en soient radicales, sans appel. L’extrémisme rejoint alors le fanatisme, terme qui vient du latin fanaticus, signifiant « inspiré, en délire ».
Et pourtant, à y regarder de plus près, sous ses apparences débonnaires et paisibles, ce pays dans son histoire et sa vie contemporaine exhibe de puissants surgissements de l’extrême, qui tout en lézardant la belle harmonie de surface, ne le rendent que plus fascinant encore. Comment en sommes-nous venus ensuite à privilégier la thématique des missions ?
Nous avons commencé à nous interroger sur la naissance de ce géant, en tant que pays occidental, c’est-à-dire à partir des voyages de Jacques Cartier (1534, 1535, 1541) et de Samuel de Champlain (1603, 1605, 1608…). Or, tout dans sa genèse procédait d’ordres de mission, d’injonctions proférées à Paris et à Rome pour tester les élites des nations catholiques, missions aussi bien profanes que strictement religieuses, l’une n’allant pas à l’époque sans l’autre. Ici encore l’histoire du Canada correspondait parfaitement aux sens principaux du terme mission (du latin missum, le supin de mittere, envoyer) : « Pouvoir donné d’aller faire quelque chose. Fonction temporaire dont un gouvernement charge des agents spéciaux pour certains objets déterminés. Ordre et pouvoir que donne Dieu, Jésus-Christ, un ecclésiastique supérieur pour aller prêcher, instruire, etc. Terme collectif désignant les prêtres envoyés pour la conversion des infidèles ou pour l’instruction des chrétiens. » (Littré)
Les missionnaires du roi ou de l’Église devaient étendre et conforter le pouvoir de leur royaume, temporel et spirituel, en gagnant des territoires, des marchés, des âmes, afin d’en priver les autres puissances européennes dont l’expansion serait ainsi contenue lors de ce partage du Nouveau Monde. Ces envoyés ne pouvaient être que des individus, hommes ou femmes, d’une trempe hors du commun pour affronter les conditions de voyage de l’époque et l’installation dans des terres inhospitalières. Ce sont les femmes, Amazones d’un monde nouveau, qui auront ici le plus retenu notre attention en raison des prouesses qu’elles accomplirent dès les premiers temps de l’implantation européenne.
La mission la plus connue des Français au Canada—la traite des fourrures dont la France et l’Europe avaient besoin pour se protéger du froid en restant à la mode—relevait quotidiennement de l’exploit extrême en tout point, physique, diplomatique, militaire. Cet aspect-là de la colonisation a toutefois été déjà étudié. En revanche, le deuxième volet des missions, la christianisation des Indiens, n’a pas encore été totalement exploré ; c’est un domaine d’étude en pleine expansion auquel plusieurs chapitres de cet ouvrage apportent leur pierre.
Missions chrétiennes en terres indiennes

Dès lors que nous abordions les missions en terres indiennes, il était impossible de nous restreindre à la seule Nouvelle-France puisque l’esprit missionnaire, à l’image des tribus, ne connaissait pas les frontières qui couperaient plus tard le continent en trois. Nos investigations nous amèneront donc aussi dans la colonie de New York au XVIIIe siècle, dans les Plaines du Canada et la zone subarctique au XIXe siècle, ainsi que dans les territoires enlevés au Mexique en 1848.
Étudier les missions en Amérique du Nord nous permet de mieux comprendre les mythes religieux qui ont entouré la naissance et la formation du Canada et des États-Unis, ainsi que les parallèles et les divergences entre les deux pays. En effet, si l’on sait que l’idéal des Pères Pèlerins du Mayflower, qui fondèrent les colonies puritaines de Nouvelle-Angleterre dès 1620, consistait à réaliser sur le nouveau continent la Cité de Dieu que le Vieux Monde n’avait pas su construire—conviction qui, comme nous le verrons dans cet ouvrage, animera aussi les mormons au XIXe siècle—, on sait moins que ce fut en réalité le dessein de quasiment toutes les missions religieuses outre-Atlantique, et en particulier de celles qui allaient faire de la Nouvelle-France une terre catholique.
Bien avant que les Puritains n’accostent, des visionnaires français décrivaient émerveillés la Terre Promise que la Providence leur avait léguée, ainsi Marc Lescarbot (né vers 1570 ou 1580, mort en 1640) dans son Histoire de la Nouvelle-France, publiée dès 1609. Les projets catholiques et protestants divergeraient cependant plus tard : pour les Anglo-Saxons, dont la mission première incluait officiellement aussi la conversion des Indiens (la charte de la Compagnie de Virginie (1606) faisait de la propagation de la foi le but principal de l’entreprise, et celle du Massachusetts confiait aux puritains l’obligation de convertir les Indigènes au Sauveur de l’Humanité), il s’agirait assez vite de construire la Nouvelle Jérusalem à l’écart des diables bruns ou rouges qui résistaient à l’évangélisation, ou plus exactement, de la construire sur leur sol une fois qu’ils en auraient été repoussés ; alors que pour les Français, la Cité de Dieu incluait les Indigènes, leur conversion étant la condition sine qua non pour faire rayonner la gloire du christianisme.
L’évangélisation fut aussi rude que la traite, mais son projet relevait d’un idéal hors du commun, non pas un enrichissement financier, comme pour les directeurs des diverses Compagnies de commerce, ou un gagne-pain comme pour les coureurs des bois ou pour les soldats, mais la transformation radicale de la culture et des modes de pensée des Sauvages (ceux qui vivaient dans la silva, la forêt), sans que l’enrichissement matériel du missionnaire entre en ligne de compte.
Nous sommes bien face à un comportement extrême, fascinant par ses excès, y compris pour les observateurs qui ne partagent pas la motivation profonde de l’entreprise, le salut des Indiens en les obligeant à adopter la religion des envahisseurs. La réaction des Indigènes lorsqu’ils furent confrontés à ce qui représentait pour les Européens une fabuleuse aventure mais pour eux-mêmes un impitoyable fanatisme signant la destruction irrémédiable de leurs mœurs et de leurs croyances ne sera pas véritablement explorée dans cet ouvrage. Elle sera abordée cependant dans les études sur Kateri Tekakwitha et sur Samson Occom.
S’il existe bien encore des missionnaires de nos jours, leurs conditions de vie ne sont en rien comparables à celles des pionniers sur lesquels nos regards se sont portés : être missionnaire, cela voulait dire effectuer une dure formation intellectuelle et théologique ; et si l’on se destinait aux missions étrangères, tout quitter pour affronter pendant des mois les mers, les éléments déchaînés, puis des étrangers aux langues et aux mœurs inconnues, dans des contrées aux climats les plus sévères de la planète, et agités de nombreux conflits armés.
Les jésuites furent, on le sait, les meilleurs champions de cette entreprise de par le monde, dès la bulle pontificale de Paul III en 1540 autorisant la fondation de la Société de Jésus qu’Ignace de Loyola avait conçue par le serment avec ses amis à Paris en 1534. Dès 1542, François-Xavier évangélisait Goa, puis le Japon en 1549. Cette même année vit ses frères arriver en Amérique du Sud, au Brésil. Dans la partie nord du continent, les jésuites atteignirent l’Acadie en 1611, puis d’autres encore le futur Québec en 1625, cinq arrivèrent dans le Maryland en 1634 avec Lord Baltimore amenant les catholiques anglais persécutés chez eux.
S’ils apparaissent dans notre titre comme figure d’origine des missions en Amérique du Nord, c’est parce qu’ils furent les véritables promoteurs de la christianisation du Canada, de la Nouvelle-France et des possessions françaises de la Louisiane et des franges ouest qui deviendraient le centre nord des États-Unis. Même s’ils furent suivis par d’autres ordres missionnaires catholiques, le partage des compétences dans l’hémisphère occidental (comme au niveau politique entre les différentes nations européennes) confia à leur influence la zone lusophone, le Brésil, et ses territoires adjacents, qui deviendraient le Paraguay et la Colombie, puis le futur Canada justement. Ils imprimèrent durablement leur marque sur presque toutes les tribus de l’Est et du centre et sur la nation canadienne en gestation, suscitant chez ceux qui en subirent le joug des réactions extrêmes, au sens littéral du « meilleur » ou du « pire ».
Personnages de l’extrême, les jésuites allèrent jusqu’au bout de leur endurance physique, ne succombant aux maladies, aux tortures, qu’après de longues résistances, d’épouvantables souffrances et agonies. Parfois miraculeusement, ils en réchappaient, suscitant alors l’effroi ou l’admiration extrême de leurs bourreaux. Souvent, malheureusement, ils devaient réduire leur ministère à l’offrande de l’extrême-onction à leurs ouailles que les microbes qui les accompagnaient depuis l’Europe, eux ou les autres aventuriers, décimaient du jour au lendemain. Et même s’il est de bon ton de décrier leur influence aujourd’hui, il demeure de nombreux Indiens qui se félicitent d’avoir eu accès à leurs écoles et à l’enseignement qu’ils y prodiguaient. On songe alors à la citation de Buffon que Littré introduit dans l’entrée « mission » : « Les missions ont formé plus d’hommes dans ces nations barbares, que les armées victorieuses des princes qui les ont subjuguées. »
La fonction du missionnaire ne consiste-t-elle pas finalement autant à détruire le mode de vie des néophytes qu’à les préparer à envisager autrement l’avenir en les dotant, pour résister à l’envahisseur, des armes mêmes de celui-ci ? Passés les premiers affrontements spirituels, les missionnaires devinrent ces passeurs, ces négociateurs, qui tempérèrent la fureur et l’avidité des aventuriers, des spéculateurs, des soldats, puis des fonctionnaires. On connaît le rôle que joua Bartolomé de las Casas face aux Conquistadores ; au Canada, la colonisation ne se fit pas comme ailleurs dans un bain de sang, mais les jésuites y aidèrent également les Indigènes de maintes manières, ainsi en donnant une forme écrite à diverses langues locales. Certes, cela permettrait une évangélisation plus efficace, mais pour les générations suivantes, qui auraient dû de toute façon subir la colonisation, ces travaux auront été un lien avec leurs langues ancestrales, car sans eux, elles auraient totalement disparu.
Les jésuites ne sont pas analysés spécifiquement dans notre ouvrage, mais ils apparaissent derrière les héroïnes de la Nouvelle-France dont la vie est ici retracée : Marie de l’Incarnation, Madeleine de la Peltrie, Kateri Tekakwitha. Françoise Deroy-Pineau retrace leurs missions en toile de fond pour situer avec précision l’originalité de l’aventure de Marie Guyard ou Marie de l’Incarnation. Sans les lettres des pères jésuites, les fameuses Relations de Nouvelle-France (commencées par le Père Biard en 1616), celle-ci n’aurait pas entendu parler depuis Tours de ce fabuleux pays au-delà des océans, et n’aurait sans doute pas reçu cette vision formative qui allait lui faire emprunter le même chemin que ces hommes intrépides. Sans la lecture des Relations, son accompagnatrice, Madeleine de la Peltrie, n’aurait pas su non plus où diriger sa fortune et son énergie.
Ces deux fondatrices du Canada, ces Amazones que dépeint F. Deroy-Pineau, formulèrent clairement cet idéal de la conversion des Sauvages. Marie rêvait de réaliser dans les étendues glacées du Canada ce qu’elle appelait « la Jérusalem des Terres Froides », et son projet consistait à amener au Christ les jeunes Sauvagesses. Le rêve de Madeleine de la Peltrie était de lui faciliter la tâche, de l’épauler par sa grande compétence en matière de ce que l’on appellerait aujourd’hui la logistique.
Sans les jésuites encore, Tekakwitha n’aurait pas existé en tant que Kateri, cette jeune Indienne au catholicisme si pur qui vécut une vie exemplaire en milieu hostile, ne supportant la vie terrestre que dans l’attente de sa réunion ultime avec le Christ et son modèle la Vierge Marie, puisque c’est par les pères que sa mère et elle-même entrèrent en contact avec le catholicisme. Sans eux, nous ne saurions rien aujourd’hui de sa vie. Nous retraçons personnellement ici comment ce furent les jésuites aussi qui décidèrent d’élever sa personne au rang de modèle pour les Indiens, perçus tous comme christianisables, comment ils soutinrent sa cause qui aboutit à sa béatification en 1980, en même temps que celle de Marie de l’Incarnation, et comment ils continuent d’oeuvrer afin qu’elle puisse enfin être canonisée.
Si les jésuites sont bien restés présents en Amérique du Nord, ils n’ont pas connu après la restauration de leur ordre la fabuleuse expansion des premiers temps. Ce furent les Oblats de Marie Immaculée (OMI) qui prirent le relais et évangélisèrent tout l’Ouest canadien et les Territoires du Nord-Ouest. Leur ordre fut fondé en Provence par Charles-Joseph-Eugène Mazenod en 1816, et approuvé par le pape Léon XII en 1826. Un peu comme les jésuites qui avaient été le fer de lance de la Contre-Réforme, les oblats voulaient réveiller la foi et la pratique religieuse aux lendemains de l’apostasie révolutionnaire, et ils se lancèrent aussi à corps perdu dans les missions étrangères. En Amérique du Nord, ils aidèrent le catholicisme local à se structurer, construisirent des écoles, des universités très renommées, apprirent les langues indigènes, intensifièrent l’évangélisation, et, comme les jésuites, ils rencontrent de nos jours de nombreuses critiques mais aussi des louanges. On se souviendra du dictionnaire et de la grammaire de la langue cri (ou cree) composés par le Père Lacombe, dont Colin Taylor nous retrace le périple dans les zones subarctiques en parallèle avec celui du Révérend Egerton Young. L’anthropologue se plaît à souligner toutes les connaissances dont nous leur sommes redevables, ainsi que l’estime dans laquelle les tenaient les Indiens, même s’ils demeuraient circonspects face à la mission première de leurs visiteurs, leur conversion à la religion des Blancs.
Aujourd’hui, plusieurs oblats œuvrent encore à rétablir l’amitié entre les diverses communautés du pays. Ainsi, le Père René Fumoleau découvrant que les Diné chez qui les autorités de l’Église l’avaient envoyé étaient déjà bien plus naturellement chrétiens que les nations dites chrétiennes, s’investit-il d’une mission extraordinaire : fouiller les archives gouvernementales à la recherche de tous les documents permettant d’écrire l’histoire des traités régissant les conditions de vie dans les Territoires du Nord-Ouest, afin que, connaissant l’histoire de leur dépossession, les Autochtones puissent réclamer leur dû et prendre leur avenir en main (Aussi longtemps que le fleuve coulera). Ou encore le père Achiel Peelman, qui analyse les divergences et les convergences entre les spiritualités indigènes et le christianisme afin que les deux partis se comprennent et se tolèrent dans un pays unifié (Le Christ est un Amérindien).
La mission accomplie deux siècles auparavant par Samson Occom chez les Indiens de la région de New York fut sinon unique du moins assez rare puisque ce missionnaire était un Indien lui-même appartenant aux premières générations de convertis. Il fait en outre figure aujourd’hui de précurseur de la littérature indienne grâce à son autobiographie récemment découverte et à son discours à l’occasion de l’exécution de Moses Paul (Sermon Preached at the Execution of Moses Paul), en 1772, extraordinaire plaidoyer pour la justice chrétienne que les Blancs prétendaient inculquer aux Indiens alors qu’ils n’étaient pas eux-mêmes capables de la respecter. Le personnage est passionnant car il avait déjà tout compris : les véritables intentions des colons, leurs mensonges, ainsi que le mystère du christianisme et la profonde ambiguïté de l’entreprise missionnaire. L’analyse que nous livre John Strong porte justement sur les problèmes suscités par l’imposition du modèle racial et culturel blanc aux tribus du Nord-Ouest et sur l’originalité de la vision de Occom.
L’évangélisation des Indiens par les mormons relevait d’une préoccupation radicalement différente de celle des missionnaires antérieurs, mais était tout aussi extrême dans sa conception : il fallait ramener à leur foi ancestrale les descendants de la Tribu Perdue d’Israël que sont censés être les Indiens d’Amérique pour les mormons. Cependant, en réalité, leur évangélisation dans l’Utah ne fut pas prioritaire. La mission des saints des derniers jours n’exigeait véritablement que la dépossession territoriale des Indiens afin de permettre la réalisation de la Nouvelle Jérusalem sur une terre vierge. L’évangélisation serait tentée plus tard pour faciliter la pacification.
Mystiques et visionnaires

La mission spirituelle déborde bien évidemment la seule christianisation des païens. Les fidèles entendent leur Dieu ou leurs Dieux leur parler, les envoyer en missions intimes ou collectives, pour réaliser sur terre ou seulement dans leur corps et leur âme un nouveau royaume, celui de l’union mystique avec le transcendant. Il n’est ainsi pas fortuit que la genèse du Canada français soit intimement liée au mysticisme catholique, manifestation extrême du spirituel. S’il conquit beaucoup d’Européennes dès le XIVe siècle, c’est en grande partie parce qu’il offrait aux femmes en quête d’émancipation un champ expérimental, une libération des contingences sociales. Aucune, toutefois, ne parviendra à concilier aussi intensément que Marie de l’Incarnation le mysticisme et l’aventure pionnière, au sens fort du terme. Ce fut elle qui introduisit au Canada cette expression ultime de la spiritualité qu’elle ancra en même temps au plus profond de l’expérience quotidienne matérielle et séculière d’un royaume terrestre en gestation.
Marie de L’Incarnation était tout à la fois une mystique qui gardait les yeux rivés sur un territoire infini, celui du commerce intime avec Dieu, et une pédagogue authentique. Si Françoise Deroy-Pineau a choisi ici de retracer sa mission d’évangélisatrice et d’enseignante, Jérôme Hennebert, lui, traque dans ses écrits la marque de la quête faussement modeste de l’héroïcité, et décrypte, sous l’apparente humilité qu’il perçoit comme davantage convenue que sincère, un profond orgueil, interprétation qui ne manquera pas de susciter de nombreuses réactions chez ceux qui travaillent à la canonisation de l’Ursuline, laquelle a franchi le cap de la béatification en 1980, en même temps que Kateri Tekakwitha.
Marie Guyard allait faire de nombreuses émules dans la Jérusalem des Terres Froides. L’étrange destin dans la totale isolation que choisit Jeanne Leber au fond d’un reclusoir privé, et non dans un couvent, frappe le lecteur. Françoise Deroy-Pineau explique comment la discipline extrêmement dure qu’elle imposa à son corps, par la frugalité la plus absolue, (mais parfaitement « équilibrée ») et un travail sans répit, lui permit de dompter son esprit et de le canaliser dans la contemplation du Tout-Puissant et dans la charité envers ceux de l’extérieur auxquels elle offrait des broderies aux divines volutes, fruit d’une dextérité et d’une inventivité inégalables. Une vie inexplicable avec nos simples mots de mortels car elle recherchait l’Inexplicable, l’au-delà de ce que nous nommerions l’extrême.
Jeanne Leber appartient à la lignée de ces femmes d’exception qui inventeront un catholicisme résolument canadien. Joachim Bouflet nous en dresse un tableau passionnant en se concentrant sur les phénomènes de stigmatisation, qui, comme ailleurs, ne furent pas toujours authentiques. La supercherie de Vitaline Gagnon introduit beaucoup d’humour dans une société courbant sous les lourdeurs d’une Église autoritaire. Bien plus sérieuses, d’autres mystiques, Aurélie Caouette et Marie-Louise Brault, au XIXe siècle, et au XXe, Marie-Rose Ferron, Eva Baye, Georgette Faniel adaptèrent en terre canadienne une forme d’expérience spirituelle spécifique à l’Europe d’autrefois, enrichissant leur Église d’une profondeur dévotionnelle qu’elle perdait au même temps sur le Vieux Continent.
L’analyse que conduit Guy-Robert de Saint-Arnaud de la tentation du sublime et de la manipulation des esprits et des corps démontre la prégnance des conduites extrêmes dans le Québec d’aujourd’hui. Psychanalyste et théologien, il ouvre son texte sur une magnifique définition de l’extrême et du sublime, puis retrace les débats sur l’authenticité ou non de l’expérience du transcendant et de son pouvoir ou non de guérison qui ont divisé le milieu thérapeutique québécois, avant de nous livrer les épreuves de Gabrielle Lavallée, Amazone des temps modernes. Celle-ci subit dans son corps et son âme des tortures insoutenables qu’elle accepta pourtant, offrant en la sublimant la douleur physique pour privilégier son désir de communier avec le maître, parfaite acceptation du martyre intemporel.
Un trait unit la plupart de ces personnages en quête d’infini : leur mission personnelle leur a été dictée par des figures prophétiques au cours de visions merveilleuses qui orientèrent leur destin. La première est « la mission de Canada » qui entraînera Marie Guyard au-delà des océans, vision vraisemblablement modelée on l’a vu, par les Relations des jésuites.
En 1634 Marie se vit en songe se tenir « avec une dame séculière » dans un lieu éminent « au bas duquel il y avait un grand et vaste pays, plein de montagnes, de vallées et de brouillards épais qui remplissaient tout, excepté une petite maisonnette qui était l’église de ce pays-là, qui seule était exempte de ces brumes. » La Sainte Vierge qui contemple, comme elle, ce pays « autant pitoyable qu’effroyable » lui fait alors comprendre qu’elle a un dessein pour elle et cette terre. Plus tard encore une « occupation imaginaire » lui montre qu’elle se tient dans une « ville toute neuve, en laquelle il y avait un bâtiment d’une merveilleuse grandeur [1]. » Cette vision est reprise dans la lettre XVII à son fils qui retrace comment Dieu lui fit voir en songe, par l’intermédiaire de Saint Joseph ou d’un ange, le Canada, et comment Il lui demanda d’y fonder un monastère [2]. La dame séculière sera interprétée comme étant Madeleine de la Peltrie, qui elle-même sera sujette à visions. Il sera amusant de voir qu’ensuite Marie condamnera les visions que recherchent les Indiens au cours de rituels spécifiques comme n’étant que la manifestation de leur profond paganisme et de leur superstition.
En Angleterre plus tard au XVIIIe siècle, Ann Lee, fondatrice des Shakers recevra une vision dans laquelle elle se vit mener son groupe vers une terre nouvelle, un « Paradis sur Terre » qui était bien entendu l’Amérique [3]. Au Québec, Vitaline Gagnon, dans son rôle de mystique, surprendra son entourage encore crédule par ses puissantes visions. Quant à la décision de Brigham Young d’entraîner les saints des derniers jours, ou mormons, dans le Bassin du Grand Lac Salé, elle serait, selon leur mythe fondateur, le résultat d’une révélation divine reçue bien avant d’y parvenir et à laquelle correspondait parfaitement la vue qu’il découvrait depuis les monts Wasatch dominant la Vallée ainsi promise.
À notre époque, Jean de la Trinité ou Grégoire XVII, dont nous analysons le discours millénariste et messianiste, croit intimement aux prophéties communiquées par visions soit à lui-même soit à d’autres messagers, en fait tous les grands maîtres du prophétisme occidental, dont Nostradamus. La plus proche de celle de Marie de l’Incarnation provient de l’anti-pape lorrain Clément XV qui dit au futur Grégoire qu’il voyait le mot Canada : « multiplié plus de vingt fois, ce mot partait dans toutes les directions, et j'entendais : 'Un jour, l'Église partira là-bas, au loin, et répandra sa lumière sur tous les continents [4]. '»
Meneurs d’hommes et prêche apocalyptique

Si de nombreux mystiques se consacrèrent exclusivement à leur rapport intime avec Dieu, telle Jeanne Leber, d’autres prétextèrent cette relation privilégiée pour recruter des disciples et les entraîner dans leur mission. Pour accomplir son œuvre Marie de l’Incarnation s’entoura de sœurs de son ordre, les ursulines et fit construire une maison qui servirait de monastère à ses chères Sauvagesses. Elle régentait ainsi son petit monde pour tenter d’appliquer ses convictions en matière d’éducation. Néanmoins, sur ce point particulier, elle n’avait rien du fanatisme que nous retrouvons chez plusieurs personnages de ce volume. Elle sut en effet toujours garder la tête froide et réalisa qu’on ne pouvait subitement transformer les jeunes Indiennes en de braves Françaises, humilité pédagogique que ses collègues en terres indiennes ne découvriraient que beaucoup plus tard.
Jean de la Trinité, quant à lui, obéit aux injonctions des prophéties annonçant l’imminence de la Fin des Temps pour fonder dans les Laurentides la Nouvelle Rome qui purifierait l’Église catholique à partir de sa communauté des Apôtres de l'Amour Infini fidèle aux vœux de la Vierge à la Sallette et à Fatima. Il remporta un certain succès jusqu’à ce que divers problèmes juridiques ternissent son charisme.
Sa popularité n’atteignit jamais celle de l’un des plus grands prophètes américains, Joseph Smith, le fondateur du mormonisme, ni celle de son successeur Brigham Young. Il fallut à ces deux hommes déployer un talent organisationnel hors du commun pour inciter de simples humains à vaincre sans rechigner des conditions climatiques et matérielles extrêmes. Nous analysons comment ils mirent en parallèle leur épopée à travers les États-Unis avec celle des Hébreux fuyant l’Égypte pour atteindre Canaan. Ils convainquirent les saints des derniers jours qu’ils étaient les Élus de Dieu afin de réussir là où tant d’autres avaient échoué, y compris les Pères Pèlerins pourtant si sûrs de leur mission : construire la Nouvelle Jérusalem ici et maintenant, grâce au travail des terres arides des grands déserts de l’Ouest et une planification urbaine rigoureuse qui accélèrerait le Retour du Christ et la Plénitude des Temps. Les deux hommes appartiennent à la fois à la race des prophètes apocalyptiques de l’Ancien Testament et à celle des bâtisseurs d’empires américains, capables de faire fleurir les déserts.
De surcroît, alors que certaines entreprises missionnaires des siècles passés ne progressent plus, ou ont totalement décliné, celle des mormons poursuit son inéluctable ascension (leur Église est devenue en 2004 numériquement la cinquième aux États-Unis), comme si leur communauté, accompagnée de diverses rivales, telles que celles des adventistes, ou des témoins de Jéhovah, avait pris le relais de celles qui s’essoufflaient en raison des aléas de l’histoire, et de la règle qui veut que, même portées par le feu divin, les aventures humaines finissent toujours par péricliter.
C’est cette même crainte d’un essoufflement de la foi des Américains qui stimule depuis des décennies l’ardeur des zélotes évangéliques qui sembleraient à leur zénith en ce moment de grâce au lendemain de la réélection de George W. Bush (novembre 2004). Leur progression depuis le XVIIIe siècle repose sur une succession de temps forts au cours desquels la prédication s’intensifie, ainsi après la deuxième guerre mondiale, lorsque la guerre froide déclencha dans le pays, en fait dans tout le continent, une intense propagande anti-communisme et anti-athéisme. Le bédévangélisme dont traite Jean-Paul Gabilliet participe du Grand Réveil des âmes, et ici tout particulièrement des jeunes âmes qu’il fallait distraire pour éduquer, et pour enrichir le prophète éditeur. Nous quittons radicalement le monde de l’édition réservée aux intimes pour aborder celui des chiffres astronomiques, ainsi le demi-milliard d’exemplaires vendus par un Jack T. Chick… rivalisant seulement avec le nombre de copies de la bible vendues aux États-Unis. Si les bandes dessinées de Gaines enseignaient les récits bibliques, celles de Pflaum menaient un combat fanatique contre les plaies d’Égypte, rebaptisées soviétiques, que les Américains imaginaient s’abattre sur eux. On retiendra les couvertures magnifiques figurant une pieuvre rouge enserrant la Terre dans ses tentacules ou la Statue de la Liberté surmontée d'une faucille et d'un marteau.
Il est amusant de constater que même dans le monde des comics, les rivalités entre l’Église de Rome et les protestants perdurent. Si les imprécations apocalyptiques d’un Pflaum, catholique, ressemblent à s’y méprendre à celles de l’anti-pape québécois Grégoire XVII, celles d’un Chick en revanche incitent au meurtre des jésuites et des papistes suppôts du communisme.
L’apocalyptisme de Raël, que présente Jacques Cherblanc, n’en serait pas si éloigné, bien qu’il soit pacifique et optimiste : le groupe croit en effet que l’humanité a été créée par les extra-terrestres qui reviennent nous prodiguer leur enseignement et nous faire accéder à l’Âge d’Or du Paradis terrestre. Or, on sait que la croyance aux extra-terrestres s’est considérablement développée pendant la guerre froide, métaphorisant ainsi la crainte d’une invasion communiste. Tous ces objets volants non identifiés, ces voleurs de corps et d’âmes (body snatchers) n’étaient-ils pas tout simplement des communistes en camouflage ? Il est donc intéressant de suivre avec Raël une autre interprétation de ces visiteurs de l’extrême au-delà : ils ne sont plus menaçants, mais bienfaiteurs, et l’humanité ne court pas à sa perte mais au contraire à la pleine réalisation de son potentiel.
Bien que la mission de Raël relève de l’extrême, elle n’est toutefois pas unique, et nous lui connaissons des semblables : la communauté d’Aetherius à Los Angeles qui entretient d’étroites relations avec les ovnis, et un autre groupe installé dans le désert qu’ont fait fleurir les mormons. Non loin du grand Temple de Salt Lake City, dans un jardin dont Brigham Young n’avait pas imaginé la fonction lorsqu’il appliqua son plan en damier aux rivages du Grand Lac Salé, niche une pyramide qui n’a rien à voir avec l’identification des mormons au peuple de Moïse. Il s’agit du quartier général de Summum, un autre culte voué à la croyance aux extra-terrestres qui auraient enlevé le fondateur, alors mormon, pour lui montrer leur empire céleste à la technologie avancée, et lui demander d’en transmettre la connaissance aux humains. Summum pratique aussi la momification (jusqu’à présent seulement d’animaux, aucun de leurs clients humains n’étant encore mort, à l’heure où nous les avons rencontrés), justification de la forme pyramidale aux propriétés bien connues.
Jacques Cherblanc utilise l’exemple de Raël pour interroger la définition de la religion dans notre ère post-moderne, et conclut que cette communauté offre exactement à l’individu nouveau ce qu’il recherche pour satisfaire ses désirs passagers, son hédonisme, sans exiger de lui une adhésion totalisante et exclusive. Il n’y aurait finalement que la mission que Vorilhon-Raël raconte à ses fidèles qui relèverait de l’extrême, l’application que font les adeptes de cette manifestation du réenchantement du monde la ravalant quelque peu au niveau de l’utilitaire transitoire.
Missions politiques de l’intérieur

Le terme de mission désigne aussi le pouvoir que certains individus ou certains groupes se donnent d’entreprendre quelque chose qu’ils considèrent comme noble et indispensable à eux-mêmes et au monde, sans nécessairement relever de l’ordre divin. C’est ainsi que nous avons observé comment en politique, les Indigènes, les politiciens ainsi que le gouvernement canadien s’investissaient dans des missions qui à bien des égards relevaient de l’extrême.
Les articles de Sylvie Guillaume et de Paul Lucardie interrogent l’histoire des partis politiques canadiens pour détecter les tentations d’extrémisme derrière la façade quelque peu lénifiante que le pays aime présenter aux regards extérieurs. Le premier opte pour le terme « fièvres extrémistes » pour indiquer la brièveté du phénomène et sépare l’extrémisme dans le discours seul de l’extrémisme dans le passage à l’acte.
Le bipartisme canadien, à l’image du britannique ou de l’étatsunien, étouffe les velléités de débordements, mais n’interdit pas l’émergence d’un très grand nombre de mouvements protestataires qui prennent régulièrement des positions extrêmes, ainsi les groupes socialistes dans l’entre-deux-guerres, ou le Crédit social en Alberta et au Québec avec Caouette. Ce sera surtout le nationalisme et le néo-nationalisme québécois qui produiront un discours extrémiste. On y retrouve notamment l’abbé Groulx dont Grégoire XVII ne manquera pas de s’inspirer pour élaborer son idéologie de la nation catholique, cela même que l’abbé appelait « la race » noble, puis le Bloc populaire. Le Front de Libération du Québec fut en revanche une véritable organisation extrémiste qui ne recula pas devant le recours au terrorisme pour réaliser sa mission, l’indépendance du Québec. Quant au Parti québécois, il ne conserva pas longtemps son discours anti-anglophone et anti-allophone extrémiste, et le danger pourrait maintenant venir des réactions allergiques des autres Provinces vis-à-vis d’un Québec récalcitrant, exigeant, refusant le jeu communautaire.
Le second article se concentre sur un grand nombre de formations politiques, notamment le Parti Libertarien du Canada, le Parti de l’Héritage Chrétien et le Parti Marxiste-Léniniste du Canada et analyse les résultats électoraux pour suivre les évolutions au plus près. Il compare notamment le discours du Bloc Québécois et du Parti Réformiste. Même si dans le contexte canadien les prises de position de ces partis sortent de la « normalité » et de la modération, ils ne sont en rien extrémistes au sens européen du terme. Les missions dont s’investissent les politiciens pour faire évoluer leur pays selon leurs convictions finalement ne menacent que très rarement le consensus social qui soude les citoyens canadiens, comme aux États-Unis, puisque les seules véritables tentations révolutionnaires demeurent totalement marginales.
Missions politiques internationales

Si dans une partie précédente nous avons assisté à la soumission des tribus indiennes sous la férule d’ardents missionnaires, ici nous constatons que justement l’enseignement des pères chrétiens a porté ses fruits, au moins dans un domaine : en effet, alors qu’il semble que la conversion au christianisme des Indigènes ne soit pas totalement réalisée car ils ont le plus souvent conservé parallèlement leur rites traditionnels ou les ont incorporés au rituel catholique notamment, leur conversion à la culture éducative et judiciaire occidentale est, elle, achevée.
Ceci est particulièrement explicite dans l’étude qu’a menée Dimitri Portier des procès intentés par les Innu du Labrador. Il s’agit bien réellement d’une attaque en règle menée par une tribu contre l’OTAN, visée extrême s’il en est. À première vue, le résultat serait mitigé, voire piteux, et les Innu toujours exploités. David peut parfois gagner contre Goliath, mais peut-être pas lorsque Goliath prend les traits des grandes armées occidentales face à de simples juristes voulant protéger la survie des caribous. Ici encore nous nous retrouvons devant la situation des débuts de la colonisation : on l’a dit, le Canada a bien davantage respecté ses peuples indigènes, peut-être en partie parce que le climat et la qualité des sols de nombreuses régions n’attisaient guère cette « faim de terres » caractéristique des colons étatsuniens, et aujourd’hui encore les tribus peuvent vaquer à leur guise sur de vastes étendues, sans pour autant vivre suffisamment bien pour se passer des aides fédérales. Les Innu connaissent de nos jours des conditions sociales très préoccupantes, mais ils jouissent encore d’un immense territoire. C’est cette liberté qui fut restreinte par la militarisation du Labrador, parfait avant-poste pour aller sauver l’Europe d’abord du nazisme puis du communisme.
Comme pour son implication au sein de l’ONU, le Canada se devait de prouver son utilité au sein de l’OTAN en mettant sur la table des offres inégalables ailleurs. Ainsi le gouvernement d’Ottawa permit aux armées alliées de tester les vols à basse altitude, tests impossibles à effectuer au-dessus des autres États membres du pacte qui étaient bien plus densément peuplés. C’est pourquoi oser, quand on n’est qu’une petite communauté d’autochtones, intenter un procès à l’OTAN est faramineux, mais la conclusion que nous livre Dimitri Portier l’est tout autant : combien de pays en effet accepteraient comme l’a fait le Canada par les Accords de l’Approche Commune de laisser les tribus plaignantes gérer l’utilisation de leur espace aérien ?
Deux autres études portent sur des problèmes similaires. Jérôme Vergnaud a étudié l’installation d’une communauté d’Inuit dans l’extrême Nord canadien et montre à quel point elle a souffert de son exil. Ici le gouvernement avait besoin de protéger les extrémités de son immense territoire, et son armée ne pouvant occuper tout le terrain, la solution consistait à le peupler. Les Inuit n’habitaient pas tant au nord. Certes, on ne les força pas au bout du fusil à partir, on le leur suggéra fortement. S’installer à 2000 kilomètres de chez soi n’est certes pas un exploit en Amérique du Nord, en tout cas dans les zones tempérées. Toutefois, dans cette affaire, c’était un sacrifice exceptionnel et il compromit durablement la survie de la communauté.
On sait que ce fut en grande partie ce même désir de protéger les marges de la nation qui poussa le gouvernement canadien à accorder son autonomie politique au Nunavut. Se sentant davantage chez eux, les Inuit auraient à cœur de protéger leurs terres menacées autant en réalité par la présence grandissante des militaires américains et de leurs patrouilles dans l’Océan Arctique, que par celle des Soviétiques puis des Russes. En outre, par cette dévolution du pouvoir politique, le Canada pouvait se présenter en champion des droits des peuples indigènes, ce qu’il est effectivement bien davantage que tout autre pays de par le monde. Cependant il faut savoir mesurer les divers enjeux d’une telle question.
Florence Cartigny les explore précisément dans son analyse de l’implication du Canada au sein de l’ONU. Elle pèse les tenants et les aboutissants de la sortie de ce pays de son isolationnisme. Agir de l’intérieur de l’ONU ne pouvait que rehausser la réputation de ce pays, qui devenait dès lors synonyme de force d’équilibre et de compréhension au milieu du combat des géants, ce modèle de modération dont nous parlions en introduction. Cela avait également le mérite de lui permettre d’affirmer son autonomie vis-à-vis de la mère patrie, la Grande-Bretagne, figure matriarcale dont il devait sans cesse demander l’avis avant de s’engager, ou pire encore, à qui il devait obéir et payer son tribut en vies humaines lors de guerres qu’il n’avait pourtant ni déclarées ni souhaitées.
Malheureusement, en dépit ou plutôt en raison de son étendue géographique, le Canada fait parfois figure d’albatros, ses ailes de géant l’empêchent de marcher : en effet, une fois sevré de sa mère, il tomba sous la coupe d’un ogre plus redoutable, son voisin du Sud. On le voit bien lorsque dans les gravissimes crises qui menacèrent l’équilibre du monde pendant la guerre froide, le Canada dut s’efforcer de ne pas froisser Washington. Néanmoins, là encore, il sut imprimer sa marque aux négociations, forçant le respect de tous, et en outre, en échange de son obéissance, il passait sous le fameux parapluie atomique des États-Unis, à moindres frais et ressortait presque indemne des missions extrêmes dans lesquelles il s’était lancé.
Ainsi l’Amérique du Nord, qui fit ses débuts de continent occidental en tant que terre de missions, continue-t-elle à répondre à l’appel d’ordres de missions en tout genre, à s’inventer des croisades au nom de Dieu, des dieux, des pouvoirs d’ici-bas autant que de l’au-delà. Aujourd’hui comme hier, ses habitants témoignent en permanence sous nos yeux de leur impératif besoin de s’investir dans des missions extrêmes afin d’accoucher de mondes qui auraient été en gestation de l’autre côté de l’Atlantique avant la grande traversée, ou dans leurs esprits fertiles indélébilement marqués par la genèse de leurs deux grandes nations.
Ce qui est extraordinaire c’est que dans aucun des cas examinés ici il ne se sera agi de mission impossible. Les acteurs, religieux ou laïques, ont tous été tentés par le sublime, les limites les plus reculées, mais ils sont tous passés à l’action pour véritablement réaliser ici-bas les mondes que ces visions leur faisaient entrevoir.
[1] Dom Albert Jamet (dir.), Marie de l'Incarnation, Ursuline de Tours, fondatrice des Ursulines de la Nouvelle France. Écrits spirituels et historiques, tome II, Québec et Paris, L'Action sociale et Desclée de Brouwer (1930), volume II, 303-304, 348.
[2] Dom Guy-Marie Oury (dir.), Marie de l’Incarnation, Correspondance, Sablé sur Sarthe, éd. de Solesmes (1971), 42-43.
[3] Voir l’article de S. Cerisier in B. Rigal-Cellard, Sectes, Églises, Mystiques…
[4] Jean Côté, Père Jean de la Trinité, Prophète parmi les hommes, St-Jovite, Éditions Magnificat (1991), 144.
|

