|
[361]
Jules Duchastel * [1]
sociologue, professeur de sociologie, UQAM
“Conclusion.
La démocratie entre la crise de l’État
et la revanche des sociétés.”
Un texte publié dans l'ouvrage sous la direction de Jules Duchastel et Raphael Canet, Crise de l’État, revanche des sociétés, pp. 361-402. Athéna, 2006. Collection : Mondialisation, citoyenneté, démocratie, 402 pp.

- Introduction
-
- Dynamique de la démocratie : entre liberté et égalité
- Crises de l’État et de la démocratie représentative
-
- Crise de souveraineté
Crise de légitimation
- Crise de régulation
- Crise de la représentation
-
- Revanche des sociétés et nouvelles pratiques démocratiques
-
- Réforme démocratique
Innovation démocratique
- Expérimentation démocratique
-
- Conclusion
Introduction

L'ensemble des thèmes abordés dans le présent ouvrage — la transnationalisation du système international, la remise en question de l'intégrité territoriale des États-nations, la politisation de l'espace mondial et la reviviscence de la société civile dans le double contexte de la participation aux instances de gouvernance ou de leur contestation —, pointe dans la direction d'un renouveau des pratiques démocratiques. L'édifice institutionnel mis en place dans la modernité tend à se fissurer de toutes parts, entraînant à la fois une remise en question des institutions politiques et l'invention de nouvelles pratiques visant à redéfinir la démocratie. On peut parler d'un paradoxe démocratique pour décrire cette situation. D'un côté, l'idée de démocratie semble s'être imposée dans le discours et les aspirations de l'ensemble des acteurs sociaux, fussent-ils gouvernementaux, corporatifs ou associatifs. Même si la pratique ou les institutions souffrent d'un déficit démocratique, variant en nature selon les situations nationales, locales ou globales, le discours social et politique se réclame de ses principes, sinon de ses vertus. Dans l'économie géopolitique de l'après-guerre froide et de la fin des dictatures, la démocratie est redevenue le maître mot de la pratique politique. Évidemment, son invocation ne prend pas le même sens dans tous les contextes et il est facile d'en contester la réalité ou l'authenticité dans un ensemble de situations particulières. Tout de même, le système des Nations Unies a réussi à imposer cette valeur comme principe de légitimité ultime, aussi bien dans son propre fonctionnement [362] que dans celui de chacune des unités qui le composent. D'un autre côté, la démocratie semble traverser une crise profonde. Au sein même des institutions politiques nationales ou internationales, elle est l'objet d'une vive critique, soit parce qu'elle est pur simulacre, soit parce qu'elle est détournée de son fondement par un ensemble de dérives institutionnelles. C'est le modèle fondamental de la démocratie qui est remis en cause en raison de son détournement au profit de logiques de régulation alternatives, qu'elles relèvent du pouvoir exécutif, de la technocratie ou du judiciaire. La démocratie est surtout l'objet d'une critique de légitimité. Si l'idée de la démocratie est revendiquée par tous, son institutionnalisation pose problème. Il en découle un ensemble de revendications en provenance des sociétés pour un approfondissement de sa pratique et un rétablissement de sa légitimité. À la représentation, comme modèle de fonctionnement des institutions démocratiques, se substitue la participation en tant que condition de réalisation de son idéal.
Avant de parler de la crise de l'État et de la démocratie libérale et d'examiner les pratiques démocratiques émergentes, il nous semble nécessaire de comprendre la dynamique de la démocratie dont l'idée s'institutionnalise progressivement à partir des révolutions modernes [2]. Nous soutiendrons que, dans la modernité, l'idée démocratique est inséparable de l'idée libérale. Nous tenterons de montrer comment les principes de liberté et d'égalité constituent les éléments fondamentaux de la démocratie et que leur articulation toujours différente donnera lieu à des formes particulières de l'État, l'État libéral privilégiant la liberté, l'État social donnant une plus grande place à l'égalité. Nous tenterons de comprendre comment la transformation progressive de l'État qui se manifeste par la politisation croissante du social et la socialisation accrue du politique, conduit à une transformation du principe de légitimité au fondement de l'institution démocratique. Dans une deuxième partie, nous présenterons le dispositif institutionnel de l'État démocratique et montrerons comment ses éléments fondamentaux entrent successivement en crise. Nous décrirons d'abord la crise de souveraineté qui remet en cause les rapports entre système de l'État-nation et système international, puis la crise de légitimation qui questionne la relation entre l'État et la communauté politique, ensuite la crise de régulation qui ébranle la capacité d'action de l'État sur la société, enfin, la crise de représentation qui fragilise les liens de la société et de la communauté politique. Dans une dernière partie, nous [363] examinerons les diverses réactions des sociétés face à ces crises institutionnelles. Du double point de vue des nouvelles formes de régulation et de la redéfinition des principes de légitimité démocratique, nous recenserons les diverses pratiques démocratiques réformatrices ou innovatrices. Nous insisterons sur les options offertes aux acteurs de la société civile qui se présentent comme les nouveaux sujets politiques.
Dynamique de la démocratie :
entre liberté et égalité
- La démocratie c'est le règne de la volonté du peuple, mais d'un peuple fait d'hommes qui ont des droits [3].

La démocratie nous semble au centre de la problématique des transformations institutionnelles qui ont cours aujourd'hui et de l'évolution des pratiques innovatrices. Que l'on interroge les nouvelles formes de régulation qui s'imposent dans un ensemble de lieux extérieurs à la logique proprement étatique ou que l'on regarde les revendications de droits citoyens qui se manifestent dans ces nouveaux espaces politisés, la question de fond demeure celle de la mise en œuvre effective d'une démocratie authentique. Nous devons donc examiner la démocratie à la fois du point de vue de sa complexité et de celui de son évolution à travers le temps. Sa complexité réside avant tout dans le fait qu'elle renvoie à au moins trois niveaux de compréhension. La démocratie est d'abord une idée au sens premier de l'idéologie, c'est-à-dire une visée normative sur la façon de concevoir la vie commune. En tant qu'idéal à réaliser, elle est l'objet d'un travail assidu d'argumentation et d'interprétation par l'ensemble des acteurs sociaux. La démocratie est ensuite une institution. Elle se traduit dans des régimes institutionnels particuliers qui visent à la mettre en œuvre. En ce sens, elle n'est déjà plus l'idée abstraite et universelle convoitée par tous, elle devient application contingente d'un principe qui la transcende. C'est en ce sens que l'on peut dire que l'institution démocratique est ébranlée par la crise du système politique de l'État-nation. Enfin, la démocratie est une pratique. L'institution démocratique incarne l'idée de démocratie mais, dans la pratique, la participation et la représentation des citoyens ne sont pas toujours assurées. C'est ainsi que l'on peut parler d'une crise de légitimité de la démocratie qui se manifeste par la faiblesse des dispositifs de représentation et de participation des citoyens.
Il importe également de réfléchir à l'évolution qu'a connue la démocratie depuis sa mise en œuvre dans les régimes politiques modernes. On peut penser cette évolution de manière plus ou moins théorique ou pratique. D'un côté, la démocratie d'abord pensée en tant que catégorie [364] universelle abstraite prendra du temps à se traduire dans l'ordre du particulier et du concret. À l'image des droits de la personne ou de la citoyenneté, la démocratie détient sa force de sa portée universelle, mais cela ne veut pas dire qu'elle est mise en pratique dans les sociétés réelles. D'un autre côté, c'est à travers justement ses modalités d'institutionnalisation variables et sa mise en pratique que l'on pourra juger de son existence réelle. Dire que la démocratie est une idée permet, au départ, de placer la discussion au-delà d'une description des divers dispositifs institutionnels propres à chaque pays où a été instaurée la démocratie et, ensuite, de mettre au jour les principes mêmes qui ont prévalu à l'institutionnalisation moderne de la société. Il ne s'agit pas, dans le présent contexte, de faire un retour sur la philosophie politique qui, depuis la Renaissance jusqu'au XVIIIe siècle, a forgé progressivement les idées qui allaient se traduire dans les institutions politiques modernes. Il faut, sans contredit, souligner toute l'importance de ces philosophes qui ont imaginé, avant même leur instauration, les principes de gouvernement qui découlent de l'idée de démocratie. Cette idée démocratique ne revêt cependant pas une forme universelle qui transcenderait les divers types de société, au contraire elle doit toujours être interprétée dans son ancrage institutionnel et pratique. Ainsi, nombre d'auteurs [4] ont montré que la démocratie athénienne se distingue fondamentalement de la démocratie moderne. Nous retiendrons trois différences essentielles. En premier lieu, la citoyenneté grecque exclut a priori des catégories de personnes, telles que les femmes et les esclaves. La démocratie est donc réservée à un cercle restreint de sujets politiques. On pourrait dire la même chose des démocraties naissantes en Occident à une différence près : l'exclusion des catégories telles que les femmes et les non-propriétaires demeure une question ouverte susceptible d'une politisation ultérieure. Selon Marshall [5], l'extension du statut de citoyen est inscrite dès le départ dans la dynamique des droits tels qu'ils se développent aux XVIIIe et XIXe siècles. La seconde différence est que le système athénien ne distingue pas la société civile et la société politique [6]. Il n'existe donc pas un espace d'autonomie civile, la cité grecque étant avant tout une cité politique. Cette absence de la société civile comme lieu d'épanouissement de l'individu autonome entraîne la troisième différence. Celle-ci tient au fait qu'il n'y a pas de reconnaissance de la personne humaine comme sujet de droits. La démocratie athénienne est une démocratie où le pouvoir [365] s'exerce collectivement, mais la personne n'y a pas place en tant que sujet autonome.
Le propre de l'idée démocratique dans la modernité, c'est d'être inextricablement associée à l'idée libérale, c'est-à-dire qu'elle pense l'égalité citoyenne dans le contexte de la liberté et de l'autonomie des individus. La tradition sociologique montre comment la modernité s'éloigne progressivement des sociétés traditionnelles dans un double processus de différenciation et de spécialisation institutionnelles qui prendra forme dans trois sphères principales : politique, économique et culturelle [7]. Chacune de ces sphères s'institutionnalise progressivement autour d'une contradiction principale et d'un principe fondamental. La sphère politique tentera de résoudre le problème des rapports de pouvoir en mettant en œuvre le principe démocratique, la sphère économique mettra de l'avant la liberté comme principe régulateur des rapports de classes et la sphère culturelle instituera les rapports de genres et les rapports culturels sous le couvert de l'autonomie [8] et de la civilisation [9]. Ces trois principes ont leur propre dynamique, mais ils entrent en relation à la fois de réciprocité et de contradiction. On peut ainsi dire que la réalisation du principe démocratique dépend de l'existence préalable des principes de liberté et d'autonomie qui se trouvent à la base des institutions économiques et culturelles modernes. La liberté nécessaire au développement du capitalisme et l'autonomie au centre des processus d'identité et de civilisation moderne représentent des conditions nécessaires au développement d'un système démocratique fondé sur l'égalité citoyenne. Les citoyens doivent, en effet, jouir des libertés civiles s'ils veulent pouvoir entrer sur la scène politique pour y jouer leur rôle démocratique. Ces mêmes citoyens doivent se concevoir comme des individus autonomes détenteurs de droits et d'obligations pour remplir ce même devoir démocratique. Il va sans dire que l'opposition entre liberté et égalité nourrit une dynamique contradictoire dans le développement des deux institutions prépondérantes de la modernité, le marché et l'État et dans l'articulation des sphères privée et publique.
En effet, le processus d'institutionnalisation économique repose essentiellement sur le règne de la liberté, alors que l'aspiration démocratique qui est au centre de l'institutionnalisation politique vise à établir les conditions de l'égalité. Peut-on pour autant dire que ces deux processus sont absolument contradictoires ? Il faut regarder les choses d'un côté à la fois. Il faut d'abord déterminer en quoi et jusqu'où la démocratie repose sur l'idée libérale. Nous avons vu que la démocratie athénienne se distingue [366] justement de la démocratie moderne en ce qu'elle ne connaît pas les institutions libérales de la société civile (marché et espace associatif). Par contre, la démocratie moderne n'émerge et ne peut émerger que dans un contexte de libéralisation économique et d'autonomie individuelle. On ne peut concevoir de processus démocratique, au sens moderne du terme, que dans le contexte de l'autonomisation des individus déliés des contraintes qui pesaient sur eux dans le contexte de la tradition. Les individus ne peuvent devenir citoyens que s'ils sont libres et le mouvement d'autonomisation individuelle s'est réalisé dans un contexte de libéralisation de l'économie. Les deux aspects du libéralisme doivent donc préexister pour qu'un régime démocratique puisse s'instaurer. Cela ne veut pas dire cependant que les conditions d'existence concrètes de chaque individu dans une société correspondent au modèle de liberté avant que puissent surgir des institutions démocratiques. Le passage à l'institution s'effectue le plus souvent de manière progressive. Ainsi, les droits citoyens se développent concrètement sur une période de plus de deux siècles. Marshall [10] montre bien le double mouvement d'extension progressive des droits à l'ensemble des catégories de citoyens et le mouvement parallèle d'élargissement de leur couverture (des droits civils au XVIIIe siècle, aux droits politique au XIXe siècle et finalement aux droits sociaux au XXe siècle).
Si l'idée libérale est nécessaire au développement de la démocratie, en quoi et jusqu'où le libéralisme doit-il à son tour s'appuyer sur la démocratie [11] ? Le libéralisme n'a pas uniquement besoin de la démocratie pour assurer les conditions élémentaires de la production et de l'échange ainsi que l'ordre et la sécurité. Il a besoin de la démocratie justement pour se protéger du pouvoir. Les formes institutionnelles de cette protection ont pu varier grandement (il suffit de comparer les États-Unis et la France), mais l'idée démocratique s'est établie dans un contexte de protection des individus contre les pouvoirs exorbitants de l'État monarchique. Les institutions démocratiques assurent l'espace de liberté nécessaire au développement de l'économie libérale. Mais si la protection à l'égard du pouvoir était requise, la plupart des philosophes ont également recherché les moyens de protéger le pouvoir contre la dictature du peuple [12]. Car si les pouvoirs autocratiques étaient redoutés, la puissance d'un peuple qui abuserait de [367] sa force était tout aussi à craindre. Un ensemble de dispositifs institutionnels (limitation du suffrage, redoublement des Chambres, limitation des pouvoirs législatifs, séparation des pouvoirs) étaient autant de garde-fous contre le danger d'une prise de contrôle par le peuple réel. Ainsi le principe d'égalité censé assurer l'espace de liberté a été, dès le départ, contraint par un ensemble de règles limitatives. Le système démocratique sert alors de double rempart contre l'arbitraire d'un pouvoir étatique fort et contre la mise en œuvre de sa propre logique de participation égalitaire au pouvoir.
En son point de départ, la démocratie est avant tout liée à l'idée libérale au sens où ce sont les libertés qui prédominent sur toute idée d'égalité. Tous les acteurs sociaux, quel que soit leur rang, bénéficient cependant de cette libération des contraintes. En ce sens, la démocratie n'est pas nécessairement illégitime à ses débuts, même si les conditions de sa réalisation pleine et entière sont loin d'être réunies. La jeune démocratie vise une institutionnalisation minimale des appareils d'État afin de protéger la société civile contre l'État, mais aussi ce dernier contre la société civile. La démocratie prend ainsi la forme institutionnelle de l'État libéral. Elle devient pour autant l'instrument des élites. La conception de la plupart des philosophes de la démocratie, se cantonnant dans l'ordre des abstractions, renforce cette conception limitée de la démocratie libérale. Cette conception élitiste de la démocratie insiste sur le fait que le peuple est et doit être représenté par des personnes compétentes. Au point de départ, l'idée même de parti est une idée saugrenue et le sort de la démocratie repose entre les mains de l'élite.
La démocratie comme institution moderne se situe donc inévitablement dans la dialectique de la liberté et de l'égalité, l'une n'allant pas sans l'autre. La démocratie, s'étant d'abord développée dans la forme libérale de l'État, évolue au cours du XXe siècle avec l'apparition d'une forme socialisée de l'État. C'est donc un nouvel équilibre entre liberté et égalité qui caractérise cette forme de démocratie « gouvernante [13] ». Par contraste avec la démocratie libérale qui serait « gouvernée » au sens où les hommes qui l'habitent sont pris en charge par une élite dirigeante et où les citoyens n'aspirent pas à la participation, se soumettant au pouvoir de manière disciplinée sous la forme du civisme, une nouvelle forme de démocratie « gouvernante », impliquant la participation des citoyens à la délibération et à la prise de décision, émerge dans le contexte de l'État-providence. À [368] mesure que se développe l'universalisation de la franchise, du droit de vote, de plus en plus de citoyens, justement en tant qu'hommes « situés », vont participer au processus démocratique et infléchir les politiques de l'État en faveur d'une extension des droits sociaux. La démocratie gouvernée était fondée sur l'écart entre État et société, cette dernière se défendant de l'État et l'État de la société. La socialisation de la démocratie implique une resocialisation de l'État, donc une abolition de cette césure instaurée par le libéralisme. La conséquence en est cependant un affaiblissement de l'autonomie des individus. À partir du moment où la démocratie se soucie des différents problèmes sociaux et tente d'y remédier, elle apporte dans son sillon une plus grande part d'intervention et une plus faible part de liberté [14]. La propension de la modernité à politiser l'ensemble des rapports de pouvoir ou de domination, en somme de politiser le social, trouve sa réponse dans une socialisation de l'ordre politique qui tend à envahir toutes les sphères de l'existence.
Il y a au moins deux manières d'apprécier ce problème. D'un côté, on peut croire que la démocratie arrive à son terme, c'est-à-dire qu'elle réalise pleinement son idée initiale qui est, selon l'expression d'Abraham Lincoln, l'universalisation de la participation au gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Il est possible de voir les choses ainsi dans la mesure où l'idée de démocratie ouvre sur cette autodétermination de la société qui est la base même de l'idée de modernité. D'un autre côté, on peut aussi comprendre que le peuple dont il s'agit n'est pas le même. Le peuple ou la nation des philosophes correspondent à une idée transcendantale. Il s'agit d'un principe de légitimité plus que d'une réalité sociologique. Il y a une différence fondamentale, dans cette conception, entre peuple/nation et société. La société est ce qui relève de la réalité des rapports sociaux et des formes institutionnelles qui les encadrent. Le peuple ou la nation en sont les figures symboliques. Selon cette conception, le rabattement du peuple sur la société équivaut à la perte du principe transcendant de légitimité politique [15]. On se trouve donc entre deux dangers. D'un côté, le refus de plus d'égalité, à travers une socialisation de l'État, réduit le potentiel émancipateur de la démocratie ; de l'autre, la socialisation [369] du politique fragmente et affaiblit les figures symboliques de l'unité de la société, le peuple et la nation. La question posée est celle de la sortie de la modernité. La dynamique instaurée par la confrontation entre deux principes d'institutionnalisation, relativement opposés, aboutit à une socialisation dans les faits du processus démocratique. On peut bien vouloir le déplorer, la réalité montre l'évolution des systèmes démocratiques qui ont par ailleurs suivi des cheminements différents selon les types d'État social qu'ils ont développés [16], vers une prise en charge de plus en plus large de l'ensemble des conflits sociaux.
Le tableau I résume cette dialectique de la démocratie. Sur l'axe vertical, la démocratie se présente successivement comme une idée, comme une institution et comme une pratique. Sur l'axe horizontal, la démocratie est en tension permanente entre universalisme et particularisme. Sur le plan de l'idée, la dialectique de la démocratie se manifeste dans la tension entre liberté et égalité, principes au fondement de l'institutionnalisation politique des sociétés modernes. La liberté représente la condition d'existence d'une société civile indépendante de l'État qui préside au déploiement du marché, de l'espace public et de la sphère de l'autonomie individuelle. L'égalité apparaît comme la condition de la participation et de la représentation de l'ensemble des citoyens dans le processus démocratique. Comme on l'a vu, ces idées sont inégalement présentes à la naissance de la démocratie moderne, mais en même temps toutes les deux sont nécessaires. La liberté manifeste davantage la tendance universaliste associée aux droits universels de la personne. L'égalité, au contraire, ne peut faire abstraction de la situation concrète de l'individu « situé » et manifeste plus naturellement la tendance particulariste. Nous avons montré que les deux principes s'incarnent chacun de manière prépondérante dans la forme libérale et la forme sociale de l'État. La forme libérale laisse plus d'espace au jeu de la concurrence sous toutes ses formes, faisant plus ou moins abstraction de l'inégalité des chances. La forme sociale vise, au contraire, à pallier les inégalités en introduisant des mesures destinées à répondre à un ensemble de besoins. Cette dichotomisation des formes de l'État ne sert qu'à illustrer les cas extrêmes et sous-estime considérablement la variété des formes concrètes qui marient de manière différente les principes de liberté et d'égalité.
La dialectique des idées de liberté et d'égalité se traduit au niveau des pratiques démocratiques dans des conceptions différenciées de la citoyenneté, de la nation et de la démocratie elle-même. Selon cette tension, il existe une première opposition entre citoyenneté représentée et citoyenneté participante. En effet, la forme de l'État libéral met de l'avant une citoyenneté abstraite, favorisant sa représentation au détriment de sa participation. [370] En découle une conception élitiste de la démocratie imaginée par les philosophes de la modernité. Cette conception de la démocratie administrée par les élites est aujourd'hui encore défendue dans les milieux conservateurs [17]. Par opposition, la forme sociale de l'État encouragerait la participation démocratique en redonnant aux citoyens concrets les moyens de leur implication dans le processus politique. Cette opposition entre deux conceptions de la citoyenneté se traduit dans l'opposition décrite par Burdeau [18] entre démocratie gouvernée et démocratie gouvernante. La démocratie gouvernée renvoie à la conception libérale d'un gouvernement élitiste et la démocratie gouvernante accorde plus de poids à sa base démocratique. Même si, comme nous l'avons vu, la démocratie gouvernante tend à se bureaucratiser, elle n'en aménage pas moins une place plus grande aux intérêts du grand nombre. Deux conceptions de la communauté politique s'affrontent enfin selon la même ligne de partage. Alors que, du côté
Tableau 1
Dialectique de la démocratie
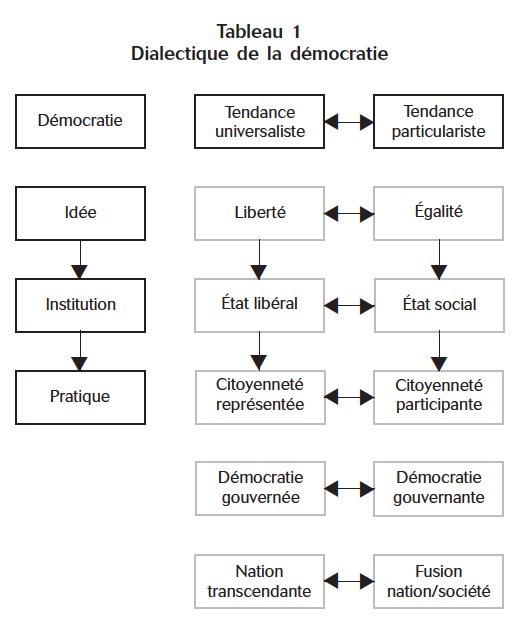
[371]
universaliste, on continue d'entretenir l'idée d'une nation transcendant l'ensemble des différences entre les membres de la communauté, du côté particulariste, on conçoit que la nation doit représenter l'ensemble des composantes de la société, entraînant la fragmentation de l'identité nationale et du corps social.
Crises de l'État
et de la démocratie représentative
- Quels sont, à l'ère de la mondialisation, les fondements de la domination légitime [19] ?

Nous avons insisté jusqu'à présent sur le rééquilibrage continu entre principe d'égalité et principe de liberté dans l'évolution des institutions démocratiques. Nous avons rappelé que les deux formes idéal typiques de l'État [20], libérale et sociale, ont accordé une part plus ou moins prépondérante à chacun de ces principes. Nous avons à peine évoqué le problème des formes concrètes de l'institutionnalisation politique des sociétés modernes, encore moins la question des divers types de régime démocratique. C'est à dessein que nous avons poursuivi la réflexion au niveau des principes fondamentaux qui circonscrivent l'architecture institutionnelle de la modernité. C'est à l'examen étendu des dimensions de cette architecture que nous procéderons maintenant afin de donner sens à l'étude des crises qu'elles connaissent aujourd'hui. Le schéma simplifié (voir figure 1) a pour unique but de rendre compte de cette architecture idéale formée de quatre ordres institutionnels et des relations fonctionnelles qu'ils exercent les uns sur les autres.
Trois institutions sont au cœur du projet d'autodétermination de la modernité. Elles constituent les conditions d'effectivité d'un système visant à s'autoproduire en dehors de toute transcendance extrinsèque. Les deux premières institutions sont celles déjà discutées. Nous avons, en effet, rappelé qu'un système démocratique moderne repose sur l'existence de deux entités indépendantes, la société et l'État. La société doit être protégée de l'État et, dans les termes plus restrictifs de la pensée libérale, l'État de la société. Cela veut dire que d'un côté, il doit exister un espace de droits imprescriptibles susceptibles de protéger et d'habiliter à la fois les citoyens et que, de l'autre, le système politique ne doit pas être l'objet d'une constante pression en provenance des intérêts disparates de la société. La société est ici comprise comme société civile, c'est-à-dire comme espace de déploiement de l'autonomie aussi bien sur les plans économique, culturel [372] ou intime [21]. L'État, quant à lui, est à la fois le gouvernement et l'administration de la chose publique. L'État, dépendamment de la forme qu'il emprunte, assure une fonction plus ou moins étendue de régulation de la société.
figure 1
Architecture des institutions politiques modernes
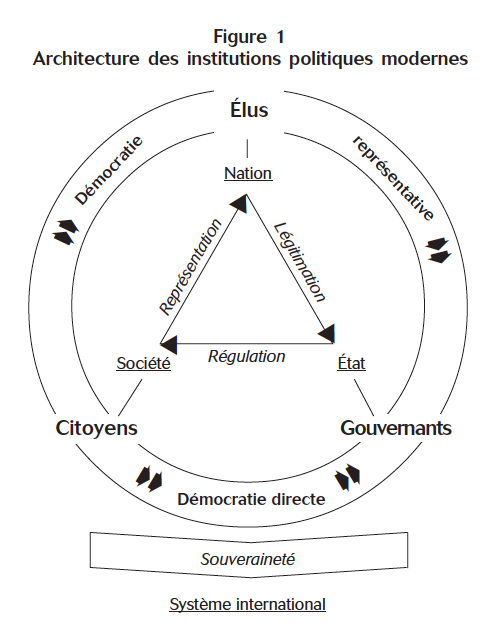
Un troisième terme est cependant nécessaire à l'économie générale de ce dispositif institutionnel. Si l'État est dépourvu de toute transcendance externe, il lui faut trouver un principe de légitimité intrinsèque dans l'exercice de son pouvoir. La nation représente la figure unifiée de la communauté politique au nom de laquelle l'État est légitimé d'agir. En effet, la modernité substitue au monarque une communauté, plus ou moins imaginée [22], comme support d'une volonté générale que l'État serait chargé de traduire en action. Deux fonctions supplémentaires unissent ces institutions. La première fonction est précisément la légitimation de l'État par la [373] nation. Cette fonction s'est traduite dans la conception maintenant universelle de l'État-nation. Une autre fonction unit la société et la nation. La société entre en rapport avec l'État par la médiation de la nation. La société civile, berceau de la citoyenneté, se projette dans l'idée du peuple formé de citoyens dont la communauté forme nation. La société est donc représentée dans la nation. Nous passons ici sur la complexité plus ou moins grande de cette communauté politique ou de ce peuple national. Ne mentionnons que le contraste énorme qui peut exister entre une représentation unifiée d'une nation de citoyens indifférenciés comme le proclame l'idéologie républicaine et une représentation multiculturelle d'un peuple et d'une nation dont le principe d'unité deviendrait paradoxalement la diversité, comme c'est devenu le cas au Canada.
Tel que l'évoque le schéma, le processus démocratique épouse en quelque sorte ce dispositif institutionnel en traduisant sur le plan des acteurs chacune des institutions et des relations qui les unissent. Selon des modalités diverses, les régimes démocratiques instituent les citoyens en électeurs comme ultimes décideurs de leur avenir commun. Les citoyens se feront représenter par des élus (ou, à l'inverse, représenteront leurs semblables) qui, seuls, seront en mesure de traduire concrètement le principe de légitimité dont est investie la nation. Les élus représentent le peuple de citoyens, de manière plus ou moins adéquate, auprès des gouvernants dans la mesure où cette expression englobe aussi bien le gouvernement que les administrations publiques. Nous avons ajouté dans le schéma une alternative à ce modèle de démocratie représentative qui s'exprimerait dans une relation directe entre citoyens et gouvernants. Nous aurons l'occasion de revenir plus loin sur cette question. Il suffisait ici d'indiquer que tout projet de démocratie directe escamote la médiation par la nation et ses représentants élus et vise une participation directe à la gouverne politique.
Une relation supplémentaire unit le dispositif État-société-nation au concert des États-nations. Elle est définie par le principe de souveraineté qui est au fondement du fonctionnement du système des relations internationales. Il est possible de concevoir le concept de souveraineté sur le plan strictement interne. Le terme vient du souverain et indique la suprématie dans l'exercice du pouvoir. Un État-nation est souverain à la condition d'exercer le pouvoir ultime sur toute question pouvant concerner la conduite de ses affaires dans un territoire délimité. Les traités de West-phalie qui ont mis un terme à la guerre de Trente Ans en 1648, sont considérés comme le texte fondateur du système des relations internationales tel qu'il continue de fonctionner aujourd'hui. Les traités définissent quatre principes, a) La territorialité définit les limites de juridiction légale et l'étendue de l'autorité politique des États. La territorialité est le principe central de l'organisation politique moderne. L'humanité est ainsi divisée en unités politiques délimitées par l'existence d'un territoire exclusif, b) La [374] souveraineté implique la suprématie absolue des gouvernements nationaux à l'intérieur de ce territoire exclusif (pays). Il s'agit du monopole de l'exercice du pouvoir de l'État tel qu'il est défini par Weber [23]. En principe ce pouvoir est indivisible, ce qui n'empêche pas, par contre, des partages de souveraineté dans les systèmes fédéraux [24]. Il importe d'insister sur le fait qu'il n'existe pas d'autorité politique supérieure à celle de l'État national, c) L'autonomie permet aux États de mener leurs propres affaires intérieures et extérieures de la façon qu'ils jugent opportune sans intervention extérieure, d) La légalité internationale n'existe que par un consentement des États concernés. Il n'y a pas d'autorité légale capable d'imposer des devoirs aux États ou aux citoyens de ces États. Les États sont toujours libres d'ignorer les jugements internationaux à moins qu'ils se soient engagés à le faire. C'est à la crise de ce dispositif institutionnel que nous assistons aujourd'hui. Chacune des fonctions qui a été décrite subit de profondes mutations. Il nous semble pertinent de commencer par la crise de souveraineté, car elle met en jeu la raison d'être même du système de gouvernement démocratique fondé sur l'existence d'États-nations. Nous poursuivrons en montrant comment la crise de souveraineté liée au phénomène de la mondialisation a des effets sur la fonction de légitimation du système de l'État-nation. Cette crise de légitimation est aggravée par les transformations internes des sociétés nationales qui sont exposées de plus en plus aux effets de la fragmentation sociale et identitaire. Également liée à l'érosion de la souveraineté et en relation avec la multiplication des lieux de pouvoir, une crise de régulation met en péril la capacité jadis exclusive de l'État à gouverner. Enfin, la crise de représentation démocratique, découlant des premières, montre les limites du système démocratique à s'adapter aux transformations actuelles de l'État-nation et du système international.
- Crise de souveraineté

On peut difficilement prétendre que les États-nations seraient aujourd'hui dépourvus de souveraineté ou qu'ils ne constitueraient plus les unités légitimes du système international. Il s'agit plutôt de s'interroger sur l'affaiblissement [375] progressif des prérogatives de souveraineté [25]. De plus, les États-nations se mesurent dans un espace géopolitique qui n'accorde pas un poids égal à la souveraineté de chacun [26]. Quelle que soit la réalité de la souveraineté, il n'en demeure pas moins intéressant de savoir si les principes westphaliens tiennent encore lieu de paradigme pour les relations internationales. Ou si, au contraire, ces principes sont suffisamment transformés pour remettre en question ce système. On peut en effet constater que les États-nations acceptent de partager leur souveraineté dans certains domaines de la régulation ou du droit. Les mêmes États renoncent jusqu'à un certain point à l'exclusivité du contrôle de leur territoire. Des unités subétatiques, des régions et des villes entrent dans des rapports de complémentarité dans les systèmes extraterritoriaux. Les États eux-mêmes participent à des alliances régionales ou continentales qui affaiblissent leur souveraineté territoriale exclusive.
Le courant réaliste en science politique [27] ne croit pas que le système westphalien soit entré en crise. L'argument principal consiste à dire que le système de Westphalie n'a jamais vraiment existé, un peu comme on peut affirmer que la démocratie ou les droits de l'Homme n'ont jamais été ce que les principes affirment. L'autonomie des États-nations n'existerait tout simplement pas dans un très grand nombre de cas. Le modèle aurait le plus souvent été battu en brèche. En somme, il s'agirait plus d'une référence ou d'un idéal que d'une réalité. Il faudrait donc répondre à la question des changements du système de Westphalie du point de vue de la réalité plutôt que des principes. Dans cette perspective, les atteintes à la souveraineté devraient être distinguées selon qu'elles relèvent de logiques différentes [28].
[376]
Dans le cas d'adhésion à des conventions internationales, par exemple les accords sur le respect des droits de l'Homme ou de contrats négociés en vertu de l'intérêt commun des parties, ce sont les gouvernements qui décident de céder une part de souveraineté. Ce ne sont que dans les cas de coercition ou à'imposition que le principe d'autonomie est bafoué. La coercition consiste à faire valoir l'intérêt du plus fort à l'endroit des plus faibles, sans nécessairement que les plus faibles y consentent. L'imposition consiste en la subordination sans possibilité de résistance du plus faible devant le plus fort. Selon cette approche, même ces deux derniers cas peuvent très bien se concevoir dans le cadre du système westphalien. En somme, même si le système international n'a jamais pleinement réalisé les principes de Westphalie, il n'en existe aucun autre qui puisse s'y substituer. C'est justement en raison de l'existence d'une structure d'autorité supérieure aux États dans le système international que l'autonomie des États a été si souvent compromise. C'est ce qui explique que les acteurs les plus forts sont à même d'user de la coercition ou de l'imposition envers les plus faibles et qu'en vertu de leurs intérêts partagés, l'ensemble des acteurs étatiques peuvent renoncer par convention ou par contrat à des parties de souveraineté.
Held et McGrew [29] nous montrent que la position réaliste est basée sur la compréhension hobbsienne du politique. Les traités de Westphalie n'ont pas été conçus dans le cadre d'institutions démocratiques, ce qui explique qu'ils ont pu justifier le développement des colonialismes et autres impé-rialismes. Ils soutiennent que la Charte des Nations Unies (1945) introduit de nouvelles dimensions dans le système des relations internationales qui vont dans le sens d'une plus grande démocratisation, mais également dans celui d'une réinterprétation des principes définis dans les traités. Sans s'illusionner sur la neutralité du système international — la charte a été fondamentalement conçue pour maintenir le pouvoir des puissances victorieuses au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, entre autres par la création des droits de veto au Conseil de sécurité — certaines innovations apparaissent dans la Charte des Nations Unies et dans la pratique de ses institutions. Les États ne sont plus considérés comme les acteurs exclusifs du système international. Des individus et des groupes particuliers reçoivent une certaine forme de reconnaissance, soit à travers la déclaration universelle des droits, soit à travers des mécanismes de consultation. Les nations jadis colonisées, non seulement reçoivent une reconnaissance en tant qu'acteur à part entière, par exemple dans le cadre de l'Assemblée générale, mais un appui réel dans le processus de décolonisation. Des principes et des valeurs sont progressivement intégrés dans les textes et les pratiques des organisations onusiennes. On voit donc émerger un système juridique international qui tend à imposer des règles de fonctionnement [377] aux divers acteurs étatiques. Par exemple, la déclaration universelle des droits de l'Homme encourage les États à respecter leurs citoyens. L'ONU, à travers ses agences, promeut le développement de la justice sociale et de la justice pénale dans le cas des crimes contre l'humanité. Enfin, l'idée d'un patrimoine commun de l'humanité fait son apparition dans des traités de protection des espaces partagés et des ressources communes.
Keohane résume de façon éclairante la manière alternative de comprendre la transformation du système international : « La souveraineté est moins conçue comme une barrière territoriale que comme une ressource dans la négociation politique qui prend place dans les réseaux internationaux de plus en plus complexes [30]. » Cela signifie que le principe de souveraineté demeure au fondement du système international, mais qu'il ne peut plus être considéré comme intangible. Si l'on accepte l'argument réaliste selon lequel la souveraineté ne peut être compromise que par consentement ou par l'exercice de la force, il faut aussi reconnaître que ces renonciations plus ou moins volontaires sont de plus en plus sollicitées dans le contexte international. L'expression « érosion de la souveraineté » a été contestée sur la base de l'argument réaliste selon lequel le système international continue de fonctionner à partir de cette fiction juridique de l'État souverain. Il vaut mieux peut-être parler de « partage de souveraineté » pour mieux rendre compte du caractère nécessairement politique et de la nature partielle de toute cession d'une part de souveraineté.
On peut donner quelques exemples de cette aliénation partielle de souveraineté dans le contexte nouveau de la mondialisation. Rappelons que cette dernière se caractérise par l'intensification des flux de commerce, de finance, d'information, de capital, de technologie, de personnes et de culture [31], fragilisant la capacité des États de formuler des politiques à portée nationale. La distinction entre politique interne et externe tend alors à s'estomper. On observe l'émergence de nouvelles institutions de gouvernance qui tentent de répondre aux défis posés par cet accroissement des flux transnationaux et par l'existence de problèmes globaux [32]. La souveraineté est d'abord défiée par un grand nombre d'organisations intergouvernementales ou supranationales qui sont appelées à réguler les flux engendrés par la mondialisation. Afin de répondre aux défis posés par l'accélération des échanges de toute nature, les États ont aussi tendance à signer des accords régionaux (ALENA), continentaux (projet de la ZLEA) [378] ou même mondiaux (OMC) qui limitent leurs capacités de légiférer dans certains domaines.
Le deuxième exemple est celui de la consolidation d'un régime juridique international. La multiplication des activités d'échange et des accords entraîne la formation d'un droit international de plus en plus complexe [33] et d'institutions d'arbitrage de plus en plus nombreuses. On assiste à une pluralisation des sources du droit, alors que l'État moderne, dont les institutions sont régies par une constitution, était conçu jusqu'alors comme unique source légitime de production du droit dans l'espace national souverain. Or, à travers l'adhésion à de nombreuses conventions, les États acceptent que les règles de droit et les normes soient désormais définies hors de leur compétence exclusive. Par extension, on peut dire qu'il existe aujourd'hui une production privée du droit. Les normes ISO en sont un bon exemple. On pense également aux codes de conduite dont une partie est produite dans l'espace privé.
Un troisième exemple concerne l'émergence de nouveaux acteurs dans l'espace de la gouvernance. Nous avons vu que les États ont délégué une part de leur pouvoir de produire le droit et d'énoncer des politiques à des organisations qu'ils ont eux-mêmes créées. On voit aujourd'hui les composantes de la société civile (secteur civique et secteur privé) réclamer et obtenir jusqu'à un certain point leur mot à dire dans les instances de gouvernance.
Pour conclure, rappelons que le concept de souveraineté est au fondement de la légitimité de l'État moderne à effectuer les choix politiques et à les défendre ultimement, à l'interne comme à l'externe, par l'usage de la violence institutionnelle. Le concept circonscrit l'espace territorial et juridictionnel de l'État et définit les principes d'interaction avec les autres États-nations dans le système international. Le principe de souveraineté ne s'est toutefois réalisé que progressivement et, par définition, de manière inégale entre États-nations d'inégale importance. Ce n'est que sous l'impulsion de la Charte des Nations Unies que le principe de souveraineté s'est appliqué juridiquement à tous les pays prétendant à l'indépendance. Même si ce principe continue à régir les relations internationales, sa réalité est chaque jour minée par un ensemble de facteurs. Que ce soit par convention, imposition ou coercition, les États aliènent une partie de leur souveraineté en principe indivisible. Ils le font dans le cadre des accords internationaux, par la mise en place d'organes spécialisés de régulation supranationale ou dans l'édiction d'un droit international et l'instauration d'instances judiciaires internationales. Les États sont en plus exposés à une concurrence de plus en plus grande dans la définition des normes [379] et règles régissant un ensemble de secteurs d'activité, de la part des forces du marché et d'instances de gouvernance non publiques. Quelle que soit l'expression retenue, il est loisible de parler aujourd'hui d'une remise en question des fondements institutionnels de la souveraineté.
- Crise de légitimation

La crise de légitimation s'exprime dans une rupture relative de la relation entre nation et État. Nous avons indiqué plus haut que l'État tient sa légitimité de l'existence d'une communauté politique formée de citoyens dont il est censé exprimer la volonté générale. Cette communauté que l'on nomme nation comporte une double dimension civique et culturelle. Dans sa dimension civique, elle se fonde sur l'existence d'un peuple de citoyens, porteurs de droits universels et arbitres en dernière instance de la décision politique. En tant que communauté culturelle, la nation se définit par la référence à un patrimoine commun : une langue, une culture et une histoire, même si chacune de ces catégories est parfois déclinée au pluriel. La communauté culturelle n'est pas toujours homogène et on peut aisément imaginer des communautés politiques multinationales dont les citoyens, en plus de partager des droits et des institutions politiques, se réfèrent à des traditions culturelles diversifiées (par exemple, au Canada).
Une crise de légitimation surgit lorsque l'arrimage entre la nation, dans les deux sens du terme, et les institutions étatiques ne se fait plus de manière satisfaisante. Deux facteurs expliquent, dans le contexte actuel, l'affaiblissement du lien entre nation et État. Le premier, la mondialisation, induit une transformation progressive des horizons de référence culturelle. Une dynamique nouvelle oppose homogénéité et hétérogénéité culturelles, tandis que l'identité citoyenne tend à migrer, du strict contexte national vers un contexte de plus en plus global. Le second facteur, la fragmentation interne de nos sociétés, ébranle la conception unitaire de la communauté. D'une part, la vision relativement unifiée de l'identité nationale tend à se fragmenter au profit de la diversité culturelle, d'autre part, la citoyenneté universelle cède le pas à la citoyenneté particulariste.
La transformation des horizons de référence culturelle a très bien été exprimée par Appadurai [34]. La complexité des phénomènes liés aux flux culturels globaux qui se manifestent dans le contexte de la mondialisation s'exprime simultanément par des ressemblances et des dissemblances. C'est dire que, à l'homogénéisation provoquée par certains flux culturels, s'opposent des hétérogénéités propres à chaque contexte d'accueil.
- Le point critique est que les deux faces du processus culturel global actuel sont des produits de la compétition infiniment variée entre ressemblance et différence, sur une scène caractérisée par des disjonctions radicales entre [380] diverses sortes de flux globaux et les paysages incertains créés dans et à travers ces disjonctions [35].
Ainsi se manifeste une tendance contradictoire vers une plus grande ressemblance culturelle sur le plan global et vers une différenciation des cultures sur le plan local. La culture serait l'objet d'un double processus d'homogénéisation se traduisant par une américanisation des produits culturels et d'hétérogénéisation ou d'hybridation de différentes cultures. Partant de l'observation d'un accroissement des flux culturels globaux, Appadurai décrit l'émergence de nouveaux horizons de référence dont il rend compte à travers la métaphore du paysage [landscape). Il s'agit de constructions symboliques qui varient selon les situations historiques, linguistiques, politiques de différents acteurs pouvant se situer aux divers niveaux national, multinational, diasporique ou, encore, sur les plans local, familial ou social. Suivant la nature des flux, on verrait surgir une série de nouveaux paysages culturels : les ethnoscapes, les technoscapes, les finan-cescapes, les ideoscapes et les mediascapes qui réfèrent respectivement aux flux migratoires, technologiques, financiers, idéologiques et médiatiques. L'ensemble de ces mouvements ne serait pas nécessairement en résonance. Ce serait leurs dissonances qui deviendraient l'enjeu central de la culture. Cette rencontre conflictuelle entre divers mouvements provoquerait à la fois des replis et des tentatives de conquêtes. Les flux culturels seraient de plus en plus puissants et ne pourraient éviter de s'influencer l'un l'autre. D'un côté, il y aurait tendance à la cannibalisation des cultures. Les États subiraient des pressions pour demeurer ouverts aux forces médiatiques, technologiques et touristiques encourageant leur marchandisation. De l'autre, cette ouverture conduirait à des affrontements entre les divers horizons culturels. Par exemple, l'horizon technologique pourrait entrer en contradiction avec l'horizon idéologique, comme ce serait le cas dans le heurt entre modernisation technologique et cultures locales dans les pays pauvres. De même, des contradictions entre horizon médiatique et horizon idéologique se manifesteraient dans des pays fondamentalistes. En somme, un ensemble de disjonctions entre flux culturels de nature différente et disjonctions entre horizons différents serait créé par la rencontre de ces flux. Cette vision nuancée de la globalisation des flux culturels et de ses effets contradictoires a l'avantage de ne pas nous enfermer dans une alternative entre existence ou non-existence d'une culture globale.
Pourtant, la thèse de l'existence d'une culture globale est combattue par Anthony D. Smith [36] qui déclare que « l'idée d'une culture globale est une impossibilité pratique [37] ». Cette impossibilité tiendrait au fait que la [381] culture globale n'appartient à aucune période et à aucun lieu. Elle ne serait qu'un mélange d'éléments disparates venant d'ici et de là et serait uniquement portée par les technologies de la communication. L'auteur ne croit pas à l'argument qui voudrait qu'une culture globale puisse être imaginée au même titre que la nation est elle-même une construction ou une communauté imaginée. Pour lui, la culture nationale est très différente de la culture globale. La première n'est pas imposée aux gens par le haut. Elle correspond à une identité, à des sentiments et à des valeurs. Elle implique un sens de la continuité de l'expérience intergénérationnelle, une mémoire partagée d'événements et de personnages qui marquent les étapes d'une histoire collective, un sens d'une destinée commune de la part de la communauté qui partage ces expériences. Il manquera toujours une histoire partagée pour qu'on puisse imaginer la construction d'une culture globale. Ce point de vue ne nous semble cependant pas invalider la réflexion d'Appadurai. Smith décrit bien les conditions d'existence d'une culture nationale qui donne sens à la communauté politique dans le contexte de l'État-nation. Cette culture n'est certainement pas oblitérée par la complexification des flux culturels qui se déploient dans le contexte de la mondialisation. Par contre, Appadurai a l'avantage de montrer comment les références culturelles se transforment et comment s'instaure une dialectique des cultures nationales et globale. Ce qui doit nous intéresser, c'est de comprendre en quoi l'horizon culturel national ne suffit plus à fonder entièrement à travers la communauté nationale la légitimité de l'exercice du pouvoir politique.
À titre d'exemple, les citoyens ont élargi considérablement leur horizon de référence lorsque vient le temps d'entrer en rapport avec leurs gouvernants. On trouve confirmation dans les enquêtes qui montrent que les jeunes, de manière générale, et les organisations militantes sont de plus en plus préoccupés par les enjeux politiques de la mondialisation. La question nationale demeure importante, mais elle est subordonnée à une politisation des enjeux globaux et régionaux. Cette mobilisation s'effectue autour de plusieurs questions ou problèmes qui ne peuvent plus être restreints sur le plan national, par exemple la pauvreté dans le monde, le réchauffement de la planète, les droits humains. La communauté nationale ne suffit plus à légitimer seule l'action des gouvernements.
La fragmentation des sociétés actuelles représente la contrepartie du mouvement de mondialisation. Les deux phénomènes peuvent être considérés aussi bien dans leurs interrelations que dans leur relative indépendance. Les pressions de la mondialisation ont certainement des effets de fragmentation sur les sociétés nationales ne serait-ce que par l'introduction d'éléments extrinsèques au système. Des exemples de flux culturels montrent jusqu'à quel point les sociétés sont appelées à se complexifier. À titre d'exemples, les flux migratoires contribuent fortement à une différenciation [382] du tissu social ; les technologies de l'information permettent à la fois la pénétration de schèmes culturels dominants et la variation des sources de l'information ; les idéologies globales, même fondamentalistes, pénètrent plus aisément dans l'espace des représentations.
Il existe, par contraste, des facteurs de fragmentations qui se développent de l'intérieur. Nous nous en tiendrons à deux manifestations de ce phénomène : la fragmentation identitaire et le développement d'une citoyenneté particulariste [38]. Nous croyons que cette fragmentation nouvelle ne doit pas être confondue avec la diversité inscrite au point de départ de la formation de certains États comportant plusieurs communautés nationales. En effet, certains régimes constitutionnels prévoient la coexistence d'une ou de plusieurs communautés ou traditions linguistiques, culturelles et historiques. Les régimes fédéraux tiennent compte jusque dans une certaine mesure de cette diversité des populations qui composent un même État-nation. On y observe une tendance à la formation d'une culture publique unifiée et d'une identité nationale commune. Cette unité complexe doit cependant, par contraste avec la situation des États unitaires, composer avec une fragmentation initiale du corps social et y apporter des solutions constitutionnelles [39].
La fragmentation dont nous parlons dépasse en quelque sorte cette diversité inscrite au point de départ dans les contextes fédératifs. Il s'agit d'un processus de fragmentation identitaire qui surgit dans les régimes fédératifs aussi bien qu'unitaires. Cette fragmentation identitaire ne se manifeste pas tant par les revendications nationalitaires que par des revendications culturelles et catégorielles [40]. Prenons l'exemple du Canada. La question de l'identité nationale a été problématique depuis le début de la Confédération. Ce régime constitutionnel a d'ailleurs été adopté pour tenir compte au point de départ de la diversité des colonies britanniques, soit du point de vue national (le Canada anglais et le Canada français) soit du point de vue régional (les deux Canadas et les colonies de l'Atlantique) [41]. On peut affirmer que les débats constitutionnels qui n'ont cessé d'agiter la scène canadienne se comprennent à travers ces luttes proprement modernes pour la construction plus ou moins complexe d'une identité nationale. La fragmentation identitaire actuelle déplace le terrain de ces [383] luttes. À partir des années 1960, avec l'émergence des nouveaux mouvements sociaux, jusqu'au rapatriement de la Constitution en 1982 et l'enchâssement de la Charte canadienne des droits et des libertés, un grand nombre de groupes d'ayants droit, se structurant autour d'identités diverses, aspirent à la reconnaissance. Pensons aux peuples autochtones dont les aspirations à l'autonomie gouvernementale s'éveillent en réaction avec le projet de loi sur les Indiens qui proposait d'échanger les droits ancestraux contre la simple reconnaissance de citoyenneté. Dans le même sens, les deux groupes linguistiques trouvent dans la politique du bilinguisme la raison de faire reconnaître des droits à parler leur langue dans des contextes élargis. De leur côté, les communautés culturelles encouragées par la politique du multiculturalisme et la Loi sur le multiculturalisme ajoutent leur voix aux demandes de reconnaissance. La Charte, enfin, qui enchâsse des droits de non-discrimination encourage les groupes minorisés à faire valoir leurs droits. Le Canada, dans un processus de multiplication des demandes de reconnaissance et de revendication de droits, transforme son identité nationale construite autour de la reconnaissance des droits sociaux pour tous les Canadiens en une identité fondée sur la reconnaissance étendue de droits particularistes. La communauté politique se fragmente en autant de groupes d'ayants droit.
Cette fragmentation identitaire est profondément ancrée dans le double mouvement d'extension et d'intensification des droits citoyens. Marshall [42] a identifié dès 1949 l'émergence des droits sociaux qui viendront s'ajouter aux droits préalablement instaurés, soit les droits et les libertés civils et les droits politiques. Déjà, il les concevait comme des droits collectifs ou corporatifs. Il retenait l'exemple du droit de négociation collective qui habilitait des corporations (au sens d'entreprises ou de syndicats) à exercer un droit citoyen. On peut dire que cet élargissement des catégories de droits du citoyen s'est poursuivi dans l'histoire récente en définissant de nouveaux droits culturels et catégoriels. Ainsi, ils passent progressivement d'une définition universelle compatible avec l'abstraction des catégories institutionnelles modernes à une définition particulariste des droits qui deviennent de plus en plus situés. De même, bien que les droits culturels et identitaires soient toujours portés par des citoyens individuels, ils le sont désormais en raison de leur appartenance à des groupes d'ayants droit.
De la même manière que la souveraineté demeure au centre du dispositif de la légitimité dans l'exercice du pouvoir, la légitimation de l'État par la nation, aussi complexe soit-elle, continue d'assurer une certaine pérennité à cette unité du système international. Nous avons cependant montré que des forces venant aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur tendent à affaiblir les liens entre État et nation. Les flux culturels globaux [384] induisent une dynamique de complexification des identités culturelles et favorisent une multiplication des niveaux d'appartenance de la part des citoyens. La fragmentation interne des sociétés provoque, de son côté, une complexification des identités qui s'appuient désormais sur une dynamique de revendication des droits particuliers. Dans ce contexte, il devient plus difficile de penser l'unité de la société dans le concept de nation.
- Crise de régulation

La crise de régulation qui affecte les États-nations peut se résumer dans la manifestation de deux phénomènes : la soumission du politique au juridique et la substitution de la gouvernance au gouvernement [43]. Cette crise de régulation est intimement liée aux deux crises déjà décrites. Le rééquilibrage entre les institutions politiques et juridiques fait particulièrement écho à la crise de légitimité, alors que le renouvellement de la gouverne politique se rapporte davantage à la crise de souveraineté. La place accrue du droit et de la gouvernance se manifeste aussi bien sur le plan national qu'international. Ne pouvant aborder toutes les dimensions du problème, nous nous concentrerons sur les effets de cette crise sur la démocratie. La crise de régulation se manifeste d'abord dans la redéfinition de l'équilibre entre les institutions de la modernité politique, en particulier entre les institutions proprement politiques et juridiques. Le Canada représente à cet égard un cas exemplaire. Le rapatriement de la Constitution de 1982 et l'enchâssement de la Charte des droits et des libertés inaugurent une ère nouvelle dans la distribution des pouvoirs entre le judiciaire et le législatif. La Charte devient la référence ultime en vertu de laquelle les droits et les libertés des personnes sont préservés par la Cour et la validité des lois est soumise au jugement du tribunal. On peut apprécier de manière diverse cette réforme des institutions et, paradoxalement, la droite et la gauche se trouvent quelquefois d'accord lorsqu'il s'agit de critiquer le rôle prédominant de la Cour [44]. Cette critique tient essentiellement à dire que le législateur perd sa souveraineté dans sa capacité d'édicter les lois au profit du juge dont la légitimité ne repose sur aucun principe de représentativité. À droite, on craindra l'activisme de juges soupçonnés d'avoir des idées libérales, à gauche, on s'effrayera du caractère conservateur des mêmes juges. En tout état de cause, la légitimité des juges est mise en doute plus que leur compétence.
[385]
La Charte a été introduite dans un esprit libéral et elle correspond à la volonté de prémunir les individus contre l'État et les minorités contre la majorité. Elle représente au Canada un tournant libéral à telle enseigne que l'on a pu parler d'une américanisation de notre système politique. Plusieurs études ont tenté d'évaluer le caractère plus ou moins libéral ou conservateur des décisions prises par la Cour et le degré plus ou moins grand d'activisme des juges [45]. Ce qui est intéressant, c'est de constater que selon les questions qui sont soumises et selon des époques différentes, elle a tendance à plus ou moins intervenir et à favoriser quelquefois les droits individuels, parfois les intérêts de la société. La question constitutionnelle n'est pourtant que la pointe de l'iceberg. Elle montre de manière exemplaire en quoi le tribunal est politisé en ce qu'il est amené à arbitrer des choix de sociétés et en quoi les institutions politiques deviennent juridicisées dans la mesure où elles confient à des instances administratives d'arbitrage l'essentiel des décisions. La juridicisation des institutions politiques signifie que les débats sur les enjeux se font plus rares au profit d'une régulation techno-bureaucratisée [46].
Dans un deuxième temps, la crise de régulation se caractérise par un certain déplacement du gouvernement vers la gouvernance [47]. Le terme de gouvernance a réussi à s'imposer dans le discours social pour désigner toutes les modalités que l'exercice de l'autorité peut prendre aujourd'hui. Ainsi, dans cette conception, le gouvernement est considéré comme modalité particulière de la gouvernance. Ce déplacement sémantique indique le lieu d'un problème pour le modèle de démocratie représentative institué dans la modernité. L'idée de gouvernement, dans le contexte démocratique moderne, implique l'existence du complexe institutionnel que nous avons décrit dans notre schéma. La société civile y est distincte de l'État et la nation assure la médiation entre les deux. Enfin, des citoyens libres de vaquer à leurs occupations économiques, civiques ou privées sont représentés par les élus qui assurent la légitimité au gouvernement. La gouvernance est tout autre chose. Dans le même sens où nous parlions de techno-bureaucratisation de l'État et de juridicisation des institutions [386] politiques, on peut dire que la gouvernance se présente comme une modalité formalisée et procéduralisée de la gouverne politique.
La gouvernance est à la fois un concept et une réalité. Le concept a émergé récemment dans trois contextes affectés d'un déficit de régulation. Il a d'abord été pensé dans le cadre des grandes corporations pour formaliser des règles de pratique qui respecteraient des principes de transparence et d'imputabilité et qui permettraient d'associer à la décision l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, entre autres les actionnaires. Dans le contexte urbain, la gouvernance a été pensée en vue d'associer de nouveaux partenaires (milieu d'affaires et communautés locales) dans la prise de décision en matière municipale. Enfin, les grandes organisations internationales à vocation économique (FMI, BM) ont récupéré le concept pour désigner les meilleures pratiques de gouverne politique, appliquées principalement dans les pays en voie de développement. Dans ce dernier cas, ce sont les aspects « éthiques » de la gouvernance qui sont mis en valeur. On souhaite un assainissement des mœurs politiques locales et une plus grande démocratie. Par contre, cette « bonne gouvernance » s'accompagne tout naturellement d'un programme néolibéral de déréglementation et de privatisation. Comme on le voit, le concept de gouvernance désigne à la fois un déplacement dans les modalités de la gouverne politique et un programme d'ajustement des valeurs.
La crise de souveraineté provoquée par la multiplication des lieux de régulation (mondial, régional, national ou local) et des acteurs de cette régulation (gouvernements, organisations intergouvernementales, société civile, secteur privé) induit l'élargissement des modalités de la gouverne politique. L'État ne détient plus le monopole exclusif dans l'exercice du pouvoir. Il faut prendre acte de l'existence de cette multiplication des espaces de régulation et, à ce titre, le concept de gouvernance est utile pour en rendre compte. Cependant, il ne peut être assimilé à celui de gouvernement, ne serait-ce qu'en raison de la légitimité que procurent au gouvernement les institutions démocratiques. C'est à partir de la démocratie que l'on peut mieux distinguer le gouvernement et la gouvernance. Il est, en effet, facile d'opposer les deux conceptions sur la base du modèle idéal de la démocratie représentative. Cependant, il devient de plus en plus difficile de les distinguer pratiquement, dans la mesure où les dispositifs et l'esprit de la gouvernance pénètrent de plus en plus l'espace de l'administration publique. Les phénomènes déjà décrits de juridicisation, de proceduralisation et de bureaucratisation de la décision politique transforment l'idée du gouvernement démocratique fondé sur la délibération des élus. De même, l'élargissement des catégories d'acteurs participant aux instances de consultation et de délibération à tous les niveaux de la régulation étatique implique une remise en question du modèle démocratique au sein même des institutions gouvernementales.
[387]
Le principe démocratique n'en est pas moins au centre du processus de gouvernement. Il s'appuie sur des citoyens détenteurs de libertés et de droits qui sont, en principe, égaux et représentés de manière équitable par des élus dont l'assemblée légitime l'action gouvernementale. Par ailleurs, ces mêmes citoyens constituent une communauté de destin plus ou moins unifiée qui sert de référence ultime à l'action étatique. Par contraste, la démocratie ne se manifeste pas de la même manière au sein de la gouvernance. Bien que la gouvernance s'appuie sur un discours à prétention démocratique et des pratiques d'ouverture [48], elle ne peut prétendre réaliser le modèle de démocratie moderne. Son discours de transparence, d'imputabilité et de meilleures pratiques se réclame de la démocratie, sans pour autant pouvoir en assurer les conditions institutionnelles de réalisation. C'est au nom d'une certaine communauté d'acteurs, qualifiés de parties prenantes, que des modalités de gouvernance exemplaires sont mises de l'avant. On vise à assurer une régulation équitable au bénéfice de l'ensemble des parties prenantes et de leurs intérêts respectifs. Cela ne suffit pas à qualifier la légitimité de ces parties prenantes, ni de l'idée de bien commun. Ce type de participation démocratique diffère grandement de celle qui est présumée dans les systèmes de gouvernement démocratique. Il manque d'abord l'idée de l'égalité des parties. Il y a, en effet, incommensurabilité de l'influence respective des acteurs (États, organisations internationales, firmes multinationales, société civile). Les acteurs sont liés entre eux par une logique des intérêts particuliers et ne peuvent se référer à une totalité signifiante qui donnerait une légitimité d'ensemble à leur action. Il n'y a pas, enfin, de principe commun de référence transcendant les intérêts particuliers. Il n'y a qu'un espace particulier de problèmes et une sphère déterminée d'intérêts en concurrence. La bonne gouvernance est certes souhaitable en autant que ses principes vertueux sont mis en œuvre. Cependant, elle ne peut se substituer à la légitimité du gouvernement.
La crise de régulation remet en question la relation entre État et société. Elle affecte les modalités de prise en charge des problèmes communs à toute société. Plutôt que de continuer à confier aux instances proprement politiques le soin d'effectuer les choix de société, elle confie de plus en plus aux instances juridiques et procédurales la tâche d'arbitrer les conflits. Le gouvernement, dans son sens d'institution démocratique fondée sur la délibération, est de plus en plus remplacé par les instances de la gouvernance qui assurent la régulation des problèmes et des intérêts particuliers. C'est probablement cette crise de régulation qui introduit le plus grand nombre de tensions au sein de l'institution démocratique. [388] Elle interpelle les acteurs sociaux sur la viabilité de ces institutions, mais également sur la valeur des alternatives qui sont aujourd'hui proposées.
- Crise de la représentation

La crise de représentation fait référence au double déficit de la représentation et de la participation dans les institutions démocratiques. Les deux principes sont en interaction constante, mais ils procèdent selon leur logique propre. Nous en traiterons donc de manière indépendante. Rappelons que l'on peut comprendre l'idée de représentation en nous reportant aux deux plans définis dans le schéma de la figure 1. Sur le plan des institutions, la représentation permet à la société de se concevoir comme communauté politique. Le peuple formant nation est une image transcendantalisée de la société concrète. La nation comme représentation d'un peuple de citoyens appartenant à la société sert de médiation entre le pouvoir de l'État et la société. Elle donne à l'État sa légitimité. Sur le plan du processus démocratique, la représentation se traduit dans des modalités particulières permettant que les citoyens soient représentés dans les assemblées délibératives. Le système représentatif prévient l'incohérence d'un système gouverné par une multiplicité d'intérêts et assure ainsi l'effectivité de l'action politique. Il permet également que s'effectue une réconciliation des intérêts en vue du bien commun. Sur les deux plans, la représentation contribue à la production de l'unité sociale.
En ce sens, on peut affirmer que la crise de représentation déplace la logique de l'unité vers une logique du multiple. Pour le dire simplement, une logique de représentativité tend à se substituer à une logique de représentation [49]. Nous avons vu que le partage de souveraineté, la fragmentation du tissu social, la prépondérance des appareils judicaires et technocratiques, les nouvelles formes de gouvernance induisent un déficit de légitimité. Les élus ont de plus en plus de problèmes à représenter de manière adéquate la complexité sociale. C'est donc en raison de la fragmentation sociale et de la multiplication des lieux où se prennent des décisions que s'accroît la demande de représentation de la part des citoyens. Cette représentation se transmue en représentativité, dans la mesure où l'ensemble des catégories d'acteurs doit être représenté en lieu et place du principe de leur communauté. On cherchera dorénavant à reproduire à la manière d'un échantillon stratifié chacune des composantes de la société. La logique à la base de la réforme des institutions démocratiques est bien celle d'une meilleure représentation des diverses dimensions du tissu social. La représentation des intérêts dans la structure de la gouvernance relève également de cette logique de représentativité.
[389]
La participation est le complément de la représentation. Elle est, en effet, au fondement de la catégorie moderne de citoyenneté. Marshall [50] définit deux dimensions essentielles de la citoyenneté, l'appartenance et la participation. Les citoyens doivent pouvoir appartenir de manière pleine et entière aux institutions sociales. En cela, l'extension des divers types de droits contribue toujours plus à leur intégration. Mais, une fois reconnus, ils se doivent également de participer. La participation à la chose publique est donc fondamentale à la définition de la démocratie. On peut cependant la concevoir de deux manières différentes, soit directe ou par voie de représentation. Dans le modèle de démocratie représentative, le citoyen est appelé à se porter candidat ou à élire son représentant. Dans ce cadre, le déficit de participation se caractérise par des distorsions du processus électoral. Plusieurs catégories de citoyens sont absentes des listes de candidats et les citoyens électeurs omettent de plus en plus leur devoir d'électeur. La revendication d'une démocratie directe va bien au-delà de la réforme du système électoral et se produit en général dans les nouveaux espaces de délibération. La démocratie représentative étant jugée insuffisante pour assurer la participation, l'établissement d'une relation directe entre les citoyens et les instances de délibération est revendiquée. Il ne s'agit plus de déplorer la faiblesse du système électoral, mais d'en proposer une alternative. Nous verrons dans la section suivante comment cette double crise de la représentation et de la participation se manifeste dans de nouvelles pratiques démocratiques.
Revanche des sociétés
et nouvelles pratiques démocratiques
- C'est une erreur de penser que l'ordre démocratique requiert par nature un ancrage mental dans la « nation » entendue comme communauté prépolitique fondée sur un destin partagé [51].

Le titre de notre contribution suggère que la question démocratique se loge aujourd'hui entre la crise de l'État et la revanche des sociétés. Les crises ou les mutations que connaissent les institutions politiques relèvent d'un ensemble complexe de facteurs qu'il est difficile d'ordonnancer. Il est clair cependant que ces crises ont un impact profond sur les pratiques démocratiques. L'incertitude du cadre institutionnel de la régulation politique et la déresponsabilisation relative des acteurs politiques traditionnels, qui sont de plus en plus désengagés, remettent en question la manière même de concevoir la démocratie. La revanche des sociétés manifesterait [390] un retour de cet engagement pour la démocratie. Cet engagement prend cependant un ensemble de formes, se manifeste chez des acteurs divers et se loge dans un ensemble de lieux différenciés. Ces lieux peuvent être aussi bien l'État-nation, les structures politiques supranationales, l'ensemble des nouveaux espaces de gouvernance ou encore l'espace d'expérimentation à l'extérieur des institutions ou des organisations. Les acteurs peuvent prendre la figure du citoyen, du sujet politique, du citoyen incorporé, de la partie prenante ou encore de la multitude. Enfin, la forme de l'engagement peut être de nature réformatrice, innovatrice ou expérimentale. Nous tenterons d'examiner dans les lignes qui suivent ces diverses tentatives de reviviscence de la démocratie en manière de revanche des sociétés aux prises avec la dérive de leurs institutions.
Tableau 2
Formes de légitimité et nouvelles pratiques démocratiques
|
Formes de
légitimité
Nouvelles
pratiques
démocratiques
|
Légitimité
représentative
|
Légitimité
participative
|
|
Réforme
démocratique
|
• Glissement de la représentation vers la représentativité
|
• Participation au processus électoral
|
|
Innovation
démocratique
Gouvernance
|
• Représentation des parties prenantes
|
• Consultation plus que décision
• Participation inégale
|
|
Institutions politiques supranationales
|
• Multiplication des niveaux de représentation
• Diversité des référents
|
• Participation au processus électoral
• Consultation
|
|
Expérimentation
démocratique
Démocratie directe
Contestation Démocratie décentrée
|
• Absence de médiation
• Absence d'institution
• Représenter la diversité sans hiérarchie
|
• Participation à la décision
• Refus de participation
• Délibération
|
Nous aborderons trois formes de nouvelles pratiques démocratiques qui émergent dans le contexte des quatre crises institutionnelles et des reconfigurations partielles des modalités de la régulation [52]. Nous tenterons [391] de montrer en quoi chacune de ces pratiques peut être évaluée en fonction de la dialectique de légitimation qui oscille entre représentation et participation. Il s'agit de la réforme des institutions démocratiques, des innovations démocratiques et des expérimentations démocratiques. Le tableau 2 présente, pour chacune de ces nouvelles pratiques, la mise en œuvre des deux principes de légitimité que sont la représentation et la participation.
- Réforme démocratique

La réforme démocratique se situe au sein de l'État-nation et vise à revivifier les institutions démocratiques, en particulier le système électoral. Essentiellement, elle est fondée sur deux idées : mieux représenter les citoyens et s'assurer de leur plus grande participation. Dans son document sur la réforme électorale au Canada [53], la Commission du droit du Canada établit une liste de symptômes de ce qu'elle qualifie de « malaise de la démocratie » :
- [...] la baisse de confiance envers les institutions politiques, la diminution de la participation électorale, la montée du cynisme et de l'hostilité envers les politiciens et les formes traditionnelle de participation à la vie politique (les partis politiques, entre autres) et le désengagement croissant de la jeunesse à l'égard de la politique [54].
Elle propose une liste de dix critères permettant d'évaluer les systèmes électoraux. Cinq visent une meilleure représentation des citoyens. On souhaite une plus grande représentation des partis de telle sorte que le pourcentage des voix exprimées corresponde au pourcentage de la députation. Une meilleure représentation démographique de la nation devrait viser à mieux représenter à la Chambre de communes les divers éléments de la société, comme les femmes, les groupes minoritaires, les autochtones. La diversité des idées et des points de vue devrait également être plus équitablement représentée. Enfin, deux critères additionnels concernent le territoire. Au critère de représentation géographique qui permet déjà à chaque électeur d'élire un représentant ultimement responsable pour sa circonscription, il faudrait ajouter un meilleur équilibre dans la représentation régionale prise globalement, de telle sorte qu'aucune région ne détienne un avantage sur les autres.
En conséquence, la réforme préconise l'ajout d'éléments de proportionnalité au système électoral, cherchant ainsi à assurer la participation des citoyens par de meilleurs mécanismes de représentation [55]. Il est présumé [392] qu'une meilleure représentation mobilisera de nouveau les citoyens autour de leurs institutions démocratiques. Non seulement se reconnaîtront-ils davantage dans la députation, mais ils seront conduits à participer en plus grand nombre au processus électoral. La réforme des institutions démocratiques est donc pensée au sein même du modèle de démocratie représentative. Elle ne contrevient pas à cet égard à la logique de représentation démocratique, même si elle ouvre la porte à d'autres formes de participation démocratique dans des forums alternatifs [56]. Cependant, la conception universaliste de la représentation, qui conçoit la nation comme la figure unifiée d'un peuple de citoyens, se mue en une conception empirique de la représentation des divers éléments de la société. En effet, il ne s'agit plus uniquement de produire une figure symbolique de la communauté politique mais de reproduire au plus près la diversité qui caractérise la société. En somme, la société se substitue à la nation comme principe de légitimité de l'action étatique. Même si la médiation entre la société et l'État continue à se faire à travers le parlement, celui-ci doit refléter au plus près le tissu social.
Un des éléments de la crise de l'État-nation, la fragmentation de l'identité nationale, entre en consonance avec cette revendication de représentativité. Le Canada illustre de manière exemplaire la fragmentation de la représentation identitaire. L'identité nationale proprement canadienne a, de tout temps, été problématique, non seulement en raison de la coexistence de plusieurs identités nationales concurrentes (les Québécois, les peuples autochtones) et la difficulté cooccurrente de se représenter comme nation, mais parce qu'elle s'est d'abord définie à travers la citoyenneté. L'identité nationale canadienne, qui émerge dans le contexte de la formation de l'État-providence, se fonde sur la réunion de citoyens détenteurs de droits sociaux de nature universaliste. Cette identité aura tendance à se fragmenter avec la montée des demandes de reconnaissance de la part d'un ensemble de groupes d'ayants droit provoquant le passage d'une citoyenneté universaliste à une citoyenneté particulariste [57]. La réforme constitutionnelle canadienne et l'enchâssement de la Charte des droits et libertés confirment désormais la diversité comme principe d'identité nationale. Le Canada demeure incapable de se reconnaître comme État multinational, mais multiplie les reconnaissances d'identités fragmentées, culturelles ou catégorielles. La réforme électorale introduisant des éléments de proportionnalité serait pleinement congruente avec cette représentation identitaire, mais sa réalisation est compromise par la logique partisane et par le contrepoids de l'efficience gouvernementale. La diversité est prise [393] en charge par l'appareil judiciaire et la gouverne politique est appropriée par les organes exécutifs et bureaucratiques.
- Innovation démocratique

Une deuxième forme de pratique démocratique se développe dans le cadre des reconfigurations institutionnelles qui déplacent les lieux de la régulation et de la gouverne politique en marge ou à l'extérieur de l'État-nation. Nous distinguerons les innovations en fonction de leur inscription dans ou hors de la logique des institutions politiques. Nous traiterons successivement du développement d'instances proprement politiques au niveau supranational et de la participation dans les instances de la gouvernance. Le problème de l'innovation démocratique se pose en relation avec la déterritorialisation des États-nations et l'érosion progressive de leur souveraineté. Dans la mesure où l'on peut définir des espaces d'intérêts communs ou de problèmes partagés, il est possible d'envisager des modalités politiques d'unification ou de fédération entre États indépendants. Dans les faits, la plupart des accords entre pays ont une portée limitée et se confinent à un domaine de problèmes déterminé. Les solutions apportées relèvent davantage d'une logique fonctionnelle visant la résolution de problèmes. Il existe peu d'exemples concrets de structure gouvernementale supranationale [58]. L'Union européenne représente une illustration de la complexité des instances de gouvernance, puisqu'elle se situe à la rencontre de trois modèles de régulation : intergouvernemental, fédéraliste et supranational [59]. L'Europe propose un modèle qui combine plusieurs modalités de coopération entre gouvernements, mais qui offre également des institutions juridiques et politiques qui la transcendent. L'architecture de l'Union européenne fonctionne à partir du principe de subsidiarité qui confie au niveau de gouvernement le plus approprié les dossiers qui [394] concernent leurs commettants. Il y a donc superposition de plusieurs niveaux de gouvernement, l'État-nation conservant l'essentiel de ses prérogatives. L'innovation consiste pourtant à offrir une réponse politique de type moderne aux problèmes suscités par la crise des institutions.
Ce qui fait l'originalité de l'Europe en comparaison avec les autres regroupements de pays sur une base régionale ou continentale, c'est l'existence d'institutions proprement politiques, comme le Parlement européen dont les membres sont élus par les citoyens de l'Union. Il existe également une citoyenneté européenne qui se superpose aux citoyennetés nationales. Par contre, l'Europe souffre des mêmes problèmes qui affectent les États-nations qui la constituent. On y déplore une centralisation et une bureaucratisation dans l'exercice du pouvoir et une certaine juridicisation de la régulation. Le modèle européen offre tout de même la possibilité d'instaurer au niveau supranational des institutions proprement démocratiques. Les problèmes qui se posent à ces institutions demeurent les mêmes que ceux identifiés pour les États démocratiques, le problème d'une représentation effective des citoyens dans toute leur diversité et d'une participation accrue de ceux-ci à la chose publique. La représentation ne peut plus être univoque, car l'Europe ne constitue pas une nation, mais un regroupement de nations. Elle doit traduire la multi-appartenance des citoyens. Quant à la participation, elle se manifeste d'abord dans le processus d'élection du Parlement européen, et ensuite dans un ensemble d'instances consultatives qui ont été développées en parallèle. En somme, l'innovation démocratique consiste à accompagner le développement des institutions de l'Union de modalités d'exercice de la citoyenneté politique. Les mécanismes mis en œuvre pour permettre une meilleure représentation et une plus grande participation ne sont par contre pas très éloignés de ceux qui sont imaginés dans le cadre de la réforme démocratique.
La réponse la plus habituelle au besoin de régulation, dans le contexte de la décentration du pouvoir, n'est pas de nature proprement politique. La réponse, qui s'exprime dans un ensemble de lieux infra, para ou supra-étatiques, est plutôt celle de la bonne gouvernance. Cette dernière peut aussi bien se réaliser dans l'espace public que privé. Elle se matérialise dans des organismes consultatifs mis en place par les États, dans des organisations intergouvernementales ou supranationales, ou encore dans des initiatives de concertation privées. Lorsqu'elles concernent les États, ces instances de gouvernance, en fonction de leur statut, participent de diverses logiques qui vont de la subsidiarité, à l'intergouvernementalité jusqu'à la supragouvernementalité. Lorsqu'elles se développent en parallèle aux États, elles mettent en œuvre une pure logique technobureaucratique, étrangère à la logique du gouvernement démocratique.
La gouvernance répond d'abord à un besoin de régulation et se présente avant tout comme un ensemble de modalités, fondées sur les principes [395] de transparence et d'imputabilité, contribuant à la prise de décisions. Cependant, la dimension démocratique est présente dès le départ, dans la mesure où la gouvernance doit assurer une certaine participation des parties prenantes ou, si l'on veut, des parties ayant des intérêts en cause. Évidemment, la question de la définition des intérêts légitimes associés à l'une ou l'autre question reste ouverte. À l'origine de la théorie de la gouvernance, il y a l'idée d'assurer une meilleure gestion au profit de tous les partenaires. Cela est vrai dans les deux contextes qui ont vu naître le concept de gouvernance. Dans l'entreprise, les actionnaires réclament non seulement d'être informés, mais aussi de participer à la décision. Dans le contexte urbain, les acteurs du secteur privé et civique aspirent à une plus grande participation dans les processus consultatifs. C'est plutôt dans les organisations internationales que la dimension démocratique de la gouvernance a été relativement négligée et ce sont souvent les mouvements sociaux et les organisations de la société civile, dans leur volonté de défendre les intérêts des gens concernés par les décisions prises de plus en plus en dehors de la sphère publique de délibération, qui ont suscité une certaine ouverture vers la participation du secteur civique de la société civile. C'est ainsi que le modèle de la gouvernance publique, tel qu'il s'est progressivement institué, définit trois types de partenaires : d'un côté, les gouvernements et leurs organisations intergouvernementales, en tant que partenaires politiques, de l'autre, les partenaires de la société civile, le secteur privé et le secteur civique.
Trois questions se posent en relation avec la dimension démocratique de la gouvernance. Qui sont les partenaires de la société civile et dans quelle mesure peuvent-ils constituer un acteur politique ? Quelle est la nature de la participation et jusqu'où est-elle effective ? Enfin, quelle est la légitimité de ces acteurs ? À la première question, les chapitres de Scholte et de Audet, Canet et Duchastel répondent de manière fort nuancée. Entre la définition classique de la société civile comme totalité opposée à l'État et les définitions qui décrivent les diverses composantes qui la constituent empiriquement, il y a toute une série de définitions de nature stratégique ou analytique. En tant que partie prenante à la gouvernance, la société civile se définit par un ensemble d'associations bénévoles ou d'organisations non gouvernementales qui ont pour objectif de « modeler les règles qui régissent tel ou tel aspect de la vie sociale [60] ». Les acteurs de la société civile se caractérisent d'abord par leur hétérogénéité. Qu'on les classe selon leur caractère plus ou moins conformiste, réformiste ou radical [61] ou qu'on les distingue par leur action stratégique dans le cadre concret de négociation [62], les acteurs de la société civile doivent être saisis [396] dans leur complexité et leurs contradictions. Les organisations non gouvernementales financées par des groupes religieux ou par des corporations ne peuvent être comparées aux organisations autonomes pas plus que les orientations politiques plus ou moins progressistes ou réactionnaires ne peuvent être confondues. Cette pluralité des acteurs implique une très grande variation des intérêts défendus et des stratégies engagées pour les défendre.
La deuxième question concerne la nature et l'effectivité de la participation. Il est difficile de ne pas éprouver un sentiment relatif d'arbitraire lorsqu'on observe les modalités concrètes de la participation de la société civile à ces instances. Le premier aspect de cette question renvoie au problème du choix des organisations qui prendront part au processus. Le second implique la transformation même du principe de participation. Il existe une critique persistante de la professionnalisation de la participation aux instances de la gouvernance. Les organisations et leurs représentants réunissent toutes les caractéristiques des personnes éduquées, majoritairement de sexe masculin et en provenance des États développés. Quant à cette participation, elle n'est plus le fait d'individus citoyens égaux en droits et en obligations, mais de groupes d'intérêts qui formulent des revendications particulières. Quant à l'effectivité de cette participation, il y a en général incommensurabilité entre les différents acteurs qui participent aux instances de gouvernance. Le secteur civique de la société civile se présente en ordre dispersé par contraste avec le secteur privé qui se caractérise le plus souvent par son unité [63]. Par ailleurs, la participation relève davantage de la circulation de l'information, de la consultation, mais rarement de la décision. Cela ne veut pas nécessairement dire que la participation soit sans effet. Scholte [64] énumère un ensemble de retombées de l'action du secteur civique de la société civile : une meilleure sensibilisation du public, une voix donnée aux parties concernées, une critique de la gouvernance, une accentuation de la transparence publique, une responsabilisation publique des organismes concernés et un accroissement de la légitimité de la gouvernance. On donnera à titre d'exemple l'implication du secteur civique dans le développement du processus de la Société de l'information dont l'agenda n'aurait pu être le même sans l'implication en profondeur de la société civile [65]. De même, sur un plan général, on témoigne d'un changement de cap important [397] dans le discours des grandes organisations internationales, sinon dans leurs politiques, depuis la mobilisation des mouvements sociaux et de la société civile dans l'espace mondial au cours des années 1990.
La participation aux instances de la gouvernance implique tout naturellement la question de la représentation et, par extension, la question de la légitimation. À un niveau général, on peut affirmer qu'il ne peut s'agir de représentation au sens transcendantal. Il n'existe pas de communauté politique dans le triangle de la gouvernance. Il n'y a que des parties prenantes, détenant des intérêts particuliers plus ou moins étendus, autour d'un problème ou d'une sphère d'activité. Les participants aux instances délibérantes ne représentent que le groupe ou la collectivité d'intérêts au nom desquels ils agissent. Évidemment, cette collectivité peut être plus ou moins étendue, par exemple dans le domaine de la défense de l'environnement. Mais le modèle de la gouvernance ne propose pas de principe de totalité, il ne fait que juxtaposer des intérêts différents. Pour reprendre l'exemple de l'environnement, on met côte à côte gouvernements, organisations internationales, secteur industriel et l'ensemble des groupes de consommateurs et de citoyens exposés aux risques. La gouvernance pose donc un problème fondamental de la légitimité de ses participants.
On peut distinguer deux types de légitimité de la société civile dans le contexte de sa participation aux instances de la gouvernance [66]. Le premier type de légitimité découle des principes d'action de la société civile. On peut difficilement contester le bien-fondé de cette action qui vise à accroître l'éducation et le débat publics, à favoriser la participation citoyenne et à encourager la transparence et l'imputabilité publiques des décideurs. Le second type de légitimité concerne la représentativité de certains groupes de la société civile en tant que participants aux instances de gouvernance. Scholte propose d'appliquer tout simplement les mêmes principes à ces organisations que les principes qu'ils promeuvent dans leur action. Les groupes de la société civile devraient encourager en leur sein le débat public, respectant les opinions divergentes et se gardant de se reproduire par pure cooptation. Ces groupes devraient s'assurer de posséder les meilleures connaissances de leurs dossiers. Ils devraient encourager le recrutement de militants de toutes les couches de la société. Ils devraient enfin s'assurer que leur fonctionnement réponde aux plus hauts critères de transparence et d'imputabilité. On retrouve ici le même souci manifesté dans le contexte de la réforme électorale de mieux représenter au sens de reproduire les diverses composantes et les divers intérêts de la société.
[398]
- Expérimentation démocratique

Nous évoquerons en terminant trois formes d'expérimentation démocratique. Ces pratiques démocratiques mettent en cause les principes mêmes à la base du système démocratique, tel qu'il est institutionnalisé. On peut affirmer que chacune de ces formes pousse plus loin la critique de la représentation et de la participation démocratiques. Dans tous les cas, on souhaite une participation immédiate, c'est-à-dire sans médiation, de toutes les catégories de citoyens au processus démocratique, quitte à ce que la forme institutionnelle actuelle soit profondément transformée. Dans le cas de la réforme électorale ou de la démocratie supranationale, on tente d'accroître la participation en transformant la représentation en représentativité sociologique. Dans le cas de la gouvernance, on pousse cette logique jusqu'à abandonner le modèle de représentation universelle au profit d'une représentation des intérêts particuliers. Ici, on conteste le fondement même des principes de représentation et de participation.
L'expérimentation démocratique implique une transformation décisive dans la façon de concevoir le pouvoir et le sujet politique [67]. Dans leur chapitre, Canet et Perrault expliquent le culte de l'horizontalité et du réseautage par une profonde mutation de la conception du pouvoir, de l'organisation et de la légitimité. À une conception concentrée du pouvoir se substituerait une conception diffuse ; à la structuration pyramidale des organisations se substituerait l'image du réseau ; enfin, une légitimité inclusive remplacerait la légitimité représentative. Cette nouvelle conception puiserait à la pensée de Foucault, interprétée par Deleuze, et réactiverait un aspect des Lumières qui insiste sur le self-government activé en chaque citoyen. Michel Foucault nous donne un aperçu de sa pensée sur le pouvoir et le savoir dans une phrase lumineuse de Surveiller et punir.
Analyser l'investissement politique du corps et la micro-physique du pouvoir suppose donc qu'on renonce — en ce qui concerne le pouvoir — à l'opposition violence-idéologie, à la métaphore de la propriété, au modèle du contrat ou de la conquête ; en ce qui concerne le savoir, qu'on renonce à l'opposition de ce qui est « intéressé » et de ce qui est « désintéressé », au modèle de la connaissance et au primat du sujet [68].
Cette citation fournit la clé de l'entreprise de Foucault qui a voulu déconstruire la représentation moderne du pouvoir comme quelque chose d'extérieur que l'on peut s'approprier par la conquête (approche marxiste) ou par le contrat (approche des Lumières) et rendre possible une conception d'un pouvoir diffus qui s'insinue dans les corps et se loge dans tous les interstices du social. Il a voulu déconstruire le savoir comme idéologie [399] au service des intérêts, animée par le sujet historique. C'est en cela qu'il a pu être reconnu comme un des pères du courant postmoderniste. Cette conception du pouvoir est en effet celle qui est reprise par le mouvement social qui agit à l'extérieur des instances de gouvernement ou de gouvernance. L'acteur de Foucault est un sujet assujetti par les pouvoirs diffus et il n'a d'autre choix que de résister à cette entreprise de disciplinarisation des corps. Il ne peut être conçu comme sujet politique au sens moderne du terme. Cela nous permet de comprendre la multiplicité des sujets qui peuvent difficilement être réunis dans une figure unifiée d'un sujet collectif. Nous reprenons à notre tour [69] les propos de Hardt et Negri qui définissent cet acteur comme « un sujet multiple, intérieurement différencié, qui ne se construit pas et n'agit pas à partir d'un principe d'identité ou d'unité (et moins encore d'indifférence), mais à partir de ce qui lui est commun [70] ».
Nous ne nous attarderons pas longtemps sur la description de ces nouvelles expérimentations de la démocratie qui ont été largement introduites dans les chapitres qui précèdent. Nous proposerons de définir trois types d'expérience qui remettent en question chacune à leur manière les institutions de la démocratie représentative. La démocratie directe vise l'implication de l'ensemble de la communauté dans le processus délibératif. L'idée même de représentation disparaît au profit de la participation immédiate au processus de prise de décision. Les expériences de démocratie directe sont, en général, limitées par la taille de la population concernée. En l'absence de toute médiation et représentation, l'ensemble des membres de la communauté doit être impliqué dans le processus délibératif. Cette condition est difficilement réalisable en dehors des communautés restreintes et, à défaut, des mécanismes optimisant la participation doivent être imaginés. L'exemple le plus couramment mentionné est celui du budget participatif de Porto Alegre qui, pour s'accommoder des structures politiques existantes, se doit de limiter la portée et l'extension des décisions qui font l'objet de cette forme délibérative de démocratie. La démocratie directe s'exprime à la phase de consultation et de prise de décisions générales. Les formes d'organisation politique traditionnelles peuvent alors prendre le relais dans l'administration des politiques adoptées.
La contestation représente une seconde forme d'expérimentation démocratique. Elle s'inscrit en marge des processus de gouvernement et de gouvernance. Bien qu'elle puisse prendre appui sur les mêmes acteurs qui participent, en d'autres occasions, à ces instances, elle se distingue [400] par son refus ponctuel de participer et sa critique de la légitimité des modalités de prise de décision. Adoptent cette stratégie de contestation les publics dissidents [71] et les groupes manifestant à l'occasion des sommets ou des rencontres de négociation tenus par les grandes organisations internationales [72]. Leur mot d'ordre est de nier toute validité non seulement aux instances de la gouvernance, mais également aux négociations conduites par des gouvernements élus démocratiquement. La contestation met en cause les fondements du gouvernement démocratique y voyant une subversion de l'idée même de démocratie. Comme nous l'indique Drache, la dissidence devient une arme politique redoutable, car elle redonne à des groupes la possibilité d'agir là où il y a exclusion.
La troisième forme d'expérimentation démocratique peut être rendue par l'idée de démocratie décentrée. L'exemple des forums sociaux [73] illustre bien la radicalisation de la démocratie qui est à l'œuvre dans ce modèle. Il s'agit d'un refus des institutions politiques modernes fondées sur le principe de représentation et sur une organisation verticale de la société. À une conception de l'acteur politique dont le projet est d'accéder au pouvoir se substitue une conception d'un espace politique dans lequel se rencontrent un ensemble d'acteurs partageant une même critique générale de l'ordre social, mais ayant chacun leurs propres ordres du jour. Ce modèle s'inspire à la fois de la mouvance postmoderniste et postcoloniale qui préconise un décentrement de la démocratie et du tournant délibératif fondé sur la discussion [74]. D'un côté, la démocratie moderne est associée aux manifestations du colonialisme, c'est-à-dire à la domination et à la hiérarchisation culturelle et politique de la société. De l'autre, la démocratie décentrée s'exprime dans la capacité discursive des acteurs qui s'extraient du domaine exclusivement politique pour rejoindre l'ensemble des espaces sociaux et culturels. La démocratie radicale va au-delà du multiculturalisme, car celui-ci n'est qu'une stratégie politique soupçonnée de fondamentalement hiérarchiser les cultures. Ce modèle préconise, au contraire, d'instaurer dans l'ensemble des lieux de pouvoir une véritable démocratie délibérative qui ferait la part égale à toutes les cultures et à toutes les couches de la société.
Conclusion

La revanche des sociétés se manifeste par l'invention de nouvelles pratiques démocratiques. Le fait que ces nouvelles pratiques se développent [401] dans un ensemble de lieux différents est probablement le trait marquant de l'exercice démocratique actuel. Les crises institutionnelles qui se développent sur fond de mondialisation et de fragmentation des sociétés, expliquent cette dissémination de l'action démocratique. Les nouveaux mouvements sociaux ont depuis longtemps investi un ensemble de lieux où se manifestent des relations de pouvoir extrêmement complexes. Face à cela, le modèle de la démocratie représentative est en crise et les acteurs sociaux tentent, de tous les côtés, de traduire dans la réalité vécue cet idéal de représentation. À un pôle, on trouve les expériences démocratiques qui hésitent entre l'absence de représentation, par voie de contestation ou par négation même du principe, et une forme accomplie de représentation de la diversité sans hiérarchie. À l'autre pôle, les réformes et les innovations démocratiques tentent de substituer, à l'idée de représentation universelle, celle de représentativité de toutes les parties, soit dans les formes institutionnelles de la démocratie représentative, soit dans les instances de la gouvernance. Cette révision des formes de la représentation s'effectue dans une dialectique avec les tentatives d'accroissement de la participation citoyenne. Ces tentatives vont de la volonté la plus élémentaire de rendre effective une participation au système électoral, au désir d'inclure les parties prenantes dans les processus de la gouvernance jusqu'au projet de substituer à la représentation une participation sans médiation dont la légitimité serait désormais fondée sur la délibération. Il ne faut pas se faire d'illusion, les mêmes acteurs empruntent souvent à la fois l'ensemble de ces stratégies, sans toujours mesurer l'impact de chacun des choix. Inévitablement, il ne peut s'agir de répudier les institutions démocratiques modernes, mais concurremment l'existence des instances de la gouvernance interpelle les acteurs sociaux qui doivent choisir d'y participer, même si c'est d'un point de vue critique, ou de les contester. Enfin, l'expérimentation démocratique doit remplir sa fonction utopique de politique préfigurative [75].
Trois questions restent en suspens au terme de ce parcours. D'abord, quel sera dorénavant la nature du politique ? Peut-on esquiver la nécessité des institutions politiques modernes ? Comment réconcilier l'activité proprement politique des nouveaux mouvements sociaux dans les espaces nombreux, dans et hors l'État-nation ? La réponse semble aller dans le sens d'une inclusion de plus en plus large d'un ensemble de lieux non seulement dans la sphère étroitement politique, mais dans l'ensemble des sphères de l'activité humaine. Ensuite, la question de l'acteur politique est posée. Nous avons indiqué comment l'acteur prend de nombreuses figures. La réalisation de plus en plus étendue des droits citoyens a conduit à certaines formes d'incorporation des individus. Est-il possible de concevoir, [402] à certains niveaux, la possibilité d'une redéfinition de l'unité de la société ou sommes-nous condamnés à faire avec la diversité la plus complète ? Si Foucault a raison de mettre l'accent sur le caractère diffus du pouvoir, il a peut-être sous-estimé la capacité de certains acteurs de l'exercer au profit d'un nombre restreint d'individus. C'est pour cela qu'il nous semble inévitable d'investir toutes les pratiques démocratiques quelles qu'en soient leur nature réformatrice, innovatrice ou expérimentale.
* Chaire MCD Université du Québec à Montréal — Canada.
[1] La présente conclusion s'inspire, en partie, d'un texte publié dans Éthique publique, revue internationale d'éthique sociétale et gouvernementale, intitulé « Légitimité démocratique : représentation ou participation », printemps 2005, vol. 7, n° 1, p. 72-81. Elle reprend, tout en les développant et en les resituant dans un nouveau cadre, certaines des idées qui y sont présentées.
[2] Nous présenterons, dans la suite du texte, un modèle d'institutionnalisation démocratique qui a, à la fois, un caractère idéal typique et qui correspond au contexte de son développement historique en Occident. Nous sommes conscient que ce modèle ne s'est pas réalisé de façon équivalente dans l'ensemble des contextes géopolitiques, mais nous croyons qu'il a eu tendance à s'imposer progressivement, dans des déclinaisons différentes, soit à travers les diverses formes de colonialisme ou d'impérialisme, soit en raison de la capacité hégémonique des sociétés du Centre.
[3] Georges Burdeau, L'État libéral et les techniques politiques de la démocratie gouvernée, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1987, p. 49.
[4] Jean L. Cohen et Andrew Arato, Civil Society and Political Theory, Cambridge, MIT Press, 1999 ; David Held, Democracy and the Global Order, Standford, Standford University Press, 1995.
[5] Thomas Humphrey Marshall, « Citizenship and Social Class », dans Class, citizenship and Social Development, Garden City, New York, Anchor Books, 1965, p. 71-134.
[6] Les Grecs font clairement la distinction entre la sphère publique (sphère de la Polis] et la sphère privée (sphère de Voikos, terme qui constitue la racine étymologique de l'économie), ce qui leur permet de distinguer la chose commune [koiné] et la chose particulière ou individuelle (idia). Notons que l'unité économique [oikos] réfère à la famille.
[7] Voir une description de ces processus dans Gilles Bourque, Jules Duchastel et Éric Pineault, « L'incorporation de la citoyenneté », Sociologie et Sociétés, vol. XXXI, n° 2, 1999, p. 41-64.
[8] D. Held, op. cit. ; Charles Taylor, Les sources du moi : la formation de l'identité moderne, Montréal, Boréal, 2003.
[9] Norbert Elias, La dynamique de l'Occident, Paris, Calman-Lévy, 1975.
[10] T. H. Marshall, op. cit.
[11] Comme nous l'avons déjà souligné, nous nous centrons sur le processus de développement de la démocratie dans son contexte occidental d'émergence. Il n'est pas du tout évident que les exigences intrinsèques de ce développement se reproduisent nécessairement dans toutes les situations nationales, par exemple, dans les pays du Tiers monde ou les pays en émergence. Le développement d'une économie capitaliste en Chine, appuyé par un régime autoritaire communiste, montre comment une certaine liberté du marché et un début d'autonomie individuelle n'équivalent pas encore aux exigences de la démocratie. Cela confirme peut-être notre thèse selon laquelle la démocratie ne peut s'instaurer sans liberté et autonomie des individus.
[12] G. Burdeau, op. cit. ; Christine Couvrat aborde dans le présent ouvrage, au chapitre 10, ce problème quand elle dit : « Pendant plus d'un siècle, des révolutions américaine et française jusqu'à la stabilisation provisoire des régimes démocratiques au début du XXe siècle, les pères de la pensée politique moderne (ainsi que leurs héritiers) se sont donné beaucoup de mal pour imaginer les mécanismes institutionnels par le biais desquels il serait tout à la fois possible de reconnaître pleinement la souveraineté du peuple tout en disciplinant les demandes de la société de telle sorte que la raison soit le fondement de ses actions », p. 229.
[13] G. Burdeau, op. cit.
[14] On trouve chez Habermas la même idée lorsqu'il parle de la colonisation du monde vécu par le système. Jiirgen Habermas, Théorie de l'agir communicationnel, Paris, Fayard, 1987. C. Couvrat nous parle, au chapitre 10, d'un brouillage des prémisses théoriques du modèle de la démocratie, entre autres de la distinction fondatrice entre espaces public et privé qui tend à se dissoudre.
[15] Michel Freitag, Dialectique et société, 2 Culture, pouvoir, contrôle. Les modes de reproduction formels de la société, Montréal, Editions Saint-Martin, 1986. François Thuot, La fin de la représentation et les formes contemporaines de la démocratie, Montréal, Editions Nota Bene, 1998. Ces auteurs, ainsi que C. Couvrat, mettent l'accent sur la dimension opérationnelle ou administrative de la régulation qui répond désormais à un ensemble de demandes et de problèmes différenciés, au détriment de l'élaboration et de la mise de l'avant de projets à portée générale concernant la société comprise comme totalité.
[16] Gesta Esping-Andersen, Les trois mondes de l’État-providence. Essai sur le capitalisme moderne. Paris, PUF, 1999.
[17] Friedrich August Hayek, Droit, législation et liberté, tome 3 : L'Ordre politique d'un peuple libre, Paris, PUF, 1995.
[18] G. Burdeau, op. cit.
[19] Ulrich Beck, La société du risque : sur la voie d'une autre modernité, Paris, Aubier, 2001, p. 15.
[20] Nous avons laissé de côté pour l'instant la question de la forme néolibérale de l'Etat qui se développera dans le contexte des crises institutionnelles de l'État-nation.
[21] Par contraste, la société définie comme totalité renvoie à l'ensemble des institutions et des rapports sociaux, en somme à la totalité sociale. Dans ce sens sociologique étendu, la société engloberait l'ensemble des institutions appartenant aux trois sphères : l'Etat, le marché, les institutions culturelles, sans parler de la sphère de la vie privée.
[22] Benedict Anderson, L'imaginaire national. Réflexions sur l'origine et l'essor du nationalisme. Paris, La Découverte, 2002.
[23] Max Weber, Economy and Society, traduit par Guenther Roth and Claus Wittich (dir.), Berkeley, University of California Press, 1978.
[24] Bruno Théret, « Le fédéralisme, moteur ou régulateur de la mondialisation », dans Jules Duchastel (dir.), Fédéralismes et mondialisation. L'avenir de la démocratie et de la citoyenneté, Montréal, Athéna éditions/Chaire MCD, 2003, p. 29-63. L'auteur explique que le principe de souveraineté prend une signification étendue dans le contexte du fédéralisme. « Au niveau très général, le principe fédéral est un principe d'autonomie dans l'hétéronomie, d'indépendance dans l'interdépendance, qui permet de considérer comme dynamiquement stable un système où le partage de la souveraineté entre des ordres différents de gouvernement va néanmoins de pair avec une forme d'intégration territoriale sanctionnant une interdépendance assumée et contraignante assurant l'unité du politique malgré sa fragmentation », p. 40.
[25] Josepha Laroche, au chapitre 1, identifie un ensemble de facteurs qui conduisent progressivement à la constitution d'un système transnational en lieu et place du système international : irruption d'une multiplicité hétérogène d'acteurs non étatiques, transnationalisation de flux de tous ordres, intrication de l'économique et du politique, déclassement du rôle de l'Etat. Elle conclut : « Le passage d'un monde interétatique à un monde transnational ne signifie pas pour autant que les Etats ont cessé déjouer un rôle déterminant dans la politique mondiale, loin s'en faut. En revanche, il est certain que, retranchés derrière un principe de souveraineté chaque jour plus obsolète, ils ne détiennent plus le monopole de l'action publique et se trouvent désormais contraints de composer avec d'autres intervenants afin de pouvoir réajuster leurs prérogatives de plus en plus souvent entravées », p. 61.
[26] Monique Chemillier-Gendreau est extrêmement critique à l'égard du concept de souveraineté. Elle nous dit : « La crise des souverainetés est en germe dès l'origine : aucune rationalité ne préside à la division du monde entre Etats et à l'attribution du pouvoir souverain à tel groupe plutôt qu'à tel autre. [...] La fiction de l'universel d'une société au profit de l'Etat permet de présenter comme homogènes des groupes en réalité puissamment hétérogènes (lutte des classes, multinationalités, hiérarchies implicites) », p. 67.
[27] Stephen D. Krasner, « Globalization and Sovereignty », dans David Smith, Dorothy Solinger et Steven Topik (dir.), States and Sovereignty in the Global Economy, New York, Routledge, 1999, p. 34-52.
[28] Stephen D. Krasner, « Compromising Westphalia », dans David Held, Anthony McGrew, The Global Transformations Reader. An Introduction to the Globalization Debate, Cornwall, Polity Press, 2000, p. 124-135.
[29] David Held et Anthony McGrew, « The Great Globalization Debate : An Introduction », dans D. Held, A. McGrew, op. cit.
[30] « Sovereignty is less a territorially defîned barrier than a bargaining resource for a politics characterized by complex transnational networks », Robert O. Keohane, « Sovereignty in International Society », dans D. Held, A. McGrew, op. cit., p. 117 (traduction libre).
[31] Manuel Castells, The Information Age : Economy, Society and Culture, Vol. 1 : The Rise of the Network Society, Malden, Blackwell, 1996. Arjun Appadurai, Après le colonialisme. Les conséquences culturelles de la globalisation, Paris, Payot, 2005.
[33] Jacques Chevalier, L'État post-moderne, Paris, LGDJ, 2004 ; André-Jean Arnaud, Critique de la raison juridique, 2. Gouvernants sans frontières. Entre mondialisation et post-mondialisation, Paris, LGDJ, 2003 ; Daniel Mockle, Mondialisation et État de droit, Bruxelles, Bruylant, 2002.
[34] A. Appadurai, op. cit.
[36] Anthony D. Smith, « Towards a Global Culture », dans D. Held, A. McGrew, op. cit.
[37] « The idea of a "global culture" is a practical impossibility », dans A. D. Smith, op. cit., p. 239.
[38] Nous reprenons ici les idées générales développées dans des travaux qui ont traité exhaustivement de ces sujets. Voir Gilles Bourque et Jules Duchastel, L'identité fragmentée. Nation et citoyenneté dans les débats constitutionnels canadiens, 1941-1992, Montréal, Fides, 1996 ; Jules Duchastel, « Citoyenneté incorporée et nouvel espace des nations », dans Claude Couture (dir.), Fédéralisme, identités et nationalismes, numéro spécial de la Revue d'études constitutionnelles, vol. 7, n° 1 et 2, 2002 ; G. Bourque, J. Duchastel et E. Pineault, op. cit.
[39] Si l'on se réfère au Canada, on constate que ces solutions n'ont pas toujours réussi à satisfaire les aspirations de toutes les parties.
[40] Jacques Beauchemin, La société des identités. Éthique et politique dans le monde contemporain, Montréal, Athéna éditions/Chaire MCD, 2004.
[41] G. Bourque et J. Duchastel, op. cit.
[42] T. H. Marshall, op. cit.
[43] Des développements de ces idées se trouvent dans G. Bourque et J. Duchastel, op. cit. et dans Raphaël Canet et Jules Duchastel (dir.), La régulation néolibérale. Crise ou ajustement ?, Montréal, Athéna éditions/Chaire MCD, 2004.
[44] On trouve ainsi cette critique au sein du parti conservateur actuellement au pouvoir au Canada (au moment d'écrire ces lignes). On la trouve également à gauche chez Michael Mandel, ha Charte des droits et des libertés et la judiciarisation du politique au Canada, Montréal, Boréal, 1996.
[45] M. Mandel, op. cit. ; Andrée Lajoie, Jugements de valeurs, Paris, PUF, 1997.
[46] Plusieurs analystes du droit ont évoqué ce mouvement de techo-bureaucratisation. « On peut se demander si, au terme de cette évolution, on ne parviendra pas à une juridicisation intégrale de l'ordre social, et à une utilisation exclusive du registre du droit pour modeler les comportements sociaux » (Jacques Chevalier, L'ordre juridique. Le droit en procès, Paris, PUF, 1983, p. 36.) ; Jacques Lenoble ajoute qu'« aux paradigmes du droit formel, caractéristique du premier État libéral, et du droit matériel, propre à l'Etat social, succède aujourd'hui le paradigme du droit procédural, lui-même lié à une déformalisation corrélative du droit et de l'Etat » (Jacques Lenoble, Droit et communication, Paris, Cerf, 1994, p. 20).
[47] Nous retiendrons, dans les développements qui suivent, la définition moderne du gouvernement démocratique, fondé sur la forme de domination et de légitimation rationnelle (M. Weber, op. cit.) et sur l'existence des institutions démocratiques. Il est entendu que des gouvernements particuliers peuvent s'appuyer sur d'autres formes institutionnelles, rendant la distinction entre gouvernement et gouvernance plus difficile à établir.
[48] La question de la participation démocratique s'est posée assez tardivement dans les instances de gouvernance. Par exemple, les firmes et les organisations internationales ont introduit assez récemment des mécanismes concrets pouvant favoriser cette participation, après avoir surtout insisté sur la dimension éthique de la gouvernance.
[49] J.-E Thuot, op. cit.
[50] T. H. Marshall, op. cit.
[51] Jürgen Habermas, Après Vétat-nation, Paris, Fayard, 2000.
[52] Nous parlons ici de pratiques démocratiques pour indiquer que si elles participent de l'idée démocratique, elles ne sont pas nécessairement instituées.
[53] Commission du droit du Canada, Un vote qui compte : la réforme électorale au Canada, 2004.
[55] Nous n'entrons pas ici dans le débat extrêmement vif entre les tenants du système majoritaire et ceux qui favorisent une forme ou l'autre de proportionnelle. Essentiellement, les tenants du statu quo font appel aux arguments d'efficience et de gouvernement de la majorité. Les tenants de la proportionnelle réclament, au contraire, plus d'équité dans la représentation et la reconnaissance du droit des minorités.
[56] La Commission du droit du Canada stipule dans son document qu'il est souhaitable que la participation des citoyens puisse se poursuivre dans un ensemble de forums ayant une portée consultative.
[57] G. Bourque et J. Duchastel, op. cit.
[58] Les Nations Unies peuvent jusqu'à un certain point être conçues comme une organisation politique, mais elles ne peuvent être considérées comme une forme de gouvernement mondial. L'idée d'une structure de gouvernement mondial demeure pour l'instant dans le domaine de l'utopie. David Held [Democracy and the Global Order. From the Modem State to Cosmopolitan Governance, Standford, Stanford University Press, 1995) propose un tel modèle utopique de démocratie cosmo-politaine qui répondrait à l'ensemble des défis soulevés par les mutations actuelles des sociétés. Dans le contexte du réseau de plus en plus complexe des lieux de pouvoirs, il suggère que tout groupe ou association, ayant une capacité d'autodétermination, adhère au principe d'autonomie et à un ensemble de droits et d'obligations communs à l'ensemble de l'humanité. Des principes légaux devraient être adoptés pour encadrer l'action individuelle et collective. Même si les fonctions législative et administrative continueraient de s'exercer à une multitude de niveaux de gouvernements, la défense de l'autodétermination, la création d'une structure commune de l'action politique et la préservation du bien démocratique devraient valoir pour tous. Enfin, les citoyens se définiraient par une appartenance multiple et leur participation serait encouragée à tous les niveaux de gouvernement.
[59] Mario Dehove, « Mondialisation et institutions européennes », dans J. Duchastel (dir.), op. cït, p. 65-93.
[60] Voir le chapitre 12 de Jan Aart Scholte dans ce volume.
[62] Voir le chapitre 16 de René Audet, Raphaël Canet et Jules Duchastel dans ce volume.
[63] Au Sommet sur la Société de l'information, tenu sous l'égide de l'UIT, les intérêts du secteur privé étaient défendus par les partenaires économiques directement impliqués dans la négociation au côté des Etats, mais également par un unique comité de coordination des interlocuteurs économiques créé par la Chambre de commerce internationale.
[64] Voir le chapitre 12 de Jan Aart Scholte dans ce volume.
[65] Voir Claudia Padovani, « Civil Society Organizations beyond WSIS : Rôles and Poten-tial of a "Young" Stakeholder », dans Olga Drossou et Heike Jensen, Visions in Process II, The World Summit on the Information Society, Berlin, Heinrich Bôll Foundation, 2005.
[66] Jan Aart Scholte, Democratizing the Global Economy. The Rôle of Civil Society, Warwick, Centre for the Study of Globalisation and Régionalisation, 2003.
[67] Des éléments importants de cette discussion se trouvent au chapitre 11 de Raphaël Canet et Simon Perrault dans ce volume.
[68] Michel Foucault, Surveiller et Punir, Paris, Fayard, 1975, p. 33.
[69] Tel que le font R. Canet et S. Perrault, chapitre 11.
[70] Michaël Hardt et Antonio Negri, Multitude. Guerre et démocratie à l'âge de l'Empire, Montréal, Boréal, 2004, p. 126. Voir également, Michaël Hardt et Antonio Negri, Empire, Paris, Exils Editeur, 2000. Dans ce dernier ouvrage, les auteurs appuient leurs développements théoriques sur l'œuvre de Foucault.
[71] Voir le chapitre 8 de Daniel Drache dans ce volume.
[72] Voir R. Audet, Raphaël Canet et Jules Duchastel dans ce volume.
[73] Voir le chapitre de R. Canet et S. Perrault.
[74] Ian Angus, « La démocratie décentrée : un modèle multiculturel et postcolonial de la critique », dans Jules Duchastel (dir.), op. cit., p. 169-184.
[75] Voir le chapitre de R. Canet et S. Perrault.
|

