|
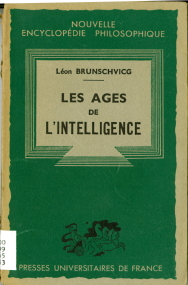 Introduction Introduction
MATURITÉ OU DÉCRÉPITUDE
Le problème des âges de l’intelligence s’est posé dans toute sa netteté dès que la constitution d’une physique véritable eut mis en évidence la vanité de ce qui passait jusqu’alors pour connaissance rationnelle de la nature. M. Gilson remarque, au cours de ses précieuses recherches sur La formation du système cartésien et la critique des formes substantielles : « La physique aristotélicienne de la scolastique repose tout entière sur cette hypothèse que l’univers de l’enfant est l’univers réel ; elle nous décrit précisément ce que l’univers serait si nos impressions sensibles et affectives étaient des choses, elle consacre et stabilise définitivement l’erreur de nos premières années en supposant l’existence de formes ou de qualités réelles, qui ne sont rien d’autre que les impressions confuses de notre intelligence nommées, décrites et classées comme autant de réalités [1]. »
Le Discours de la Méthode conserve le souvenir de la stupéfaction dans laquelle l’écolier de La Flèche avait été jeté par des maîtres assurément respectables, mais dont les cheveux avaient blanchi sans que l’esprit ait mûri. Sortes d’« automates » dressés à répéter en écho les leçons d’autrefois, ils se flattaient de saisir l’être à travers un jeu de généralités verbales, s’enchantant eux-mêmes d’une perpétuelle pétition de principes.
Chose curieuse, si Descartes avait rouvert les livres de cet Aristote qu’involontairement ils lui avaient appris à dédaigner, il y aurait vu que, dès le début de sa Physique, Aristote déposait contre lui-même. Rien ne souligne mieux le caractère vague et confus, essentiellement puéril, d’un savoir conceptuel. « Les enfants appellent d’abord tous les hommes pères et mères toutes les femmes ; c’est seulement ensuite qu’ils les distinguent les uns des autres [2]. » Mais l’antiquité n’a réussi à saisir ni l’exacte portée des relations mathématiques ni les méthodes précises de l’expérience scientifique. Aristote ne pouvait dépasser le plan de la perception et de la dénomination auxquelles il demande les moyens d’achever l’édifice de sa philosophie sans tirer parti d’une observation qui, du point de vue de la philosophie moderne, est cependant décisive, pour discerner les différents types de la représentation du monde et en apprécier la valeur.
Cette rupture entre les deux rythmes de durée — temps biologique qui est vieillissement inévitable et décadence finale, temps spirituel qui est redressement incessant, progrès continu -Blaise Pascal l’a dégagée dans un fragment posthume de Préface, où il développe avec une vigueur inoubliable l’aphorisme baconien Antiquitas saeculi, juventus mundi [3]. « Ceux que nous appelons Anciens étaient véritablement nouveaux en toutes choses, et formaient l’enfance des hommes proprement ; et comme nous avons joint à leurs connaissances l’expérience des siècles qui les ont suivis, c’est en nous que l’on peut trouver cette antiquité que nous révérons dans les autres [4]. »
Sans doute Pascal restreint au domaine profane la nécessité du progrès pour cet « homme universel » que constitue à ses yeux l’espèce entière, considérée dans l’ensemble de ses âges successifs. En ce qui touche la religion, au contraire, il professe, suivant l’enseignement de l’Évangile, que « la Sagesse nous envoie à l’enfance » [5]. Mais le xviiie siècle, recevant à travers Malebranche et Fontenelle la pensée de Pascal, l’étend à l’unité indivisible de la civilisation ; et en même temps il la précise. Le mouvement par lequel l’esprit humain échappe à la fatalité d’usure et de déchéance qui pèse sur toute vie individuelle, consiste, non pas seulement dans une accumulation quantitative de découvertes, mais dans une transformation de qualité, dans un sens de plus en plus scrupuleux et affiné des conditions de la vérité. A cet égard la page classique de Turgot pousse aussi loin que possible l’analyse de l’histoire : « Avant de connaître la liaison des effets physiques entre eux, il n’y eut rien de plus naturel que de supposer qu’ils étaient produits par des êtres intelligents, invisibles et semblables à nous ; car à quoi auraient-ils ressemblé ?... Quand les philosophes eurent reconnu l’absurdité de ces fables, sans avoir acquis néanmoins de vraies lumières sur l’histoire naturelle, ils imaginèrent d’expliquer les causes des phénomènes par des expressions abstraites, comme essences et facultés, expressions qui cependant n’expliquaient rien... Ce ne fut que bien plus tard, en observant l’action mécanique que les corps ont les uns sur les autres, qu’on tira de cette mécanique d’autres hypothèses que les mathématiques purent développer et l’expérience vérifier [6]. »
On serait tenté de dire que Comte, en proclamant la Loi des trois États — théologique, métaphysique, positif — n’a rien ajouté aux vues fondamentales de Turgot si, préoccupé en réalité d’action sociale plus que de vérité spéculative, il n’avait pas introduit dans le système auquel il a donné le nom de positivisme des idées d’origine et d’orientation bien différentes, au risque de jeter une confusion presque inextricable sur le problème des âges de l’intelligence, clairement défini par les siècles précédents. D’où l’utilité de précautions de vocabulaire et de méthode sur lesquelles il conviendra d’insister si nous voulons donner à notre étude une base solide et une force démonstrative.
La doctrine du progrès, telle que les Encyclopédistes et Condorcet l’avaient rendue populaire, ne sera plus chez Comte qu’une façade derrière laquelle se dissimule l’adhésion au mouvement romantique qui, en France comme en Angleterre et en Allemagne, tendait à ramener vers le Moyen Age la pensée du xixe siècle. Et cette juxtaposition de thèses hétéroclites sous l’uniformité voulue du langage ne se concevrait pas chez un écrivain aussi « énergique » et aussi réfléchi si nous ne savions qu’il s’inspire d’une sorte de consigne reçue à l’école de Saint-Simon, et que Comte va exécuter à la lettre sans d’ailleurs nommer le Dr Burdin qui en est cependant responsable. En 1813 (lorsque celui qui devait fonder le positivisme n’avait encore que 15 ans) Saint-Simon rend publics les thèmes que Burdin lui avait fournis et dont la dualité devait commander l’évolution de la carrière suivie par Auguste Comte et déterminer le sens de son influence. Le premier de ces thèmes est emprunté à Turgot : « Toutes les sciences ont commencé par être conjecturales : le grand ordre des choses les a appelées à devenir positives. » Et Burdin ajoutait : « La physiologie ne mérite pas encore d’être classée au nombre des sciences positives ; mais elle n’a plus qu’un seul pas à faire pour s’élever complètement au-dessus de l’ordre des sciences conjecturales [7]. » Or, par un singulier revirement, ce pas unique et décisif devrait, au gré de Burdin, être fait, non pas en avant mais en arrière. Autrement dit, la physiologie de l’avenir tournera résolument le dos aux procédés qui ont fait sortir les autres disciplines de l’état « conjectural ».
De toute évidence, si l’on peut parler d’une astronomie ou d’une chimie positive, c’est qu’on s’y conforme strictement à la méthode d’analyse qui, suivant la parole souveraine de Condillac, « ne découvre point de vérité qu’elle ne la démontre » [8], c’est que, dès lors, les assertions des savants y sont soustraites à l’arbitraire des idées générales, des synthèses anticipées, qui traduisent seulement le génie original ou excentrique de leur auteur. Et le second thème de Burdin va consister dans le refus systématique de l’analyse, dans une sortie d’attrait nostalgique pour la subjectivité de la synthèse.
Il ne lui suffira pas de croire à l’existence d’une « force vitale » qui, « comme celle d’affinité et celle d’attraction, est universellement répandue » [9] ; il faudra qu’au nom de cette croyance, il accable d’invectives virulentes les « mathématiciens » qui « sont à la tête de l’Institut : Brutiers infinitésimaux, algébristes et arithméticiens, quels sont vos droits pour occuper le poste d’avant-garde scientifique ? La science de l’homme est la seule qui puisse conduire à la découverte des moyens de concilier les intérêts des peuples et vous n’étudiez point cette science... Quittez la présidence, nous allons la remplir à votre place » [10]. L’éloquence de cette apostrophe que, plus tard, il se contentera de paraphraser, a dû frapper Comte d’autant plus profondément que, sous une apparence de précision technique, Burdin reflétait les tendances dont s’inspirait alors la biologie « organiciste » des métaphysiciens allemands, et donnait ainsi le moyen de rejoindre le dogmatisme théocratique des publicistes français que Comte devait avouer pour les inspirateurs directs de son système de sociologie.
En niant l’unité de la science humaine, en orchestrant tour à tour les deux thèmes du Dr Burdin, pour faire immédiatement succéder, comme si la chose allait de soi, la fantaisie romantique de la synthèse au scrupule classique de l’analyse, Comte contredit au principe du progrès que le xviiie siècle avait posé par la Loi des trois États ; il brise l’élan de spiritualité qui est à la source de la civilisation moderne. Aux antipodes du positivisme de raison, qui fait conscience à l’homme de rien affirmer comme vrai qu’il ne soit en état de vérifier objectivement et que Littré recueille dans l’héritage de Comte comme le legs de Fontenelle et de Turgot, il y a un positivisme d’Église, fondé tout entier sur le sentiment de confiance qu’un homme éprouve (et fait partager) dans la valeur unique de sa pensée et où il puise l’illusion de pouvoir créer la méthode et dicter à l’avance les résultats de disciplines qui ne sont pas encore constituées à l’état de science. La nécessité psychologique qui fait que le soi-disant prophète ne peut emprunter sa figuration de l’avenir qu’aux ombres du passé condamne Auguste Comte à parcourir, mais en sens inverse, en marche arrière, tous les âges de l’histoire, jusqu’à ce que de paradoxe en paradoxe, de préjugé en préjugé, il ressuscite l’état théologique sous la forme la plus grossière du fétichisme. Finalement son œuvre revient à exprimer dans un langage unique deux représentations du monde, deux conceptions de la vie, qui sont diamétralement opposées.
Encore n’aurait-il pu prendre de façon aussi brusque cette attitude dogmatique et rétrograde sur le terrain de la sociologie s’il ne lui était arrivé déjà de manquer à l’esprit positif dans son interprétation des sciences positives. Il est curieux d’avoir à le constater : le penseur qui a le plus heureusement insisté sur l’importance primordiale de l’histoire des sciences pour interpréter légitimement l’évolution de l’humanité, semble, tout autant que Hegel et parce qu’il est, lui aussi, un théologien ambitieux de soumettre la suite des temps à la loi d’un système préconçu, avoir été privé du sens de ce qu’il y a de radicalement historique dans l’histoire, d’irréductible aux généralités conceptuelles dont on prétend lui imposer le cadre. Chez Comte l’examen des fondements et des ressources de la mathématique et de la physique devient un prétexte pour rétrécir l’horizon du savoir humain. Il ne veut pas regarder — et il voudrait que personne ne regardât — au delà des limites que son éducation ou son parti pris lui ont tracées.
Nous n’avons pas à insister ici sur les excommunications pompeuses, sur les anathèmes ridicules, qu’il dirige contre la précision de la technique expérimentale, suspecte de menacer la simplicité de formules comme la loi de Mariotte, ou contre le calcul des probabilités alors pourtant que Condorcet en avait démontré l’intérêt capital pour l’étude des phénomènes sociaux et que Laplace en avait précisé l’application du point de vue mathématique. Il y a lieu seulement d’en retenir des avertissements susceptibles de couper court à l’ambiguïté qui vicierait dès son origine toute notre recherche. Il ne suffira pas que nous nous gardions de nous aventurer hors des disciplines qui sont maintenant en possession incontestable d’une méthode positive ; il conviendra encore, dans la considération de ces méthodes elles-mêmes, de respecter la continuité de durée et de progrès qui est le caractère de l’intelligence. Si la philosophie scientifique du positivisme était, dès son apparition, en retard sur le cours effectif du savoir rationnel, ce n’est nullement parce que Comte s’était flatté de rompre avec le réalisme de sens commun ou avec la métaphysique de l’âge préscientifique, mais, bien au contraire parce qu’il s’est arrêté à mi-chemin de son entreprise, parce que chez lui la notion de fait général ou la formule abstraite de la loi portent encore la trace du vocabulaire scolastique. Les défauts trop visibles du comtisme ne se corrigeront que par une adaptation plus étroite de l’« esprit positif » au progrès des sciences.
L’effort du philosophe pour suivre dans sa subtile complexité l’œuvre des hommes qui marchent en tête du corps d’exploration de la nature comporte un certain risque. « Celui qui veut savoir et non pas avoir l’air de savoir (remarque M. Émile Chartier) passera dix ans à la géométrie et à la mécanique, découvrant pour son compte toutes sortes de vérités connues, mais le vaniteux court au dernier mirage de la physique [11]. » Il conviendra de ne pas perdre de vue l’observation, et pourtant de ne pas s’en laisser intimider jusqu’à reculer devant une nécessité qui est inscrite dans la nature du monde. L’esprit souhaiterait sans doute que la science ne cessât de se développer en ligne droite à partir des propositions les plus claires et qu’elle pût se borner à tirer de principes incontestés des conséquences encore inaperçues sans avoir à modifier l’ordre des éléments. Seulement il est vrai qu’il n’en est pas ainsi : l’histoire de l’individu et l’histoire de l’espèce ne présentent pas le même rythme. Il est arrivé que chaque découverte décisive, non pas seulement en physique mais en mathématique, a provoqué un retour de réflexion qui a pour résultat de transformer le caractère des éléments et des principes, érigés précipitamment en réalités ultimes et en évidences absolues. D’Alembert avait beau proclamer que « la vérité est simple » : dès qu’il a eu à formuler « la définition et les propriétés de la ligne droite ainsi que des lignes parallèles », on le voit avouer qu’il y avait là, pour les Éléments de la géométrie, « un écueil et, pour ainsi dire, un scandale » [12] ; et on comprend aujourd’hui pourquoi. Si chaque enfant doit passer par la géométrie d’Euclide avant d’aborder la géométrie de Lobatschewski ou de Riemann, la constitution des géométries non euclidiennes a dû intervenir pour que les hommes réussissent à situer dans sa perspective de vérité la géométrie d’Euclide, à saisir exactement la signification de ses postulats et de ses définitions, à se donner une idée fine et juste de sa capacité démonstrative. Même dans le domaine de l’analyse, où l’intelligence s’est détachée de toute matière extérieure pour n’avoir qu’à faire fond sur sa propre liberté, il y a une nature qui vient rabattre l’orgueil de l’a priori, qui nous oblige de nous persuader qu’il est également vain de prétendre juger ou du monde sur ses apparences les plus immédiates ou de la raison par ses actes les plus élémentaires.
Rien n’est péremptoire à cet égard comme les pages où M. Jacques Hadamard rappelle comment s’est opérée avec Cardan et Descartes l’introduction des imaginaires : « Cette introduction par laquelle semblent franchies les barrières qui séparent la logique de la déraison », a servi « à éclairer d’une lumière chaque jour plus éclatante la marche de la science du xviie au xixe siècle ; et l’on a pu dire que le plus court chemin entre deux vérités du domaine réel passe souvent par le domaine imaginaire... C’est à Cauchy (écrit-il encore) que l’on doit d’avoir illuminé d’une entière clarté la notion des functiones continuae ou, comme nous disons aujourd’hui, des fonctions analytiques. Tout ce qui restait mystérieux, tant qu’on se borne à considérer les points réels de la courbe, s’éclaircit au contraire avec Cauchy lorsqu’on ne craint pas d’y ajouter les points imaginaires » [13].
Simplifier le bagage au départ n’aurait qu’une apparence d’économie et de sagesse si le voyage devait être rendu plus pénible et finalement plus onéreux par l’insuffisance et la pauvreté de l’équipement. Les bases du système héliocentrique qui exige un renversement de la perspective sensible, sont assurément plus paradoxales et compliquées que celles du système géocentrique qui est immédiatement appuyé aux données du sens commun. Seulement, une fois ces bases admises, il sera bien plus aisé de rejoindre les phénomènes. C’est du point de vue d’une connaissance supérieure, à un degré plus haut de vérité, que l’erreur, ainsi que l’a enseigné admirablement Spinoza, s’avère à titre d’erreur, en même temps qu’elle se justifie comme moment nécessaire dans le progrès de la raison humaine. A la lumière d’Einstein, nous comprenons Newton, ce en quoi il triomphait, ce par quoi il était arrêté, mieux qu’il n’a pu le faire lui-même lorsqu’il rédigeait ses Principes. De l’ordre pédagogique de l’acquisition du savoir il serait donc présomptueux de conclure à l’ordre philosophique de la réflexion sur le savoir. La superstition des principes évidents et des éléments absolus, fausse fidélité de l’homme à l’enfant, indique un tempérament plus obstiné que raisonnable.
Si l’étude des âges de l’intelligence peut provoquer quelque inquiétude, c’est plutôt chez des esprits portés à s’alarmer pour le crédit d’une métaphysique qui se rendait imprudemment solidaire d’une certaine époque dans l’histoire où ils imaginent que la recherche de la vérité a dû se cristalliser et s’achever. Les dernières lignes des Gifford Lectures que M. Gilson a faites récemment à l’Université d’Aberdeen, sont significatives : « Triste vieillesse que celle qui perd la mémoire. S’il était vrai, comme on le dit, que saint Thomas ait été un enfant et Descartes un homme, nous serions bien près de la décrépitude [14]. » L’actualité de notre problème ne saurait être mieux précisée, sans que nous puissions, au seuil de notre enquête, préjuger la réponse que les faits y apporteront. Contentons-nous d’observer que d’Aristote à Descartes l’intervalle est de vingt siècles. En revanche, trois cents ans à peine se sont écoulés depuis que la physique est entrée en possession d’une méthode qui la met en mesure de satisfaire franchement à l’exigence de la raison et de la vérité. La décadence dont M. Gilson nous apporte le pronostic amer et sinistre serait singulièrement rapide. Or, à première vue tout au moins, il nous paraît excessif de prétendre que le temps ait été si mal employé, que la génération d’Einstein et de Louis de Broglie se présente les mains vides dans la suite des merveilleuses victoires d’intelligence qui ont approfondi et rectifié notre connaissance du monde. Il faudrait être de bien méchante humeur pour ne pas partager l’enthousiasme qu’exprime M. Couderc, au cours de son exposé sur l’Architecture de l’univers : « Le plus émouvant moment de notre race n’est-il pas celui que nous vivons, où l’homme a la révélation subite et non pas progressive de la profondeur des abîmes où son regard plonge ? Il explore aujourd’hui, en proie à quelque vertige, l’immensité [15]. »
D’autre part, est-il sûr que nous soyons si vieux, en nous référant aux critères mêmes de M. Gilson et qui intéressent particulièrement notre objet ? La perte de mémoire, l’oubli du passé, où il relèverait des signes de décadence, ne sont-ils pas les derniers reproches que notre époque a pu mériter ? Bien plutôt sera-t-on disposé à la plaindre comme une victime des excès et des abus de l’histoire. Et certes il serait ridicule d’accabler Aristote et ses commentateurs sous un amas de découvertes où personnellement on n’est pour rien. Mais que l’on compare l’imago mundi du Moyen Age à l’horizon des astronomes de nos jours. Et plus prodigieux encore, plus littéralement invraisemblable, est le contraste entre la chronologie mesquine de la création selon Moïse et les perspectives dont nous sommes redevables, ne fût-ce que pour la terre, aux conquêtes de la géologie, de l’anthropologie et de l’archéologie. A quoi il convient d’ajouter qu’il ne s’agit pas d’une extension simplement quantitative de notre mémoire collective ; une fois de plus, le progrès quantitatif doit retenir notre attention. Connaître les mythes, ce n’est pas seulement être en état d’en redire le contenu, c’est comprendre que ce sont des mythes. De même, pour les souvenirs d’enfance, il faut acquérir le sentiment qu’ils viennent de l’enfant, afin de les reporter à leur date et de les mesurer à leur valeur. La décrépitude véritable ne consisterait-elle pas, en effet, à retomber dans un état puéril d’inconscience, à penser ou du moins à parler comme au xiiie siècle quand l’humanité avait les neuf ans d’Aristote, tandis qu’on respire et qu’on s’exprime au xxe ?
La mémoire, M. Bergson en particulier y a insisté de la manière la plus profonde et la plus persuasive, n’est parfaite que si elle demeure inséparable de l’indice temporel, du moment où le souvenir a son attache et qui en constituera, une fois pour toutes, la saveur originale. Or c’est précisément en s’engageant dans cette voie que psychologues et sociologues parviennent à discerner des plans de durée dans l’évolution de la pensée humaine, à déterminer pour elle-même, sans référence arbitraire qui la dénature, les traits constitutifs de ce qu’on appelle la mentalité primitive et qui l’apparente d’une façon si frappante à la mentalité de l’enfant. Leurs travaux répondent très exactement au vœu de M. Gilson. Et parce qu’ils nous préservent du danger de décrépitude, ils sont des facteurs essentiels à considérer pour qui entreprend de résoudre un problème comme celui de préciser, suivant une méthode impartiale et objective, l’âge de l’intelligence humaine avant et après Descartes.
[1] Études sur le rôle de la pensée médiévale dans la formation du système cartésien, 1930, p. 170.
[2] I, 1 ; 184 b 12, trad. Carteron, 1926, p. 30.
[3] De Dignitate et Augmentis Scientiarum, I, 38, Cf. Novum Organum, I, 84.
[4] Œuvres complètes, Édition Hachette, t. II, 1908, p. 141.
[5] Pensées, f° 165, fragment 271, avec renvoi à Matth. XVIII, s.
[6] Œuvres de Turgot, Édition Schelle, t. I, 1913, p. 315.
[7] Apud Mémoire sur la science de l’homme : L’œuvre de Saint-Simon, par Bouglé, 1925, p. 60 et suiv.
[8] Traité des systèmes, 1749, chap. XVII ; Œuvres, 3e édit, t. II, 1787, p. 297.
[9] Cf. Le progrès de la conscience dans la philosophie occidentale, 1927, § 255, t. II, p. 538, note.
[11] Libres propos d’Alain (Nouvelle Revue Française, 1er Mars 1933, p. 505).
[12] Éléments de philosophie. Éclaircissements, § 11. Œuvres, édit., 1767, t. V, p. 206.
[13] La pensée française dans l’évolution des sciences exactes (France et Monde, 20 mars 1923, pp. 326 et 336).
[14] L’esprit de la philosophie médiévale, t. II, 1932, p. 226.
|

