|
[vii]
Labrador et Anticosti
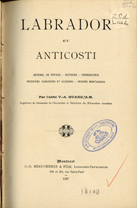 Avant-propos Avant-propos
Il y eut un temps, qui n’est pas encore bien éloigné, où un Canadien ne pouvait sortir de son village pour voir un peu de pays, sans être saisi d’étonnement à l’aspect des choses admirables qu’il rencontrait à chaque pas, tellement que, dès son retour, son premier soin était d’en communiquer la nouvelle à ses compatriotes.
À ces expansifs promeneurs, notre littérature nationale est redevable de toute une bibliothèque de récits de voyage, dont plus d’un lui fait honneur.
Je confesse sans détour que j’ai commis le même crime, si c’en est un, que les voyageurs à qui je viens de faire allusion. Et j’ai pensé, moi aussi, que j’avais l’impérieux devoir de raconter à notre public tout ce que j’ai vu d’étonnant dans un voyage qu’il m’a été donné de faire.
Ce n’est pas que j’aie été jusqu’aux extrémités de l’univers. Je n’ai pas visité les Indes, le meilleur endroit du monde pour lier connaissance avec tigres et panthères ; ni l’Australie, que les lapins, comme on sait, achèvent de dévorer ; ni même l’Europe, où l’on n’avoue pas sans confusion, aujourd’hui, qu’on n’a jamais voyagé. Je ne suis pas sorti des limites de la province de Québec ! C’est tout simplement la côte nord du bas Saint-Laurent que j’ai parcourue ; et ce que j’y ai vu m’a semblé si nouveau, qu’il m’a paru [viii] que ce pays doit être totalement ignoré de presque tous les Canadiens.
Pourtant, je croyais en connaître quelque chose. Hôte fréquent du palais épiscopal d’où l’on dirige l’administration spirituelle de cet immense pays du Labrador, rencontrant chaque année presque tous les missionnaires — mes anciens élèves — de cette vaste région, et causant longuement avec chacun d’eux, il me paraissait que j’avais au moins quelque idée des gens et des choses de là-bas.
Or, en 1895, sous prétexte qu’un voyage à l’eau salée, comme on dit, m’était quasi nécessaire, Mgr l’évêque de Chicoutimi voulut bien m’inviter à l’accompagner dans la première visite pastorale que Sa Grandeur faisait dans cette partie de son diocèse.
Eh bien, dès les premiers pas que nous fîmes sur cette côte du Labrador, tout me fut sujet à surprise : aspect de cette contrée, caractère, langage et mœurs de la population qui l’habite, importance et procédés de l’industrie de la grande pêche que l’on y exerce. — En un mot, pour employer une expression usitée parmi nous avec quelque malice, je découvrais le Labrador !
Je me dis alors : voilà une partie très considérable de la province de Québec dont l’on ne sait à peu près rien ni à Québec, ni à Montréal, ni ailleurs. Qui a la moindre idée de l’intéressante population qui travaille, là-bas, à accroître les ressources du pays, et qui se prépare, sans en souffler mot, à fournir d’excellentes troupes de marine les bâtiments de guerre du Canada — quand il faudra en avoir ? Qui est au fait du genre de vie de ces pêcheurs canadiens et acadiens ? Qui sait — à part les gens de Terre-Neuve [ix] et des provinces maritimes, qui ne le savent que trop bien — qui sait que nous avons là, à notre porte, une immense étendue de côtes où les pêcheries sont d’une richesse presque inépuisable ? Qui n’ignore absolument que, sur ces rivages septentrionaux du golfe, agonisent les derniers restes d’un peuple sauvage jadis puissant, qui fut constamment le fidèle allié de nos ancêtres les Français, dont nous avons payé la dette de reconnaissance en convertissant à la vraie foi tous ces descendants des guerriers d’autrefois ?
Et ce n’est pas la faute des Canadiens s’ils ne sont pas plus renseignés sur ce grand pays du Labrador. Que trouve-t-on, en effet, dans nos bibliothèques au sujet de ce territoire ? Depuis quarante ans, on relit le court récit du voyage de l’abbé Ferland au golfe Saint-Laurent, récit où il n’est question que du Labrador de l’est, qui ne comptait pas alors le tiers des hameaux que l’on y voit aujourd’hui. Depuis vingt ans, Faucher de Saint-Maurice nous parlait de ses promenades dans le bas du fleuve ; mais ce conteur agréable, s’occupant assez peu du Labrador d’aujourd’hui, se bornait presque à puiser dans les annales du passé et à rappeler le souvenir des expéditions navales et des naufrages célèbres des siècles précédents. Il y avait encore quelques rapports de peu d’étendue, comme ceux de MM. J.-U. Gregory et D.-N. Saint-Cyr, qui ne traitaient que d’un petit nombre des localités du Labrador.
C’était là toute la littérature labradorienne.
D’autres territoires, importants et peu connus, de la province de Québec, avaient cependant trouvé leur historien, leur panégyriste, leur peintre. Il est bien interdit, n’est-ce pas ? d’ignorer désormais l’histoire et les ressources du [x] Lac-Saint-Jean, du Saguenay, ou de l’Outaouais, depuis les beaux livres que leur a consacrés M. Buies, et qui sont dans toutes les mains.
Je ne rappelle pas les travaux, remarquables à tant d’égards, de ce brillant écrivain, pour leur comparer le volume que je présente aujourd’hui au public canadien ; j’ai même le plus grand intérêt à ce que l’on ne recherche pas à quel point il en diffère. Mais, enfin, les circonstances m’ont — pour ainsi dire — mis la plume à la main, et je me suis efforcé, avec d’humbles moyens, de faire pour le Labrador ce que M. Buies a fait pour d’autres régions de la Province.
L’exactitude a été constamment mon principal souci, comme c’est le devoir de tout historien. J’ai apporté une attention scrupuleuse à ne donner aucun renseignement qui ne me parût certain. Je dirais même, si cela ne devait paraître un peu téméraire, qu’il n’y a pas un membre de phrase, dans tout le cours de ce volume, dont je ne pourrais fournir les pièces justificatives.
Je dois pourtant, me semble-t-il, indiquer de quelle façon j’ai pu réunir les éléments de ce livre : cela montrera qu’il n’était pas possible de le composer d’après des informations plus sûres.
D’abord, outre la connaissance personnelle que j’ai pu acquérir de beaucoup de choses, j’ai fait une sorte d’enquête à chacun des “postes” que nous avons visités. Dès notre arrivée dans un village, mon premier soin était de rechercher les plus anciens habitants du lieu. Comme la plupart des colonies fixées le long de la côte du Labrador n’ont été fondées que depuis une quarantaine d’années, dans bien des [xi] cas j’ai pu interroger les personnes mêmes qui avaient pris part à leur établissement.
Pour ce qui est des sources documentaires, outre les écrits plus ou moins anciens qui existent sur le Labrador et l’île d’Anticosti, j’ai eu l’avantage d’avoir sous les yeux, en composant ce volume, toutes les archives ecclésiastiques du territoire compris dans la Préfecture du golfe Saint-Laurent.
Et puis, j’ai interrogé tous les missionnaires actuels du pays labradorien, et beaucoup des anciens missionnaires. Depuis deux années, je n’ai pas cessé d’entretenir une correspondance très active soit avec ces ecclésiastiques, soit avec des habitants du Labrador et de l’Anticosti, dans le but de me procurer tous les détails qui pouvaient m’être utiles. Je ne saurais dire, en particulier, combien je suis redevable, pour de précieux renseignements, à l’annaliste du Labrador, M. P. Vigneau, qui, depuis un tiers de siècle peut-être, enregistre tout ce qui se passe d’intéressant dans la région du golfe Saint-Laurent.
Du reste, si je tiens à indiquer ici à quelles sources authentiques j’ai puisé mes informations, ce n’est pas seulement pour que l’on sache que j’ai fait mon possible afin de mériter la confiance du lecteur ; c’est aussi pour témoigner ma reconnaissance à tous ceux qui m’ont aidé à exécuter l’œuvre que j’avais entreprise.
Et ceux qui se sont mis ainsi à ma disposition, ce sont tous ceux à qui j’ai demandé leur concours. Il m’est agréable de dire ici que toutes les portes où j’ai frappé se sont ouvertes devant moi. Évêque, “roi”—j’entends le roi de l’Anticosti, M. Menier — missionnaires, officiers des [xii] gouvernements d’Ottawa et de Québec, gardiens de phares et pêcheurs du bas Saint-Laurent : chacun s’est prêté de la meilleure grâce à ce que je désirais, et a paru s’intéresser vivement à mon dessein. Je n’aurais jamais pensé, sans cette expérience personnelle, qu’un écrivain pouvait compter à ce point sur tant de bonnes volontés.
Je remercie donc, du fond du cœur, toutes les personnes qui m’ont aidé de quelque façon que ce soit à remplir la tâche que, à tort ou à raison, j’ai cru m’être assignée.
Que ne puis-je me rendre le témoignage, au moins, que ce travail répond à l’attente de ceux qui ont bien voulu s’y intéresser ! J’aurais tant voulu lui donner la perfection qui fait que les œuvres littéraires marquées à son coin s’imposent à l’attention publique : résultat auquel j’aspirais, non dans un but de ridicule vanité, mais plutôt parce que, si l’on prenait plaisir à étudier un peu le tableau que je présente des gens et des choses du Labrador, ce pays si peu connu aurait tout à y gagner.
Car, je n’ai pas à m’en cacher, le Labrador me tient au cœur ! Sans parler de cette côte où l’on rencontre à chaque pas les points de vue les plus pittoresques ; sans parler des grands spectacles que nous ménage là-bas notre Saint-Laurent, dont on qualifie déjà de majestueux et d’incomparable le cours supérieur, et qui devient là-bas un véritable océan ; comment aurais-je étudié, sans en venir à l’aimer, cette vaillante population de pêcheurs canadiens et acadiens ? Comment, sans en être ému, aurais-je retrouvé, dans cette extrémité du Canada, les mœurs simples et les vertus patriarcales de nos pères, lesquelles, hélas ! s’effacent de plus en plus parmi nous, tandis qu’elles se [xiii] conservent et se conserveront longtemps encore chez ces bons Labradoriens ?
Oui, j’aurais voulu que ce livre brillât des qualités qui attirent et retiennent le lecteur, afin que tous mes compatriotes apprissent à connaître de quelle importance est pour la province de Québec la possession de cette grande région maritime du Labrador, et de quelles sympathies sont dignes ces frères ignorés qui contribuent pourtant, eux aussi, à maintenir les traditions nationales dans ce beau patrimoine que nous avons reçu de nos ancêtres !
Mais que parlé-je de qualités littéraires ! Si dans la mère patrie elle-même il n’est donné qu’à un petit nombre d’écrivains de tirer le meilleur parti de ce trésor incomparable de la langue française, c’est déjà un grand mérite, de ce côté-ci de l’Atlantique, de parler et d’écrire le français avec un certain degré de pureté et de correction. Peu d’entre nous y réussissent pleinement. Ce but est même pour nous si difficile à atteindre, que l’on a coutume d’accueillir avec indulgence ceux des nôtres qui osent affronter les hasards de la publicité.
Je compte donc que l’on ne me refusera pas cette indulgence. Et même, l’avouerai-je ? Je ne suis pas loin d’espérer que je vais charmer mes lecteurs, si Pline le Jeune a eu raison de dire : Historia quoquo modo scripta delectat [1]. Voilà qui est rassurant ; et je tiens cet écrivain pour le plus aimable des philosophes. Il est vrai que, avant de lui témoigner tant de gratitude, il y aurait à voir si la raison qu’il donnait de son aphorisme a autant de valeur aujourd’hui que de son temps. Sunt enim, ajoutait-il, homines natura curiosi, et quamlibet nuda rerum [xiv] cognitione capiuntur [2]. Cela toutefois fait trop bien l’affaire d’un écrivain de mon espèce, pour que je m’efforce à découvrir que, durant le cours des dix-huit siècles qui se sont écoulés depuis les deux Pline, les hommes ont réussi à se corriger d’un défaut si précieux pour les historiens.
Mais on me chicanera peut-être sur l’étendue de cet ouvrage. Je me garderai de répliquer avec humeur que, si l’on trouve le livre trop long, on n’a qu’à ne pas le lire, liberté dont un grand nombre, je le sais bien, sauront parfaitement se prévaloir. J’avouerai plutôt que, en effet, ce volume est considérable, et j’invoquerai sans crainte les circonstances atténuantes de ce prétendu forfait. Si l’on veut prouver que je ne sus jamais écrire, je prie donc que l’on ne tente pas de le faire en disant que je n’ai pas su me borner dans la composition de cet ouvrage. Car je prétends bel et bien que je suis resté dans des bornes encore assez étroites. Puisqu’il n’est pas de sujet si ingrat dont un habile homme ne puisse remplir des in-folio, qui dira que c’est trop de cinq cents pages pour traiter, à tous les points de vue qu’il faut, d’un pays de six à sept cents milles de longueur, et sur lequel on n’a presque pas écrit encore ? Il m’aurait été facile d’augmenter de beaucoup l’étendue de cet ouvrage, si j’avais cru qu’il fût utile d’épuiser toutes les informations que j’ai pu recueillir.
J’entends les érudits, les gens pour qui la géographie du Canada n’a pas de secrets, me demander compte de la justesse de ce titre de “Labrador” que j’ai mis en tête de mon livre. J’avoue que c’est assez l’usage aujourd’hui de réserver le nom de Labrador à la partie orientale de la côte du golfe, la partie occidentale, en deçà de Natashquan, étant [xv] ordinairement nommée Côte Nord. Mais j’ai cru préférable de comprendre sous la même dénomination un territoire qui présente, dans toute son étendue, des conditions à peu près identiques d’aspect, de climat, de population et d’industrie. Ce n’est d’ailleurs que revenir à l’usage d’autrefois et même d’une époque assez rapprochée, puisqu’il n’y a pas encore si longtemps que, de par la volonté de nos vainqueurs, tout le Labrador, qui comprenait alors la côte nord du bas Saint-Laurent à partir de la rivière Saint-Jean, faisait partie de la province de Terre-Neuve.
On trouvera sans doute dans ce volume bien d’autres sujets de critique ou de blâme, dont j’aurais beaucoup plus de peine à me justifier !
Toutefois, combien je m’estimerais heureux, si ce livre, malgré ses imperfections, assurait à nos pêcheurs du Labrador l’intérêt et les sympathies de ceux qui peuvent leur venir en aide de quelque façon ; s’il portait mes compatriotes à aimer de plus en plus cette belle province de Québec, pourvue de tant de ressources précieuses et dont l’avenir est si plein de promesses ; s’il accroissait la gratitude que nous devons éprouver pour une Providence qui, non seulement nous a faits catholiques et Français, mais encore a bien voulu nous réserver une part si avantageuse, lorsqu’Elle a divisé l’univers entre les diverses nations qui l’habitent !
L’abbé Victor-A. Huard.
Chicoutimi, 23 juillet 1897.
[xvi]
[1] NOTE DES CLASSIQUES. « L’histoire, quelle que soit la manière dont elle est écrite, nous délecte ». P. C.
[2] NOTE DES CLASSIQUES. La phrase entière, qui suit celle qui dit que les hommes apprécient l’histoire quel que soit la manière dont elle est écrite, est : Sunt enim homines natura curiosi, et quamlibet nuda rerum cognitione capiuntur, ut qui sermunculis etiam fabellisque ducantur. Elle peut être traduite par : « Les hommes sont, par nature, curieux. Ils sont toujours prêts à se divertir de contes et de nouvelles ». Elle est tirée de la huitième lettre de Pline à Capiton. P. C.
|

